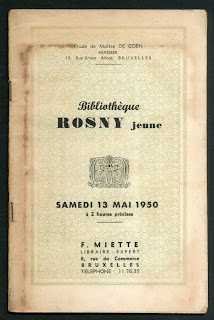MISE À JOUR DU 17 DÉCEMBRE 2024
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone (+32 (0) 472 51 52 63)
pour obtenir d'autres informations à propos de ces livres.
[ARTS - ANNÉES 1950]. Les années
50. Paris, Éditions
du Centre Pompidou, 1988. In-4° (213 x 298 mm.) sous
reliure souple d'éditeur, 640 p., nombreuses illustrations
en noir et en couleurs, bel exemplaire.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme présentée
au Centre Georges Pompidou, à Paris, du 30 juin au 17 octobre
1988.
Table des matières
:
1.
Prologue.
- Préface, par
Jean Maheu.
- L'air du temps,
par Jean Duvignaud.
- Relations internationales,
par André Fontaine.
- Rétrospective
de poche, par Pierre Boulez.
2. Peinture et sculpture.
- Quelques problèmes
de l'art contemporain, par Daniel Abadie.
- École de
Paris : un essai de redéfinition, par Bernard
Dorival.
- L'École de
New York, par Clément Greenberg.
- Parcours :
- Mystery
Paintings, par Hubert Damisch.
- Hans
Hartung, par Pierre Daix.
- Tachisme,
informel, abstraction lyrique, par Renato Barilli.
- Color
Field Painting ?, par Marcelin Pleynet.
- Un
« Einzelgänger Ì : Bram Van Velde,
par Rainer Michael Mason.
- La
nouvelle École de Paris, par Georges Limbour.
- Bissière,
par François Mathey.
- Bonjour
Monsieur Lapicque, par Harald Szeemann.
- Formes
et couleurs - Calder, Léger, Matisse.
- L'influence
de Magnelli, par Andreas Franzke.
- La
semaine de Herbin, par Serge Fauchereau.
- Abstraction
géométrique, par Willy Rotzler.
- La
cité universitaire de Caracas, par Alfredo Boulton.
- Calder,
par Giovanni Carandente.
- Art
cinétique, par Frank Popper.
- Réalisme
socialiste et avant-garde, par Ryszard Stanislawsky.
- Art
et politique, par M. Kozloff.
- Le
transitoire, l'éternel, par Marc Le Bot.
- L'objet
de la chair, par Pierre Restany.
- Têtes
et corps peints, par Gilbert Lascault.
- Chaissac
et Dubuffet, par Didier Semin.
- Morphologie
autre, par Michel Tapié.
- Le
petit lapin dans le fond de l'assiette, par José
Pierre.
- Peinture
du peu, Peinture de l'excès, par G. Bataille
et E.M. Cioran.
- Tinguely,
par Pontus Hulten.
- Monochromie,
par Claire Stoullig.
- Photographie.
- Le
réel devant le subjectif, par Christian Bouqueret.
3. Échanges et parallèles.
- Rigueur et formalisation.
- Une
poétique du roman, par Jean Roudaut.
- L'après
Weberne, par Célestin Deliège.
- L'héritage :
matériel et immatériel, par Tomàs
Maldonado.
- L'aléatoire.
- Zooooom
Ping Paf... Les formes libres, par Christian Borngraeber.
- Œuvre
ouverte, œuvre indéterminée, par Ivanka
Stoianova.
- Le poids de la technique.
- La
technique à la recherche d'un sens, par Donique
Janicaud.
- Musiques
expérimentales, par Brigitte Massin.
- Au
grand bazar des nouveautés, par Raymond Guido.
- La diffusion moderne.
- Des
chiffres et des êtres, par Jean-Paul Courthéoux.
- Réémergence
du metteur en scène, par Émile Copfermann.
- Les
nouveaux réseaux musicaux, par Claude Samuel.
4. Littérature.
- Du vieux continent.
- Les
années Sartre ?, par Jean-Michel Besnier.
- Maurice
Blanchot, par Roger Laporte.
- La
science-fiction, par Gérard Klein.
- L'Allemagne
après, par Jean-Louis de Rambures.
- « Les
Ragazzi » de Pier Paolo Pasolini, par Enzo Sicilano.
- L'Espagne
sous dictature, par Robert Marrast.
- Jeunes
gens en colère, par Françoise du Sorbier.
- D'autres continents.
- L'inquiète
quiétude de l'Amérique, par Pierre-Yves Pétillon.
- « Lolita »
de Nabokov, par Marc Chénetier.
- Le
théâtre américain, par Marie-Claire
Pasquier.
- La
rébellion Beat, par Claude Grimal.
- Tiers
monde : naissance d'un concept, par Jacques Cellard.
- Les
Latino-Américains, par Claude Couffon.
- « Tristes
tropiques » de C. Lévi-Strauss, par Jacques
Meunier.
- Francophones
du Maghreb, par Tahar Bekri.
5. Architecture et design.
- L'utopie au pied
du mur, par Marc Emery.
- Trente ans après,
par Rem Koolhaas.
- Par-delà
les tendances, par Patrice Goulet.
Allemagne.
- Maisons
à pignon ou gratte-ciel ?, par Werner Durth.
- Le
style Braun, par Cécile Mihailovic.
États-Unis.
- Organique
ou fonctionnel ?, par Dominique Rouillard.
- Du
stylisme au design global, par Evert Endt et Sabine
Grandadam.
- Le
computer IBM, par Cécile Mihailovic.
Europe de l'Est.
- Spoutnik
contre Explorer, par Albert Ducrocq.
- Du
réalisme au fonctionnalisme d'État, par Jean-Louis
Cohen.
- Novi
Beograd, par Cécile Mihailovic.
France.
- Les
chaises dorées de la mode, par Ginette Sainderichin.
- Le
Français dans ses meubles, par Yvonne Brunhammer.
- Ces
ensembles qu'on voulait grands, par Jean Dubuisson.
- Architectures
de... plaisance, par Bruno Vayssière.
Grande-Bretagne.
- Le
malentendu brutaliste, par Jacqueline Stanic.
- Naissance
du pop'art, par Michael Compton.
- Le
Design Council, par Marion Hancock.
Italie.
- Le
désir de réalité, par Vittorio Gregotti.
- Regard
sur la ville, par Francesco Rosi.
- Industrieux
artistes, par Vittorio Gregotti.
- Le
calculateur Olivetti, par Cécile Mihailovic.
Scandinavie.
- De
l'artisanat au design, par Yolande Amic.
- Le
modernisme comme idylle ?, par Vilhelm Helander.
6. Musique.
- La génération
de Darmstadt, par Patrick Szersnovicz.
- La classe Messiaen,
par Claude Samuel.
- « Le
Marteau sans maître » de Boulez, par Dominique
Jameux.
- Dix années
Boulez, par Dominique Jameux.
- Xenakis : Musique
Architecture, par Jean-Noël von der Weid.
- Une renaissance,
par Jean-Noël von der Weid.
- « Klavierstück
XI » de Stockhausen, par Jean-Noël von
der Weid.
- La nouvelle école,
par Philippe Albéra.
- « Il
Canto Sospeso » de Luigi Nono, « Epifanie »
de Luciano Berio, par Philippe Albéra.
- Mieux qu'un académisme,
par Patrick Szersnovicz.
- « Concerto
pour piano préparé et orchestre » de
John Cage, par David Gable.
- Tous les jazz,
par Daniel Caux.
- Le rock en noir
et blanc, par David Gable.
Vendu.
[BALL (Albert)]. BOWYER (Chaz) — Albert Ball, vc. Wrexham, Bridge Books, 1994. In-8° (è182 x 255 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, 197 p., illustrations.
Sur la jaquette :
Albert
Ball was Britain's first universally recognised air hero. Born
in Nottingham and educated at Trent College, he joined the army
on the outbreak of war in 1914 and transferred to the Royal Flying
Corps in 1915. On completion of his flying training he joined
No 13 Squadron, a recon-naissance unit serving in France. Transferring
to No 11 Squadron he quickly began to establish a reputation as
an aggressive combat pilot. He spent a short 'resf period with
No 8 Squadron before rejoining No 11, then served with No 60 Squadron.
Despite being only a junior officer, he was
the first man in the British army to be decorated with the DSO
and two bars.
After a period of service on the Home Establishment, he returned
to France as a senior pilot with the newly formed No 56 Squadron,
equipped with the SE5 Scout. By the time of his death, in mysterious
circumstances, Ball had been credited with at least 44 combat
victories in a period of only 15 months active service.
This revised edition of the definitive biography
of Ball includes a greatly enhanced collection of photographs.
Written with the full co-operation of the Ball family and many
of his contemporary pilots, this book is essential reading for
anyone interested in the history of military flying.
12 euros (code de commande : 01894).
CABANÈS (Augustin Cabanès, dit le docteur) — Villes d'eaux à la mode du Grand Siècle. Ouvrage illustré de 72 gravures. Paris, Albin Michel, 1936. In-8° (141 x 184 mm.) broché, 364 p., illustrations, (collection « Mœurs Intimes du Passé », douzième série), exemplaire en bon état.
Table des matières
:
- Pougues-les-Eaux.
- Forges-les-Eaux.
- La « Grande Mademoiselle »
à Forges-les-Eaux.
- Quelques visiteurs de marque à
Forges, au XVIIe siècle.
- Une reine de beauté, la comtesse
de Gramont, rencontre des jansénistes à Forges.
- Le passé de Bourbon-l'Archambault.
Quelques visiteurs, illustres ou seulement notoires, qu'elle accueillit.
- Un médecin, « agent
de publicité ». Les excentricités d'un
original. Charles de l'Orme et Bourbon-l'Archambault.
- Une favorite royale aux eaux. Madame
de Montespan à Bourbon-l'Archambault
- La Bruyère est-il venu à
Bourbon ? L'extinction de voix de Boileau. Son séjour
et ses distractions dans la station bourbonnaise.
- Deux chapitres des Mémoires
de Fléchier. Madame de Sévigné en Bourbonnais.
Ses cures à Bourbon-l'Archambault et à Vichy.
15 euros (code de commande : 01885).
CADET (Jacques) — Technologie du Tir à l'Arc de compétition ... de l'initiation à la haute compétition. Montreuil, J. Cadet, 1975 (4e réimpression). In-8° (194 x 240 mm.) broché sous jaquette d'éditeur, 194 p., illustrations en noir.
Avant-propos de l'auteur
:
Depuis
1959 où cette technique a pris forme, plus de dix années
d'expériences pratiques se sont écoulées.
Des instructeurs français et étrangers
ont été formés et instruits à cette
méthode. Les résultats obtenus en sont des preuves
concluantes. J’ai pu ainsi « faire »
le point et publier cette nouvelle édition sur la « méthode
souple », dont le « style est, à
ce jour, adopté par de nombreux champions mondiaux. »
Aucun des éléments qui la constitue n'a été
emprunté à des techniques ou à des méthodes
déjà existantes. Elle est le découlement
logique de la position naturelle du corps qui permet aux muscles
sollicités de travailler en souplesse et bien à
leur place, d'où un minimum d'effort à l'exécution
des mouvements, et une économie du potentiel énergétique,
matière première de l'archer de compétition.
Un changement continuel de « position »
pour trouver l'idéale, entraînera irrémédiablement
des défauts, parfois très graves, qui empêcheront
le tireur de prouver sa valeur réelle et peut le condamner
définitivement à une moyenne inférieure à
ses capacités. Les défauts pris à son insu,
sont la cause directe du manque de progression et, suivant leur
gravité, de la chute des scores. Pour y remédier,
j’ai classé et décomposé ces défauts
suivant leurs causes et leurs effets, en apportant pour chacun
deux une rectification rationnelle. Il serait souhaitable que
chaque tireur en connaisse l'origine afin d'éviter leur
enchaînement successif.
La puissance de l'arc et la durée de
l'entraînement individuel dépendent des possibilités
physiques de réserve du tireur. Il ne devra donc pas surestimer,
de manière à conserver toute sa maîtrise.
Une erreur, fréquente chez certains archers, est de croire
qu'un arc de force maximale avec un entraînement intensif
représente une garantie absolue et constante de précision
dans leur tir ; ce dernier élément ne peut
compenser un manque de condition physique, surtout (dans la majorité
des cas) après une perte d'énergie due à
un travail quotidien. Pour « faire des points »,
la règle est immuable, l'archer doit dominer son arc en
permanence, sans aucune défaillance.
Il est indispensable d'avoir la patience d'assimiler
et d'utiliser la « méthode souple »
dans son ensemble, sans la fractionner. L'utilisation partielle
peut amener des déboires imputables à l'archer qui
n'aura pas su appliquer la technique dans son intégralité.
C’est là le but et l'utilité
de cette nouvelle édition où chaque élément
est expliqué, point par point, afin qu'elle soit facilement
assimilée par tous.
20 euros (code de commande : 01896).
COLINON (Maurice) — Histoire des jeux olympiques. Paris, Gedalge, 1960. In-8° (145 x 210 mm.) broché, 126 p., illustrations en noir et en couleurs (ces dernières hors texte), (collection « Grand Pavois »).
Table des matières
:
- Un
jeune Grec.
- Un lieu nommé Olympie.
- La grande fête d'Olympie.
- Décadence et fin d'Olympie.
- Pierre de Coubertin, le rénovateur.
- Athènes 1896. La résurrection
d'Olympie.
- Paris 1900. La « Belle Époque »
boude les jeux.
- Saint-Louis 1904. Des jeux très
« américains ».
- Londres 1908. L'entente cordiale était
encore fragile.
- Stockholm 1912. Jean Bouin perd une bataille.
- Anvers 1920. Jean Bouin vengé.
- Paris 1924. Un roi quatre fois couronné
: Paavo Nurmi.
- Amsterdam 1928. Ladoumèque battu.
Un inconnu nommé M. Courage.
- Los Angeles 1932. Un grand cirque et
de bons numéros.
- Berlin 1936. L'incomparable Jesse Owens.
- Londres 1948. Un timide retour à
Olympie.
- Helsinki 1952. Quatre médailles
pour la famille Zatopek.
- Melbourne 1956. Alain Mimoun, le vieux
soldat de marathon.
- Rome 1960. À quelle distance d'Olympie
?
8 euros (code de commande : 01898).
COLLINS (Paul) — La Folie de Banvard. Treize récits de malchance, d'obscure célébrité et de splendide anonymat. [Titre original : Banvard's Folly.] Traduit de l'américain par Lionel Leforestier. Paris, Le Promeneur, 2008. In-8° (130 x 215 mm.) broché sous couverture à rabats, 329 p., illustrations hors texte, exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
Edison,
Einstein, Darwin : gloire à ces noms dont les découvertes
ont changé l'histoire de l'humanité, et que cette
dernière a salués en retour d'une reconnaissance
éternelle. Mais quid de tous ceux qui furent, ou
se crurent, à deux doigts d'une théorie révolutionnaire
et que les aléas de la fortune, la malchance, un manque
d'à-propos, un brin de folie ou tout cela réuni
auront, après un bref moment de notoriété,
rejeté dans l'oubli, les notes en bas de pages, et qui
auront suscité l'intérêt des seuls spécialistes ?
Ainsi de John Cleves Symmes, zélateur
acharné de la théorie de la Terre creuse, de Délia
Bacon, qui perdit la raison à vouloir prouver que Shakespeare
n'était pas l'auteur de ses pièces, de René
Blondlot, éminent physicien, ami de Poincaré, découvreur
de fantomatiques « rayons N », ou de John
Banvard, figure éponyme du recueil, peintre de panoramas
immensément célèbre, qui se ruina à
se prendre pour Barnum...
Voici donc, exhumés des cendres de l'histoire,
treize portraits d'artistes, lettrés et hommes de science
– excentriques, imposteurs ou naïfs –
qui mirent une obstination sans bornes à ne pas changer
le monde.
Vendu.
[COOLS (André)]. COLLETTE (Arnaud) et HALLEUX (Philippe) — André Cools. Rebelle d'État. Ottignies - Louvain-la-Neuve, Éditions Quorum, 1996. In-8° (141 x 219 mm.) collé, 304 p., illustrations hors texte.
En quatrième
de couverture :
« Qui
je suis, c'est très simple. Une grand-mère illettrée.
Deux grands-pères totalisant 80 ans de mine et dans le
fond. Parmi ces deux-là, un Flamand d'où mon nom.
Une sainte mère, mais exi­geante. Un père victime
de ses perpétuelles révoltes, métallurgiste
et militant syndical, mort à 36 ans dans le camp de Mauthausen.
Une prime jeunesse au moment de la crise des années 30.
Une adolescence ayant comme seul terrain de jeu la Maison du Peuple.
Cinq ans de misère et d'angoisse – comme tant
d'autres – pendant la guerre. Depuis 1945 une vie de
militant... » Ainsi se définissait André
Cools.
La question royale, les grèves de 60,
le renardisme, la réforme de l'État, la scission
du PSB, l'Internationale socialiste, mais aussi Ibramco, Agusta,
Neos... Cools traverse quarante ans de vie politique en spectateur
engagé parfois, en acteur essentiel souvent.
Rarement une personnalité politique aura
été aussi controversée que le Maître
de Flémalle. Robin des Bois moderne ou despote implacable ?
Adoré ou haï ? Les mots ne sont pas trop forts,
André Cools ne laissait personne indifférent. Chacun
reconnaîtra le rôle immense que ce « rebelle
d'État » a joué dans l'histoire politique
de ce pays.
9 euros (code de commande : 01884).
DE DEKEN (Constant) — Twee jaar in Congo. Introduction par Frans M. Olbrechts. Antwerpen, De Vlijt, 1952. In-8° (150 x 225 mm.) broché sous jaquette d'éditeur, 203 p., illustrations hors texte, exemplaire non coupé.
Introduction :
Er
wordt terecht gezegd dat een volk dat zijn groten eert, zich zelf
eert, en het is dan ook een hoogst lofwaardig initiatief van de
Gemeente Wilrijk andermaal haar grote zoon, Pater Constant De
Deken, te huldigen, ditmaal naar aanleiding van de 100e verjaardag
van zijn geboorte.
Inderdaad, onder de vele vooraanstaande missionarissen
die van hieruit naar de landen van overzee togen, neemt Pater
De Deken een eerste rangsplaats in.
Hij is een van die talrijke zonen van ons volk
die zich niet tevreden gehouden hebben met bij de minder beschaafde
volkeren de boodschap van het Evangelie te brengen, maar die ook
steeds een open oog gehad hebben voor wetenschappelijke waarnemingen
en voor al het interessante waaraan ze bij hun verre reizen voorbij
kwamen.
Waardige opvolger van een Willem van Bubroek
(1253-1255), van een Pieter van Gent (1523), van een Joris van
Geel (1651), van een Ferdinand Verbist (1660) en van zoveel anderen
heeft hij zijn missiewerk steeds op een harmonische wijze weten
in overeenstemming te brengen met de eisen van het wetenschappelijk
onderzoek, en ondanks zijn drukke bedrijvigheid als missionaris
heeft hij in zijn kort leven tijd gevonden om ons 21 wetenschappelijke
publicaties te schenken.
Na lange jaren doorgebracht te hebben in China
heeft hij zich daar op korte tijd tot een zo grote autoriteit
in de kennis van het Oosten opgewerkt, dat hem in 1889 het vererend
aanbod gedaan werd de bekende Franse oriëntalist Bonvalot
en Prins Henri van Orléans te vergezellen op een lange
tocht dwars door Azië en Thïbet. Hierover heeft Pater
De Deken een boek geschreven dat veel opgang gemaakt heeft en
voor­drachten gehouden in wetenschappelijke genootschappen
die overal zijn roem gevestigd hebben.
Het is dan ook niet te verwonderen dat toen
de Algemene Overste van de Missies van Scheut, E. P. J. Van Aertselaer,
een lange reis door Congo moest ondernemen om de reeds gevestigde
missies te inspecteren en om er nieuwe te stichten, hij beroep
deed op de rijke ondervinding van Pater De Deken en hem aanbood
hem te vergezellen.
Van deze reis is het boek Twee Jaren in Congoland
de vrucht en het is een hoogst verheugend initiatief van het Comité
van Wilrijk en van degene die met zoveel activiteit de spil van
dit Comité is, Volksvertegenwoordiger-Burgemeester L. Kiebooms,
een nieuwe uitgave van dit door het grote publiek zo graag gelezen
werk te bezorgen.
Al mag dit werk vijftig jaar oud zijn, al mag
het de toestand in onze Kolonie beschrijven gedurende de pioniersperiode,
toch blijft dit boek nog steeds een rijke bron voor hen die de
jeugdperiode van Congo willen leren kennen.
Aan het Koninklijk Museum van Belgisch Congo
werd de eervolle taak opgedragen aan deze heruitgave mede te werken.
Aan de oorspronkelijke tekst zelf is niets veranderd tenzij dat
de spelling ervan gemoderniseerd werd. Deze tekst is op grondige
wijze verrijkt door de vele voetnota's die er aan toegevoegd werden;
deze zijn van de hand van twee leden van het wetenschappelijke
personeel van het Museum : Dr Marcel Luwel voor het historische
gedeelte, Dr Albert Maesen voor het ethnografische; ook de illustratie
werd door het Museum verzorgd.
We twijfelen er niet aan of de heruitgave van
dit boek, naar aanleiding van het eeuwfeest van de geboorte van
Pater De Deken, zal op rijke wijze bijdragen tot de verering die
onze jeugd en gans ons volk verschuldigd zijn aan deze stoere
reiziger en missionaris, en tot het wekken van een nog groter
belangstelling voor het werk van de vele pioniers die, zoals Pater
De Deken, de grondslagen gelegd hebben van het grote gebied in
Centraal Afrika waaraan zovelen van ons volk het beste van hun
werklust en van hun krachten geschonken hebben.
20 euros (code de commande : 01907).
DELATTRE (Achille) — À la gloire du mineur. Anthologie ornée de trente-trois illustrations. Cuesmes, Impricoop, 1958. In-8° (142 x 184 mm.) broché, 215 p., illustrations hors texte, exemplaire en très bon état.
Achille
Delattre réunit ici un choix de textes concernant la mine.
On y trouve les noms célèbres de la littérature
: Louis-Laurent Simonin, Émile Zola, Louis-Eugène
Caustier, Georges Clemenceau, Laguerre, Alexandre E. Millerand,
Hector-Henry Malot, Gilbert Cesbron, Upton Sinclair, A. J. Cronin,
Gustav Morcinek, Otto Dunbier, A. Hans, Camille Lemonnier, Louis
Delattre, Pierre Hamp, Jules Destrée, Louis Piérard,
Jules Sottiaux, Constant Malva, Jean-Louis Vandermaesen, Valentin
Van Hassel, Marius Renard, G. Delarge, Georges Rameackers, O.
P. Gilbert, Henri Deligne, G. C. Rutten, Pierre Demart, Jean-Pierre
Barrou, Marcel Sala, Jef Rens et Achille Delattre.
Extrait de l'avant-propos :
C'est seulement vers la moitié du
19e siècle que des écrivains d'avant-garde commencèrent
à décrire la vie des hommes attachés aux
travaux des mines. À ce moment déjà, grâce
à la vapeur et à la société anonyme
qui permit de réunir les gros capitaux exigés par
les nouvelles techniques, l'industrie houillère a déjà
pris de considérables développements.
Avant cette période, les allusions aux
mines gué l'on trouve, se rapportent à la recherche
du charbon et aux difficultés que rencontre sa mise à
fruit.
Mirabeau, à l'Assemblée nationale
française qui suivit la prise de la Bastille en 1789, disait
dans un grand discours sur l'industrie charbonnière qui
commençait à se développer dans le Nord de
la France :
« Le premier filon était à
trois cents pieds et n'était susceptible d'aucun produit.
Pour y arriver, il avait fallu franchir un torrent intérieur
qui couvrait tout l'espace dans une étendue de plusieurs
lieues. On touchait la mine avec une sonde et il fallait, non
pas épuiser cette masse d'eau, ce qui était impossible,
mais la traverser. Une machine immense fut construite, c'était
un puits doublé de bois ; on s'en servit pour contenir
les eaux et traverser l'étang. »
En 1867, Simonin, rompant avec cette espèce
de tradition, publia son premier livre, La Vie souterraine
qui eut immédiatement des imitateurs d'importance, tel
Émile Zola.
Les sujets ne manquaient pas : les catastrophes,
les grèves violentes et souvent sanglantes mêlées
à la misère des corons miniers étaient autant
de sujets presqu'inépuisables qui se bousculaient sous
la plume des auteurs.
Par la suite, lorsque pareilles raisons venaient
à manquer, les écrivains à sensation en trouvaient
à volonté dans leur bénévole encrier.
Le mineur a été très longtemps
méprisé, considéré comme un perpétuel
plaignant, un révolté sans motif.
Mais ces premiers écrivains de la mine
et des mineurs qui étaient des hommes de talent et d'audace
leur rendirent justice, d'autres suivirent qui les présentèrent
tels qu'ils sont véritablement : ardents au travail, courageux
dans le danger, néanmoins amateur de franche gaîté.
« Débarrassé de son
masque noir, dit l'Académicien Louis Delattre, le houilleur
redeviendra le Gaulois joyeux, pétillant, le frère
de l'alouette fredonnante. »
Le mineur est goguenard. : les curieux
visiteurs de travaux souterrains ainsi que les amateurs de fortes
sensations qui veulent tâter du métier pendant une
courte période, sont parfois victimes de cette tournure
d'esprit.
Leurs farces et leurs blagues, ont cependant
parfois des lendemains surprenants.
C'est ainsi que l'un de ces amateurs de fortes
émotions s'étant informé d'où venait
l'eau qui tombait sur la cage et l'arrosait si désagréablement,
reçut comme réponse « que c'était
les camarades des étages supérieurs du vaisseau
de fer qui leur « pissaient » sur la tête,
histoire de les bénir. »
Dans une brochure à sensation, le naïf
curieux rapporta l'histoire ainsi que d'autres de même valeur
qui lui avaient été versées dans l'oreille ;
les auteurs de ces audacieuses trouvailles en rirent à
gorge chaude.
Les littérateurs de mines et de mineurs
n'ont pas toujours cette naïveté ; la plupart,
presque tous, peut-on dire, ont tenu à se documenter sérieusement
avant de confier leurs constatations au papier.
Mais les outrances et les invraisemblances ne
sont pas rares dans la littérature minière.
Nous nous sommes attachés à les
éviter dans notre choix des textes et n'avons pas hésité
à écarter de nos analyses, les récits par
trop fantaisistes qui défiguraient visiblement la vérité.
Vendu.
[DELPLACE (L.)] — Les maçons-juifs et l'avenir ou La tolérance moderne. Louvain, Fonteyn, 1884. [Louvain / Charles Fonteyn, Imprimeur-Éditeur / rue de Bruxelles, 6 / MDCCCLXXXIV] In-8° (133 x 182 mm.) broché, [2], 125, [3 bl.] p., couverture défraîchie, rare.
Notice
de la bibliographie de Paul Fesch :
L'auteur pense que la Franc Maçonnerie,
tout en ayant une grande influence, n'est pas aussi puissante
qu'on le suppose ; son plan est :
« Après avoir esquissé dans
un aperçue rapide l'origine de la Franc-Maçonnerie,
nous découvrons les causes qui ont modifié et dénaturé
son esprit primitif. L'examen des doctrines et des principes qu'elle
s'est identifiée, nous trouvons la clef de la situation
politique contemporaine ; les raisons de la différence
profonde qui sépare les idées libérales de
l'Angleterre et la tendance prétendument libérale
des Loges continentales se révèleront à notre
esprit et nous feront comprendre en même temps le danger
de l'influence maçonnique en Belgique et en France. »
Bibliographie :
- Le Court (Jules-Victor de), Dictionnaire
des anonymes et pseudonymes (XVe siècle-1900), p. 596
(723).
- Fesch (Paul), Bibliographie de la Franc-Maçonnerie
et des sociétés secrètes, col. 878-879.
Vendu.
DRUEZ (Laurence) et MAQUET (Lucien) — Le patrimoine protestant de Wallonie. La mémoire d'une minorité. Namur, Institut du Patrimoine Wallon, 2017. In-4° (237 x 307 mm.) sous cartonnage illustré d'éditeur, 409 p., nombreuses illustrations en couleurs, exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
Basé
sur des enquêtes de terrain et sur des dépouillements
de nombreux fonds d’archives à ce jour peu exploités,
ce livre vise à faire connaître, dans toute leur
diversité et dans leur contexte historique. les édifices
les plus emblématiques du culte protestant – appelés
communément « temples » –
de Wallonie.
À travers l’étude de leur
conception, de leur construction, de leur aménagement,
de leurs évolutions extérieures et intérieures,
de leur environnement et de leurs multiples fonctions – pas
seulement cultuelles –, le lecteur découvrira
l’identité complexe d'une minorité religieuse
discrète, mais vivante et largement méconnue, et
ses mentalités, révélatrices d'un rapport
à l'espace et au temps.
Fruit d’un partenariat entre les Archives
générales du Royaume et l'institut du Patrimoine
wallon, cet ouvrage met aussi en valeur un patrimoine documentaire
riche et unique – mais menacé – qui
constitue la mémoire du protestantisme belge, cinq fois
centenaire en cette année 2017, et à une meilleure
compréhension de son inscription dans notre société,
marquée par le pluralisme religieux et philosophique.
Vendu.
ESME (Jean d') — À travers l'empire de Ménélik. Paris, Office Colonial d'Édition, [1947]. In-8° (142 x 193 mm.) broché, 336p., illustrations hors texte, une carte à déplier, exemplaire non coupé, papier jauni.
Table des matières
:
Première
partie. Au seuil brûlé de l'Éthiopie.
- Notre-Dame-des-Sables.
Deuxième partie. Sous le signe du lion
de Juda.
I. Vers la « Nouvelle
Fleur ».
II. Dans la « Nouvelle
Fleur » surgie des « Eaux-Chaudes ».
III. Chez la Reine des rois
d'Éthiopie.
IV. La Lumière d'Éthiopie.
V. La vie européenne.
VI. L'autre œuvre de
Pénélope : organiser une caravane.
Troisième partie. Du kilomètre
1 au kilomètre 3402.
I. Notre village de toile.
II. Au pays des Gallas...
et des lions.
III. À travers les
Arroussis.
IV. Dans le désert
Dankali.
V. Debré-Libanos, la
Jérusalem d'Éthiopie.
VI. Au Godjam : chez
le ras Aïlou.
VII. Au lac Tsana, parmi les
Ouéïtos.
VIII. Vers Gondar l'historique.
IX. L'autre bout de la piste.
15 euros (code de commande : 01878).
FICHEFET (Jean) — Nouvelle histoire de Tamines. Étude historique, économique et sociale. Gembloux, Duculot, 1963. In-8° (165 x 255 mm.) broché, XI, 400 p., illustrations et planches hors texte, exemplaire non coupé et en très bon état, peu courant.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- Préface.
1ère partie. Les éléments
naturels.
2e partie. Le peuplement anté-romain
et romain.
3e partie. La toponymie.
4e partie. Le Haut et le Bas Moyen Âge.
5e partie. Les seigneuries et les seigneurs
de Tamines.
6e partie. La vie religieuse.
7e partie. Les moyens de circulation et de transport.
8e partie. L'économie rurale.
9e partie. Les activités industrielles.
10e partie. La population et son évolution
démographique.
11e partie. L'habitat.
12e partie. L'histoire des écoles et
de la vie culturelle.
13e partie. Les événements militaires
et politiques.
14e partie. La commune, ses dépendances
et ses institutions sous l'Ancien Régime.
15e partie. La vie politique et sociale.
16e partie. Quelques transformations sociales.
17e partie. Folklore et traditions populaires.
18e partie. La vie communale et administrative.
- Index des noms de lieux.
Vendu.
GARDAM (Catharine) — Le Noël des animaux. Illustrations de Gavin Rowe. [Paris], Éditions Bias, 1990. In-4° (221 x 268 mm.) sous cartonnage illustré d'éditeur, exemplaire en très bon état.
4 euros (code de commande : 01882).
[GASTRONOMIE].
Les Recettes des « Belles Perdrix ».
Recueillies par Gabrielle
Reval et Maria Croci. Paris, Albin Michel, 1930. In-8°
(121 x 189 mm.) broché, 326 p., exemplaire un
peu défraîchi, quelques rousseurs.
Un ouvrage rare
!
« Hors-d'œuvre »
de Maurice Edmond Sailland, dit Curnonsky, Prince des Gastronomes
:
...
Les « Belles Perdrix » que j’ai vu
naître ou que j’ai vues naître, (grammatici
certant et adhuc sub judice lis est !) me font l'insigne
honneur de solliciter, pour ce livre alerte, original et charmant,
quelques mots de présentation.
À quoi bon ?
Les Belles Perdrix peuvent voler de leurs
propres ailes.
Déjà, leur compagnie, si jeune
encore, a su construire des nids confortables et élire
d'agréables mangeoires sur le territoire de ma principauté
de Gastronomie. Déjà elles ont leurs fastes et leurs
annales. Et ce recueil, si divers et si vivant, en administre
la plus aimable preuve.
Elles ont gentiment et gaîment protesté
contre l’exclusivisme intransigeant et, comme disent les
politiciens du midi, contre l'ostracisme des Clubs de Gourmets,
qui s'inspirant d’un antique et illustre exemple, ont exclu
les femmes de leurs agapes et de leurs réunions.
... Et elles ont su démontrer le mouvement,
en volant.
En quoi, du reste, elles se sont conformées
à la plus haute Tradition de la vraie Gastronomie française,
qui est l'œuvre des grands cordons bleus tout autant que
des grands chefs.
Je suis heureux de trouver ici l'occasion de
proclamer, une fois de plus, toute la reconnaissance que doivent
les Gourmets à l'admirable collaboration des femmes dans
l'œuvre, unique au monde, de la cuisine française.
C'est la probité héréditaire
de nos cordons bleus, c'est la délicatesse innée
de leur goût qui ont surtout imposé chez nous la
Tradition de la cuisine simple, de celle qui se fait avec du temps
et un peu de génie, de celle dont on a pu dire, comme des
humbles travaux du ménage, qu'elle est « une
œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. »
Car notre Art français – et
la cuisine est une de ses branches ! – est avant
tout un art fait de discrétion, de charme, de grâce
et de simplicité, un Art qui ne vise jamais à l'effet.
Voici quelque trente ans que je parcours la
France gastronomique, et je mourrai sans en avoir connu toutes
les merveilles culinaires, mais je ne mourrai pas, du moins, sans
avoir dit quelles joies délicates et complètes m'ont
données nos admirables cordons bleus.
Au hasard du souvenir qu'il me soit permis de
saluer Mme Génot, Mme Monteil, Mme Ducotet (de Paris) ;
notre grande Pauline Brazier (de Lyon), Mme Mélanie Rouat
(de Riec-sur-Belon) ; la bonne mère Clémence
(de la Chebuette, près de Nantes) ; Mme Pasquier,
d'Angers et son homonyme Mme Pasquier, de Condé, Mme Germaine
Larbaudière, d'Ermenonville ; Mme Delsaut, de Saint-Léon-sur-Vézère.
Je m'arrête, car cette préface
prendrait les dimensions d'un in-octavo ! Et je n'ai cité
ici que des cordons bleus qui tiennent des restaurants. Mais dans
ce pays qui est, du consentement unanime des peuples, celui du
monde où l'on mange le mieux, chacun sait que nulle part
on ne mange aussi bien que chez l'habitant et que rien ne vaut
un repas intime organisé par une maîtresse de maison
française, avec le concours de sa brave cuisinière,
Joséphine ou Mathurine, Célestine... voire Bécassine,
dont le public ignorera toujours les noms, mais qui n'en sont
pas moins dans la gastronomie française comme les humbles
ouvriers de nos sublimes cathédrales.
Et qu'on me permette ici de revendiquer l'honneur
d'avoir créé pour nos charmantes gastronomes de
France l'appellation de gourmettes. D'aucuns me l'ont reproché
! je n'en ai... cur ! Mon néologisme a fait
son petit bonhomme de chemin.
Et mes chères Belles Perdrix me permettront
bien de leur dire que je les mets au premier rang des gourmettes
françaises !
J'ai su apprécier, quand elles m'ont
fait l'honneur de me convier à leurs agapes, tout le charme,
tout l'entrain, toute la gaîté qu'elles savent mettre
dans leurs réunions.
Et tout autant que d'être Prince Élu
des Gastronomes, je me suis proclamé fier et ravi d'être
l'invité des Belles Perdrix !
25 euros (code de commande : 01911).
GOBERT
(Gérard) — Le conflit entre Maurice Lafosse et
Elio Di Rupo pour le mayorat de la Ville de Mons en octobre 1988.
Analyse socio-politique. S.l.,
s.n., 1990. A4 (210 x 297 mm.) sous reliure plastique et
couverture transparente, IV, 127, 29, 75 p., impression anapistographique.
Mémoire
présenté à la Faculté Universitaire
Catholique de Mons en vue de l'obtention du diplôme de licencié
en Sciences Politiques et Administratives, année académique
1989-1990.
Résumé :
Le
présent mémoire propose une analyse socio-politique
du conflit qui, à la suite des élections communales
d'octobre 1988, a opposé, à Mons, pour le mayorat
de la ville, les deux premiers candidats de la liste socialiste,
Maurice Lafosse et Elio Di Rupo.
La cause immédiate de ce conflit qui
éclate le soir des élections réside dans
le nombre très important de voix de préférence
obtenu par le second candidat Elio Di Rupo (9 560 voix), alors
que Maurice Lafosse, candidat-bourgmestre officiel du parti socialiste
montois, n'en récolte que 4 681. C'est sur cette base qu'Elio
Di Rupo remet en cause le classement des candidats qui avait été
arrêté par les instances du parti plus de deux ans
avant les élections.
Après deux semaines de conflit ouvert,
Elio Di Rupo renonce à ses prétentions mayorales
et Maurice Lafosse deviendra bourgmestre de Mons.
La méthode de l'analyse stratégique
appliquée à ces événements permet
de mettre en évidence : les origines du conflit et
les causes de son éclatement, les caractéristiques
de la stratégie électorale qui a permis au parti
socialiste de conquérir la majorité absolue à
Mons et à Elio Di Rupo de réaliser un résultat
personnel aussi important, les termes des échanges et des
négociations qui se sont déroulés durant
la phase aiguë du conflit, les causes du retrait final d'Elio
Di Rupo.
Les conclusions font apparaître qu'au
moment où s'achève l'analyse, c'est-à-dire
en juin 1989, Maurice Lafosse, Elio Di Rupo et le président
de l'Union socialiste communale montoise se trouvent dans une
situation de réussite par rapport à leurs objectifs
personnels. Seuls, les citoyens qui, après les élections,
ont manifesté leur soutien à Elio Di Rupo apparaissent
comme les perdants du jeu politique qui s'est déroulé.
D'autre part, la méthode de l'analyse stratégique
utilisée dans la recherche se révèle un outil
efficace et bien adapté au type de situation étudiée.
Enfin, c'est la conception de la démocratie défendue
par Elio Di Rupo qui semble la plus proche de la souveraineté
populaire.
Vendu.
GRAY (Peter) — L'Irlande au temps de la grande famine. Traduit par Pascale Froment. Paris, Gallimard, 1995. In-8° (125 x 178 mm.) broché, 160 p., très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, (collection « Découvertes - Histoire », n° 265), exemplaire en parfait état.
En quatrième
de couverture :
Les
Irlandais du XIXe siècle, paysans pour la plupart, sont
les habitants les plus pauvres d'Europe. Leur subsistance dépend
d'une seule et unique culture, la pomme de terre, tandis que les
propriétaires des terres, les Anglais, ne se soucient que
d'exporter céréales et bétail.
Automne 1845 : une maladie inconnue ravage la
pomme de terre : la population est décimée,
l'Irlande se meurt. Catastrophe naturelle et oppression politique
font sourdre une révolte qui échouera.
Peter Gray met au jour ce paradoxe : la
famine a tué plus d'un million d'Irlandais, elle en a poussé
plus de deux millions à émigrer, mais de ce drame,
vécu comme un crime anglais, est née la conscience
nationale irlandaise, qui conduira à la création,
en 1922, de l'État libre d'Irlande.
Vendu.
[HUREZ
(Léon)]. Léon Hurez. Préface
de Michel Debauque. [La Louvière], [Les Amis de
Léon Hurez], [1985]. In-4° (194 x 265 mm.) collé,
49 p., illustrations.
Publication
éditée à l'occasion de la séance d'hommage
à Léon Hurez organisée le 26 janvier 1985
au Théâtre communal de La Louvière.
Préface :
La
vie et la carrière de Léon Hurez sont exemplaires.
C'est un homme qui doit tout à ses propres
qualités. Les fées ne se sont pas penchées
sur son berceau mais jamais, il n'a sombré dans le fatalisme.
Il a terminé avec succès ses études
malgré la guerre et surtout après la perte douloureuse
de ses parents.
La tradition familiale, la vision quotidienne
des misères humaines, la volonté de contribuer à
l'amélioration de la condition des travailleurs l'amènent
tout naturellement à militer dans les rangs syndicaux et
au sein du Parti Socialiste.
Cette action obscure, il l'a menée sans
relâche tout en se révélant un professeur
exigeant et humain.
Pour ceux qui le connaissent, sa candidature
et son élection aux élections légis­latives
de 1961 n'ont pas constitué du tout une surprise.
Il s'est révélé un mandataire
consciencieux, soucieux du respect de l'électeur, fidèle
à ses engagements.
Chez lui, pas de discours inutiles, de phrases
creuses, de promesses faciles.
La franchise, la loyauté et le dévouement
sont restés ses vertus cardinales à tra­vers
les vicissitudes de la vie politique.
En tant que gestionnaire, il a été
sans cesse guidé par le souci d'efficacité.
L'amitié et l'esprit d'équipe
ont toujours présidé ses relations avec ses collaborateurs
qu'il a toujours su mobiliser et galvaniser.
Il a participé à des moments très
délicats de l'histoire nationale : remise en cause
du Pacte Scolaire, révision constitutionnelle, mise en
place difficile de la régionalisation. À chaque
instant, il a eu le souci de défendre les principes, les
idées, le programme de l'équipe dont il était
membre en reléguant au second plan ses ambitions personnelles
et en rejetant le carriérisme et les mondanités.
Ses plus belles joies, son épanouissement
il les a connus dans la vie locale où il a démontré
ses qualités d'administrateur.
À Strépy-Bracquegnies, il a cicatrisé
les plaies provoquées par la crise charbonnière.
De cette commune marquée par la multiplication des sites
industriels désaffectés et dont l'habitat souffrait
d'un vieillissement prématuré, il a fait une cité
résidentielle verte et accueillante.
Après la fusion des communes, il a su
galvaniser les énergies pour faire de La Louvière
un ensemble urbain cohérent digne du rôle régional
qui lui est reconnu.
Sa méthode de gestion a toujours été
faite de rigueur et d'enthousiasme communicatifs.
Il a bien mérité de La Louvière,
de la Wallonie, du pays.
Qu'il en soit remercié !
Vendu.
LACHOUQUE (Henry) — Terres héroïques. Waterloo, Champs de bataille de 1815. Bruxelles, André Boone, 1953. In-8° (140 x 245 mm.) broché sous jaquette d'éditeur, [92] p., nombreuses illustrations en noir, cartes, exemplaire en bon état.
Le livre se découpe
comme suit :
Première
partie : La Campagne de 1815.
Combats de Charleroi, Bataille
de Ligny, Bataille des 54 Bras, Bataille de Wavre, Bataille de
Waterloo, Retraite de Namur.
Deuxième partie : Théâtre
des opérations de la campagne de 1815 dressé en
4 itinéraires :
- Bruxelles, Waterloo,
Charleroi ;
- Charleroi, Fleurus,
Gembloux ;
- Nivelles, Les Quatre-Bras,
Namur ;
- Bruxelles, Wavre, Namur.
9 euros (code de commande : 01891).
LAURIS (Georges) — Contes de Noël aux herbes de Provence. Préface par Gilles Lapouge. Paris, Les Éditions du Cerf, 2002. In-8° (155 x 240 mm.) collé, 201 p., exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
Mais
d'où viennent donc ces savoureuses histoires ?
Il faut reconnaître que Georges Lauris
a su s'entourer de nombreux collaborateurs pour écrire
ces contes : des ânes et des anges, des abeilles, des
hirondelles, une tripotée d'étoiles, des fêlures
silencieuses, des flocons de neige... On l'imagine écrivant
même avec une plume d'oie ! Et si d'aventure, il avait
besoin de corriger un chapitre, point de gomme un petit coup de
mistral suffit pour emporter les mots inutiles.
Et voilà un livre léger, offert
au plaisir de lire.
Il faut le lire de préférence
à haute voix : bien vite, la sagesse des santons parle
avec une pointe d'accent et beaucoup de tendresse. D'histoire
en histoire, on fait le plein de sagesse et de vie, le plein de
poésie. On plonge dans un grand réservoir de rêves
et d'émotions. Il suffit de se laisser guider de mot en
mot, de phrase en phrase, d'étoile en étoile...
Et c'est magique : on comprend tout. On comprend surtout que « ce
sont les êtres les plus frêles qui donnent le secret
du monde. »
Selon les mots de Gilles Lapouge, Lauris nous
fait partager « sa confiance dans les êtres et
dans les choses, sa famine de bonheur pour tous les vivants, une
espérance implacable. »
Vendu.
LECOUTEUX (Claude) — Dictionnaire de mythologie germanique. Odin, Thor, Siegfried, & Cie. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Imago, 2007. In-8° (140 x 228 mm.) collé, 261 p., illustrations en noir, exemplaire à l'état de neuf.
En quatrième
de couverture :
Siegfried,
Odin, la Lorelei, le Roi des Aulnes, voilà des personnages
mythiques bien connus. Pourtant, s'étendant de l'Allemagne
à l'Islande, la mythologie germanique, et plus précisément
germano-scandinave – souvent victime de préjugés,
sans doute en raison de fâcheuses récupérations
historiques –, reste dans l'ensemble trop ignorée.
Du Moyen Âge à nos jours, s'appuyant
notamment sur les Eddas, les Sagas, les légendes
et les traditions populaires, ce dictionnaire nous invite à
arpenter des espaces enchantés où foisonnent dieux,
fées, elfes, lutins, revenants, nains et géants...
Il nous décrit, par exemple, les cultes rendus aux sources
et aux arbres, maints rituels magiques, nous conte l'éternelle
errance du Chasseur maudit, l'étrange aventure de Peter
Schlemihl et de nombreuses autres histoires fabuleuses...
Unique en son genre, œuvre d'un éminent
spécialiste, cet ouvrage nous fait découvrir ainsi
toute la richesse et la poésie d'une des plus grandes cultures
européennes.
Vendu.
LERMONTOV (Mikhaïl Iourievitch) — Un héros de notre temps. Traduit du russe par Alain Guillermou. Illustré par Jean Traynier. Introduction par Pierre Pascal. Paris, Club Bibliophile de France, 1954. In-8° (152 x 207 mm.) sous demi-reliure rouge d'éditeur, dos à qutre nerfs, 174 p., 5 illustrations hors texte, (collection « La Comédie Universelle », n° 22), exemplaire en bon état.
Extrait de l'introduction
:
Un
héros de notre temps – qu'on fasse attention
à ce titre ! – c'est justement la « confession
d'un enfant du siècle ». Petchorine, cet officier
en disgrâce, méprisant et sombre, doué d'une
intelligence aiguë et d'un froid égoïsme, qui
propage autour de lui le malheur et la désolation, d'ailleurs
toujours sincère avec lui-même, c'est Lermontov,
ou plutôt c'est le visage romantique que Lermontov veut
se donner. Mais ce romantique est quand même beaucoup plus
proche des réalités que n'était le dandy
de Pouchkine, Eugène Oniéguine. Et surtout il est
entouré de très réels personnages :
le brave capitaine Maxime Maximytch, un de ces héros modestes
et un peu ridicules qui n'en sont pas moins les constructeurs
efficaces de l'Empire ; la société composite
et désœuvrée des villes d'eau, avec ses cancans,
ses élégances, sa peur des Tcherkès, les
intrigues amoureuses de la princesse Mary et de Grouchnitzki – un
Petchorine sans esprit ni profon­deur – et ce curieux
et perspicace docteur Werner ; les indigènes, enfin,
primitifs, spontanés, fougueux, avec une succession de
scènes variées, fêtes et banquets, chevauchées,
rapts, exploits de contrebandiers... Enfin, il y a le cadre, la
nature : Un héros de notre temps contient quelques-unes
des plus belles descriptions de la littérature russe.
Des cinq récits dont se compose le roman,
les trois premiers parurent isolément, dans la revue Les
Annales de la Patrie, en 1839 et 1840 ; les autres complétèrent
le volume, en 1840. Une seconde édition fut imprimée
en 1841. La critique fut enthousiaste, et l'œuvre devint
aussitôt classique. Lermontov, qui avait été
pardonné et rappelé dans son ancien régiment,
n'eut pas le temps de produire beaucoup après cela :
renvoyé au Caucase après un duel, il fut tué
en duel à Piatigorsk en 1841, à 28 ans, par Martynov,
le prototype, dit-on, de l'insupportable Grouchnitski.
Une fois encore, une dizaine d'années
plus tard, le Caucase inspirera une œuvre remarquable, ou
plutôt un chef-d'œuvre, Les Cosaques, de Tolstoï.
Là aussi se retrouveront l'officier fatigué et déçu
par la vie mondaine de la capitale, le cadre imposant des hautes
altitudes et des neiges éternelles, les mœurs originales
des Cosaques, les passions brutales, les vertus naturelles et
les vices naïfs des indigènes primitifs, et la petite
guerre impitoyable.
Ensuite, le Caucase étant soumis entièrement
de la mer Noire à la Caspienne, cette source de littérature
émouvante tarira.
Ainsi Un héros de notre temps
fait partie d'une série de romans où s'est exprimé
un moment de l'histoire russe et de la sensibilité russe.
Un champ pittoresque et lointain d'opérations militaires
a fourni à 1'« Enfant du siècle »,
désœuvré et blasé, un dérivatif
à son spleen – car le Russe possède un
correspondant à ce terme – et aux écrivains
en prose ou en vers des thèmes nouveaux. Au romantisme
nordique des nuits et des cimetières a succédé
le romantisme de l'Orient. À son tour, la littérature
« coloniale » des Pouchkine, des Marlinski,
des Lermontov et des Tolstoï posera à la conscience
des intellectuels russes le problème du retour à
la nature et de la « simplification ». Un
héros de notre temps et plus encore, il va de soi,
Les Cosaques, contiennent certains éléments
du futur tolstoïsme.
Vendu.
LICHTENBERGER (André) — Pickles ou Récits à la mode anglaise. Paris, Les Éditions G. Crès & Cie, 1923. Mention de quatrième édition sur la couverture. In-8° (120 x 187 mm.) broché, 171 p., couverture défraîchie et rousseurs.
Table :
I.
Gulliver chez les Vichebolks.
II. M. Pickwick et les Boches.
III. La curieuse aventure de M. Cuffycoat.
IV. Mowgli vient du front.
Notice d'Albéric Cahuet :
Sur une couverture blanche, quatre bocaux verte avec
des étiquettes rouges ou violettes aux noms de Swift, Dickens,
Wells, Kipling, se rangent sous ce titre acide : Pickles ou
Récits à la mode anglaise (Crès, éditeur,
5 fr.). Et ce sont, en effet, quatre fantaisies où l'art
souple de M. André Lichtenberger se divertit à nous
dire, à la manière des quatre célèbres
conteurs britanniques, le voyage, étonnamment moderne,
de « Gulliver chez les Vichebolks », la
curieuse histoire de M. Pickwick prenant contact avec les Boches,
la curieuse aventure de M. Cuffycoat, et le retour du front de
Mowgli, « le petit d'homme
qui fut le frère des loups » et chassa quinze
ans dans la jungle avant de revêtir l'uniforme kaki pour
aller faire, en Europe, la grande guerre.
Bibliographie :
- Cahuet (Albéric), « Les
livres nouveaux - Romans et contes », dans La Petite
illustration, n° 134 - 17 février 1923, p.
[46].
9 euros (code de commande : 01876).
LOCOGE (Jean) — Les Sensitives. Poésies. Mons, Édition du journal « La Province », 1936. In-8° (196 x 260 mm.) sous couverture à rabats un peu passée, 99 p., rousseurs.
Ouvrage d'une
grande rareté avec un envoi de l'auteur à Louis
Van de Spiegele.
Extrait de l'ouvrage À
la découverte de ma commune. Ghlin :
Jean
Locoge est né à Ghlin le 13 juin 1917 et y décéda
le 27 juin 1959. Il était le fils du pharmacien de la Grand-Place
et frère d'Hélène Locoge, peintre
plus connue. Il adhéra au Parti Communiste Belge
et, en 1948, à l'occasion de sa participation à
un chantier en Bulgarie, il rencontra Zorka Gurova qui devint
son épouse. On lui doit des nouvelles, des pièces
de théâtre et des recueils de poésies ;
parmi ceux-ci, parut, en 1936, Les Sensitives, dont la
rédaction commença, alors qu'il était âgé
de quinze ans, le 14 août 1932 et s'acheva le 25 mars 1936.
Le dédicataire du recueil est le peintre
surréaliste montois Louis Van de Spiegele
qui, avec ses amis Achille Chavée et Fernand Dumont, participa
aux activités de Rupture, puis du Groupe surréaliste
de Hainaut et de Haute Nuit dont les premières
expositions eurent lieu dans sa galerie Le Sagittaire.
Bibliographie :
- Abrassart (Jeannine), Lettres lumeçonnes.
Bio-bibliographie montoise : répertoire alphabétique
des auteurs nés, résidant ou ayant vécu à
Mons, 2012, t. II, pp. 254-256.
- Canonne (Xavier), « Van de
Spiegele Louis », dans 1000 personnalités
de Mons & de la région, p. 760.
- Debacker (Marie-France), Wautelet (Michel)
et Arnould (Marie), À la découverte de ma commune.
Ghlin, p. 93.
50 euros (code de commande : 01904).
[LORRAINE]. Aux origines de la Lorraine rurale. De 6000 avant notre ère à l'an mil. Metz, Service Régional de l'Archéologie de Lorraine - Serpenoise, 1993. In-4° (210 x 297 mm.) collé, 79 p., illustrations en noir et en couleurs, couverture plastifiée.
En quatrième
de couverture :
Depuis
une dizaine d'années, les fouilles entreprises en Lorraine,
à l'occasion des travaux d'aménagement du territoire,
ont livré une moisson de données qui contribuent
à la connaissance du monde rural. Infrastructures routières,
carrières, zones d'activité, lotissements... tout
concourt à dévoiler le passé des campagnes
lorraines depuis leurs origines. La présence vigilante
des archéologues conserve la mémoire du sol avant
qu'il ne connaisse des bouleversements irrémédiables
et que des pans entiers de l'histoire de l'humanité disparaissent.
Qu'il s'agisse d'indices fugaces, comme les labours fossiles de
Liéhon ou l'empreinte d'un bovidé du Néolithique
final, ou encore d'ensembles structurés révélés
par les décapages en grande surface, tels ces plans d'habitation
avec leurs structures annexes (greniers, silos, puits...) du Bronze
moyen ou du Haut Moyen Âge. Des découvertes inédites
sont ainsi mises à la disposition du grand public, comme
des spécialistes. Elles contribuent ici à retracer
l'émergence et l'évolution de l'agriculture et des
sociétés rurales du 6ème millénaire
avant notre ère à l'an Mil. dans le détail
de la vie quotidienne, de l'artisanat et des pratiques funéraires.
12 euros (code de commande : 01895).
[MANUSCRIT ANCIEN]. Règles de conduite. Petit cahier manuscrit in-8° (110 x 175 mm.) broché sous couverture muette de papier gris, [25] p.
Manuscrit d'une
auteure inconnue que l'on peut probablement dater de la fin du
XVIIIe ou du début du XIXe siècle, contenant un
ensemble de préceptes sur des règles à tenir
afin de mener une vie saine et sereine. Ces textes, largement
inspiré du célèbre ouvrage d'Anne-Thérèse
de Marguenat de Courcelles marquise de Lambert (1647-1733), Avis
d'une mère à son fils et à sa fille,
traitent de l'amour-propre, des égards, de
la dignité, de la franchise, de la discrétion,
de l'égalité, de la médisance,
de la colère, de l'amitié, de la santé,
de l'arrangement (dépenses, revenus), de la douceur,
de la faiblesse, des jugements et de la vengeance.
L'introduction nous donne des précisions sur les intentions
de l'auteure :
Une grande faiblesse dans le caractère
m'a empêchée toute ma vie de profiter de ma raison
et m'a subordonnée aux personnes qui voulaient me faire
servir à leurs intérêts, de manière
que j'ai passé tous les âges qui pouvaient m'être
utiles, sans tirer parti de rien. J'ai contracté ainsi
un esprit d'irrésolution et de négligence qui rendent
toutes mes réflexions et mes manières tristes pour
moi et pour les autres. Cent fois j'ai fait des projets à
des sujets qui ne m'ont encore servi de rien mais pour tâcher
cependant de sortir de la mélancolie qui me domine et pour
finir le peu d'années qui me reste à vivre avec
une tranquillité qui me rende plus supportable aux autres
et à moi, je me trace des règles qui puissent me
servir à tout moment de tirer profit de surmonter tout
(sic) mes défauts et prévenir ceux que des
circonstances de société pourrait me faire contracter.
40 euros (code de commande : 01901).
[MÉTÉOROLOGIE].
Après la pluie, le beau temps : la météo. Paris, Éditions
de la Réunion des Musées nationaux, 1984. In-8°
(157 x 200 mm.) broché, 176 p., nombreuses illustrations
en noir et cinq en couleurs, une coupure de presse, exemplaire
en très bon état.
Catalogue publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
au Musée des Arts et Traditions populaires, à Paris,
du 23 novembre 1984 au 15 avril 1985.
Sommaire :
Observer.
- Introduction, par Jean
Cuisenier.
- Cosmologie populaire
et vie quotidienne dans la société traditionnelle.
- L'observation du temps.
- Mesurer le temps.
- Proverbes et météorologie.
- Les almanachs.
- L'observation des astres.
- Astrologie et pronostication.
- L'observation des phénomènes
atmosphériques.
- Les
girouettes.
- L'observation et la
prévision du temps par les animaux.
- L'observation et la
prévision du temps par les plantes.
- L'observation des « objets-témoins »
de la vie quotidienne.
- Hors
de l'espace domestique.
- « la
météorologie de cuisine ».
- Le corps-baromètre.
- La prévision
à long terme : les pronostications.
Prévoir.
- La météorologie
: discipline scientifique et pratiques quotidiennes.
1. La différence
des regards sur le temps.
1-1.
L'observation individuelle.
1-2.
L'observation scientifique du temps.
2. De l'observation
à la mesure du temps : l'étude de l'atmosphère.
2-1.
L'antiquité.
2-2.
L'étude de l'atmosphère et le renouvellement des
sciences physiques au XVIIe siècle.
2-3. La
diffusion des découvertes.
3. De la
mesure du temps à la météorologie.
3-1.
Vers une observation systématique du temps.
3-2.
La formation de la science météorologique.
- Les
baromètres.
- Les
anémomètres.
- Les
thermomètres.
- Les
pluviomètres.
- Une
météorologie scientifique : la météorologie
contemporaine.
- La
météorologie dans la société contemporaine
: la diffusion des informations.
- La
diffusion des savoirs scientifiques dans la culture populaire.
-
Les « baromètres à eau ».
Prévenir.
- La protection physique
du corps dans la société traditionnelle.
- Le temps aléatoire
et la peur des catastrophes.
- Les
ex-voto marins provençaux.
- La prévention
et la protection physique contre les intempéries.
- Les pratiques symboliques
de protection.
- Protection
des personnes contre la foudre et le tonnerre.
- Protection
des personnes contre les inondations.
- Protection
des biens : la maison.
- Protection
des biens : les champs.
- Protection
du bétail contre la foudre et le tonnerre.
- Protection
de la collectivité villageoise contre le tonnerre, la foudre,
la sécheresse.
- Pratiques de protection
contre les intempéries : les saints intercesseurs.
1. Les saints
dont la vie légendaire comporte des éléments
météorologiques.
2. Les saints
agraires.
3. Les saints
calendaires.
4. Les saints
dont le nom évoque des éléments météorologiques.
5. Les saints
locaux.
Vendu.
[MONS
- PRESSE]. Journal « La Province » Mons.
Souvenir du XXVe anniversaire. 1er mars 1907 - 1er mars 1932.
[Mons], [La Province], [1932].
In-4° (188 x 255 mm.) broché, 80 p., illustrations
hors texte, tirage limité, rousseurs.
Exemplaire offert
à Hadelin Desguin, directeur du journal Le Hainaut.
Préambule :
À
l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation,
notre journal a demandé, à chacun de ses collaborateurs,
une page destinée à être publiée dans
un numéro spécial.
Afin de perpétuer le souvenir de cet
événement, nous avons cru bon de réunir les
envois de nos amis. La présente plaquette constitue une
sorte de florilège de La Province.
Ce souvenir n'est tiré qu'à un
nombre limité d'exemplaires ; il ne sera pas lancé
dans le commerce, mais simplement offert en hommage à tous
ceux qui ont mis, et mettent encore, leur plume et leur talent
à la disposition de notre cher quotidien.
20 euros (code de commande : 01893).
PEIGNOT (Gabriel) — Les Bourguignons
salés : diverses
conjectures des savans sur l'origine de ce dicton populaire, recueillies
et publiées avec notes historiques et philologiques ;
par Gabriel Peignot. Dijon,
Lagier, 1835. [Dijon, / Victor Lagier, Lib.-Édit., place
Saint-Étienne. / M. DCCC. XXXV.] In-8° (149 x 225 mm.)
broché (le dos de la couverture manque), 43, [1 bl.] p.,
rousseurs, ex-libris manuscrit de l'avocat montois Letellier à
la deuxième page de couverture.
Très
rare ouvrage dont le tirage a été limité
à 150 exemplaires.
Extrait :
Depuis
le seizième siècle, on a souvent agité la
question de savoir d'où provient le dicton populaire Bouguignon
salé ? Quelle est son origine ? quel événement
y a donné lieu ? depuis quel temps il existe ?
Nous avouons franchement qu'il ne serait pas facile de trouver
à ces diverses questions une solution décisive,
incontestable et satisfaisante, car tous les historiens, tous
les philologues, qui en ont parlé et qui ont prétendu
les résoudre, sont bien éloignés d'être
d'accord entre eux. Mais si d'un côté, cette divergence
d'opinion altère la confiance, de l'autre, elle excite
la curiosité et peut être utile. On retire toujours
quelque fruit à suivre les érudits dans le vaste
champs des conjectures, même lorsqu'ils s'y égarent ;
ce sujet n'est donc pas tout-à-fait à dédaigner.
D'ailleurs qui sait si du choc de tant d'opinions diverses, suivies
de nouvelles recherches, ne jaillira pas un jour quelque rayon
de lumière qui nous présentera tout-à-coup
le vrai Bourguignon salé si naturel, si palpable,
que la tourbe ergotante des commentateurs et des antiquaires,
d'accord pour la première fois, s'écriera :
Oui, c'est cela, c'est bien lui, le voilà ! En attendant
cet heureux moment, un peu éloigné sans doute, passons
en revue toutes les opinions, toutes les conjectures hasardées
sur ce singulier sobriquet ; et pour éviter toute
confusion, présentons-les séparément et successivement,
afin que l'on ne prête point à Pierre ce qui appartient
à Paul.
Vendu.
PERIN (François) — Franc-parler. Témoignage sur la double crise du christianisme et du rationalisme. Louvain-la-Neuve, Quorum, 1996. In-8° (141 x 220 mm.) collé, 191 p., exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
«
La tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible
menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer
les dieux. »
Faisant sienne cette parole d'André Malraux,
François Perin plaide pour une rénovation de la
pensée humaniste, dégagée des gangues du
christianisme et du rationalisme. Nulle loi, divine ou autre,
ne régit le destin de l'homme !
À l'appui de sa thèse, François
Perin invoque les découvertes de la science sur l'univers
et le chaos. Dans le même temps, il prône une réhabilitation
des valeurs de la Grèce antique occultées par le
christianisme. Tout comme il explore les voies ouvertes par les
grands mystiques ainsi que par la philosophie bouddhiste.
Victime de guerres suicidaires et de délires
idéologiques depuis presque vingt siècles, l'Europe
n'engendrera, à la fin de ce siècle, qu'un vague
marché. Quant à une civilisation, en sera-t-elle
capable ?
À travers cet essai, François
Perin lance une bouteille à la mer à destination
d'héritiers inconnus... et fait œuvre politique.
5 euros (code de commande : 01889).
PIÉRARD (Louis) — La Hollande et la guerre. Paris, Librairie Militaire Berger-Levrault, 1917. In-12 (112 x 169 mm.) broché, 93 p., (collection « Pages d'Histoire 1914-1917 », 9e série, K), couverture tachée, peu courant.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- La Presse.
- La violation de la neutralité
belge.
- La mobilisation hollandaise.
- Le pangermanisme et la Hollande.
- Le sentiment populaire.
- La cour, l’armée, l’aristocratie.
- La Hollande et le blocus.
- La Mecque des pacifistes.
- Chez les socialistes.
- Internés et réfugiés
belges en Hollande.
- Dans les camps hollandais.
- Les Wallons d’Amersfoort.
- Les prisonniers d’Urk.
Vendu.
POULAILLE (Henry) — La Grande et Belle Bible des Noëls anciens. Noëls régionaux et Noëls contemporains. Paris, Albin Michel, 1951. In-8° (190 x 238 mm.) broché, 538 p., illustrations hors texte.
Extrait de l'introduction
:
Il
n'y a guère qu'un siècle qu'on commença à
s'intéresser en France à la chanson populaire. Quelques
esprits curieux s'étaient avisés, avec quelques
lustres de retard sur l'Allemagne, où Goethe, Herder, d'Arnim
et Clément Brentano avaient heureusement prospecté,
qu'il pouvait y avoir chez nous l'équivalent du lied
d'outre-Rhin. Ils trouvèrent et se passionnèrent
si bien dans leurs travaux qu'ils parvinrent à attirer
l'attention du pays sur la muse dédaignée qu'ils
avaient rencontrée. L'enthousiasme des Champfleury, Nerval,
Coussemaker, Weckerlin, de Villemarqué, etc., suscita des
émules dans la France entière, et grâce à
leurs collectes, on a à peu près l'inventaire complet
de la chanson de nos provinces, du moins ce qu'en avait gardé
la tradition orale et les publications. Malheureusement, il n'y
a pas de médailles sans revers. Après les chercheurs
surgissent toujours les critiques. Et bien entendu, ceux-ci, loin
de mettre en lumière les découvertes de leurs prédécesseurs,
s'appliquent en général à minimiser ce qu'ils
regardent.
Certes, les enquêteurs avaient accumulé
leurs matériaux sans les classer judicieusement ;
à côté de la romance, de la complainte, du
chant de métier, se trouvaient le chant bachique et le
Noël. C'était un tel amassement de textes et de pages
de musique qu'on décida, dans les sphères qui s'occupaient
de la question, qu'il convenait de faire, avant tout, un choix.
Logiquement, un choix se devrait faire après examen de
tout ce qui entre en compétition. En matière de
critique, il en est autrement ; on écarte d'abord,
on juge ensuite.
Pour ce qui est de la chanson, de l'ensemble
des poésies glanées, çà et là,
souvent recueillies péniblement, on décréta
que de tels genres étaient populaires, et que tels autres
n'en étaient point. On écarta ainsi des cadres de
la discussion, sans autre forme de procès, la chanson à
boire et celles de Noël.
Il eût été plus normal de
faire la sélection des chansons dans chaque groupe. L'on
eût vu qu'il y avait de vraies chansons populaires de Noël
et même bachiques. On eût très facilement pu
éloigner les pièces dues à des faiseurs.
Ne s'en trouve-t-il pas dans tous les domaines du chant ?
La méthode adoptée, de rejeter
en bloc des formules de chansons, fut pour ce qui est des Noëls,
d'autant plus grossière que cette formule était
la plus féconde de toute la lyrique populaire. On peut
se demander si l'on n'en arriva pas à cela pour s'épargner
un travail de discrimination qui risquait d'être long. Pour
la chanson bachique, très riche aussi, née sous
le signe de l'oisiveté, et d'essence bourgeoise, cela a
moins d'importance ; elle est rarement d'émanation
authentiquement peuple, et a l'avantage d'appartenir à
la poésie officielle pour ses meilleurs couplets. Il n'en
est pas de même pour les chants de Noël, mis au ban
de cette poésie.
On a dit qu'elle n'avait aucune valeur, ni pour
les paroles d'une naïveté désarmante ni pour
la musique, celle-ci étant pour la plupart des cas, empruntée
de-ci de-là, par leurs auteurs. S'il est exact que les
mélodies des Noëls sont rarement originales, n'eût-il
pas fallu permettre d'en juger sur les textes pour ce qui était
des paroles ? Si tranchantes et définitives que se
veulent des affirmations, elles ne peuvent valoir que pour autant
qu'elles sont contrôlables. Or, les éléments
de contrôle dans les travaux critiques sur les Noëls,
sont toujours absents. À croire qu'ils n'existent point.
Pourtant, ils sont des milliers. Qu'est-ce à dire ?
J'ai cherché à m'expliquer les
raisons du mépris dans lequel ce genre est tenu, ainsi
que la quasi-unanimité dans la négation de sa valeur.
Je crois y être parvenu. Je pense que ce décri doit
s'imputer à la déception qu'eurent les musicographes
quand ils furent devant les preuves que la musique des Noëls
– qu'ils aimaient – ! n'était
que d'emprunt.
Du jour au lendemain, ils furent honnis, ayant
eu la malchance insigne d'être considérés,
on ne sait pourquoi, pour leur parement mélodique d'abord.
En général, on ne juge d'une chanson sur sa seule
musique, il en fut toujours ainsi pour celles de Noël. Je
me borne à le constater. Longtemps, on avait cru leurs
mélodies nées en même temps que les poèmes
qu'elles accompagnaient ; puis l'on connut qu'elles leur étaient
d'ordinaire, antérieures ; de là, à penser
qu'elles étaient antiques, il n'y avait qu'un pas qui fut
franchi et ne fut pas sans causer quelques amusants glissements
dans l'absurde... Ce fut le cas du musicien Lesueur, auteur d'un
Télémaque. Il avait pris pour thèmes
de sa Messe de Noël certaines chansons noéliques connues.
Pour corser l'intérêt, il avait pris le soin de dater
les mélodies qu'il empruntait. Il le fit au juger, les
situant des siècles en arrière, allant jusqu'au-delà
du millénaire. Telle venait, affirmait-il, de l'Église
primitive d'Orient, une autre était d'un Noël antique
de l'Église gallicane, une troisième remontait au
IVe siècle. Or ces Noëls avaient cent ou deux cents
ans, c'étaient : Voici la nouvelle que Jésus
est né ; Or dites-nous Marie ; Où s'en
vont ces gais bergers... La bévue était grosse.
Depuis, on est en garde contre cette chanson, on ne veut plus
lui reconnaître le moindre charme. Les poètes avaient
eu la malencontreuse idée d'indiquer les timbres qu'ils
proposaient à leurs chanteurs, et l'on avait retrouvé
ces airs. Or, que vit-on ? Ces chansons qu'on avait si longtemps
pensé « inspirées » étaient
portées sur les ailes de mélodies faites pour des
chants de beuverie, des danses, des romances très lestes
et même des sonneries de chasse. Après l'admiration
due à leur antiquité, ce fut la relégation
qu'encourut leur iniquité. Leur rejet devait être
l'aboutissement fatal dans l'appréciation des amateurs,
qui n'envisageant que le côté musical du Noël,
se considéraient dupés.
Si les paroles avaient compté, on eût
montré plus d'équité à l'égard
de ces petits poèmes qui payent aujourd'hui bien cher le
succès qu'ils connurent durant des siècles.
Vendu.
PROUST (Marcel) — Pastiches et Mélanges. Vingt-quatrième édition. Paris, Librairie Gallimard - Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1927. In-8° (122 x 188 mm.) broché, 272 p., ex-dono à la page de garde, couverture défraîchie.
En quatrième
de couverture de la réédition dans la collection
« L'Imaginaire », chez Gallimard :
C’est
en 1909 que Proust songe à rassembler les pastiches de
Balzac, Flaubert, Michelet, Renan, Sainte-Beuve, Henri de Régnier,
Saint-Simon, etc., qui faisaient partie d’une série
publiée dans Le Figaro. « Mais non, écrit-il
à Fernand Gregh, un volume pour les pastiches, ce serait
excessif. »
Cet « exercice ridicule », avait-il dit au moment
de cesser d’en écrire, auquel il a, par ailleurs,
prétendu s’être livré, « par paresse
de faire de la critique littéraire, amusement de faire
de la critique littéraire en action » .
Publié en 1919, Pastiches et mélanges rassemble,
à côté de ces variations « à
la manière de », les grandes préfaces aux
ouvrages qu’il a traduits de Ruskin et quelques articles
tels Sentiments filiaux d’un parricide et Impressions de
route en automobile.
Table des matières :
Pastiches.
L'affaire Lemoine.
I. Dans
un roman de Balzac.
II. L' «
Affaire Lemoine », par Gustave Flaubert.
III. Critique
du roman de M. Gustave Flaubert sur l'« Affaire Lemoine
», par Sainte-Beuve, dans son feuilleton du Constitutionnel.
IV. Par
Henri de Régnier.
V. Dans
le « Journal des Goncourt ».
VI. L'«
Affaire Lemoine », par Mîchelet.
VII. Dans
un feuilleton dramatique de M. Émile Faguet.
VIII. Par
Ernest Renan.
IX. Dans
les Mémoires de Saint-Simon.
Mélanges.
- En mémoire des
églises assassinées.
I. Les églises
sauvées. Les clochers de Caen. La cathédrale de
Lisieux. Journées en automobile.
II. Journées
de Pèlerinage. Ruskin à Notre-Dame d'Amiens, à
Rouen, etc.
III. John
Ruskin. La mort des cathédrales.
- Sentiments filiaux
d'une parricide.
- Journées de
lecture.
8 euros (code de commande : 01897).
QUENEAU (Raymond) — Les Ziaux. Nouvelle édition. Paris, Gallimard, 1948. In-8° (139 x 193 mm.) broché, 73 p., (collection « Métamorphoses », n° XVII), couverture un peu défraîchie avec un petit manque au dos.
Texte d'Olivier de Magny
pour une réimpression avec L'Instant fatal :
Constatons
que Les Ziaux et L'Instant fatal abordent avec une
alacrité réconfortante notre aujourd'hui où
s'aggrave une impressionnante dégradation du langage, où
la circulation des mots, monnaie de dupe, évoque l'émission
hémorragique de petits chèques sans provision. Parmi
bien des tumultes au silence pareils, ces poèmes nous émeuvent
– et nous intriguent – de savoir conserver
toute leur fraîcheur et leur âpreté, l'exact
accent de leur chagrin, et le tranchant particulier de leur éclat.
Le jeu, qui pour les composer parfois les disloque, sauve à
travers eux une certaine gravité : celle de la poésie.
Est-il trop tard, est-il trop tôt pour rendre un sens plus
pur aux mots de la tribu ? À la tribu, Raymond Queneau,
en tout cas, restitue des mots, avec chacun desquels il parle
sa vérité ; avec lesquels il nous donne à
entendre, sans toutefois le formuler, le secret de la seconde
simplicité.
8 euros (code de commande : 01888).
REMACLE (Louis) — Toponymie de Lierneux. Liège, George Michiels, 1990. In-8° (155 x 233 mm.) broché, 180 p., cartes dans le texte et une carte à déplier, (collection « Mémoires de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie (Section Wallonne) », n° 16), exemplaire non coupé et en très bon état, peu courant.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- Introduction.
- Enquête orale
et localisation des lieux-dits, avec liste des témoins.
- Variations dialectales.
- Archives dépouillées.
- Bibliographie.
- Toponymes.
- Additions et corrections.
- Index.
20 euros (code de commande : 01910).
RENARD (Jean-Claude) — L'âge de la fonte. Un art, une industrie 1800-1914. Suivi d'un Dictionnaire des artistes. Paris, Éditions de l'Amateur, 1985. In-4° (232 x 297 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, 319 p., nombreuses illustrations en noir, un cahier en couleurs, exemplaire en très bon état.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- Identité et démultiplication.
Première partie. L'art de la fonte.
- Des premiers âges
du fer à l'art industriel.
- L'industrie de la fonte.
- La
fonte, dite fonte de fer.
- Le
cycle de production.
- La
refonte.
- Les
moules et les techniques de moulage.
- La
coulée du métal.
- La
finition.
- De la création
à la reproduction.
Deuxième partie. Catalogues et productions.
- Les grands fondeurs.
- L'architecture.
- Le mobilier urbain.
- L'art des jardins.
- La statuaire profane.
- L'univers domestique.
- Les bijoux et les jouets.
- L'art sacré.
Troisième partie. Dictionnaire des artistes :
les œuvres principales.
- Inventaire des productions.
- Bibliographie.
Vendu.
[ROSNY JEUNE (J.-H., pseudonyme de Séraphin Justin François Boex)]. [Catalogue de vente de la] Bibliothèque Rosny Jeune. Samedi 13 mai 1950 à 2 heures précises. Bruxelles, Fernand Miette, 1950. In-8° (140 x 211 mm.) agrafé, 39 p., exemplaire complètement annoté (prix d'estimation - prix d'adjudication), rousseurs à la couverture, on joint la fiche de relevé des achats d'un amateur dénommé Lefevre pour le lot n° 33 (trois volumes d'Henri Béraud).
La vente eut lieu à la Galerie
Thémis, 13 boulevard de Waterloo à Bruxelles, par
le ministère de maître De Coen, huissier à
Bruxelles, elle comportait 287 lots de livres en éditions
originales, la plupart dédicacées.
J.-H. Rosny Jeune (Bruxelles, 1859 - Ploubazlanec,
1948) était de le frère de J.-H. Rosny Aîné
(l'auteur de La Guerre du feu). Tous les deux obtinrent
la nationalité française mais ne renoncèrent
pas à la belge ; ils siégèrent également
ensemble à l'Académie Goncourt dont ils furent chacun
à leur tour présidents.
20 euros (code de commande : 01881).
SCOHY (André) — L'Uélé secret. Photographies d'Henri Goldstein. Bruxelles - Léopoldville, Office International de Librairie - La Librairie Congolaise, 1955. In-8° (162 x 225 mm.) sous reliure toilée et jaquette illustrée d'éditeur, 178 p., nombreuses illustrations photographiques en noir hors texte.
Table des matières
:
Prologue.
Croisière sur les eaux du Congo.
Première partie. Aubades.
I. Les trois journées
du vieux Medjedje.
II. Un corps de ballet au
cœur de la forêt congolaise.
Deuxième partie. Les mystères
de l'Uélé.
I. À Dungu, au pied
d'un faux château médiéval, naît l'Uélé.
II. Aux cavernes historiques
de la Nembiliki.
III. Ekibondo, où les
murs veulent parler.
IV. Vers les signes mystérieux
du mont Ngundu.
Troisième partie. Peuples qui renaissent.
I. Variation Mangbetu.
II. Paysans Babua.
III. Terre Zande, aux âmes
taciturnes.
Quatrième partie. Huit jours chez les
lépreux.
I. L'odeur des léproseries.
II. Comment vivent les lépreux.
III. Guérit-on de la
lèpre ?
Épilogue. Délices de l'Uélé.
8 euros (code de commande : 01880).
SEARLE (John Rogers) — L'intentionalité. Essai de philosophie des états mentaux. [Titre original : Intentionality. An essay in the philosophy of mind.] Traduit de l'américain par Claude Pichevin. Paris, Minuit, 2008. In-8° (137 x 220 mm.) collé, 340 p., (collection « Propositions »), quatrième de couverture un peu souillée.
En quatrième
de couverture :
Exposé
d’une théorie générale de la « représentation »,
L'Intentionalité de John Searle ouvre un nouveau
front dans la controverse entre philosophes, psychologues cognitifs,
spécialistes de l'intelligence artificielle et des neurosciences
concernant le statut des états mentaux. Dans ses deux précédents
livres (Les Actes de langage et Sens et expression),
l’auteur proposait une perspective inédite d'analyse
du langage appelée à connaître une large notoriété.
Mais l'un comme l'autre affirmaient en même temps que la
philosophie du langage n'est pas autre chose qu'une branche de
la philosophie de l’esprit : les actes de langage sont
une des formes de l'action humaine et ne constituent qu'un des
exemples de la capacité immanente à l’esprit
de mettre l'organisme humain en rapport avec le monde. Le présent
ouvrage porte sur ces capacités biologiques fondamentales
et fournit par là même les justifications philosophiques
des deux autres. Considérée comme le trait radicalement
distinctif des phénomènes mentaux, l’intentionalité
fait l'objet d’un réexamen qui porte successivement
sur la perception, l'action, la causalité, le sens et la
référence. John Searle suggère en ces matières
des solutions originales (aussi peu conformes à la tradition
continentale des philosophies de la conscience qu'aux thèses
les plus courantes de la philosophie analytique anglo-américaine)
et expose en conclusion une « dissolution »
du problème des rapports entre le corps et l’esprit.
15 euros (code de commande : 01903).
[SOMVILLE
(Roger)]. Somville au Grand Hornu. Bruxelles,
Crédit Communal, 1988. In-4° (210 x 294 mm.) broché,
79 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, exemplaire
en très bon état.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée,
au Grand-Hornu, du 17 octobre au 13 novembre 1988.
En quatrième de
couverture :
Somville
(Roger), peintre belge (Bruxelles 1923). Dès les années
50, il affirme un style expressif et monumental, attentif aux
réalités du monde contemporain et inspiré
à la fois par les muralistes mexicains et par le Picasso
de l'après-cubisme (le Mineur bleu, 1955, Ermitage,
Leningrad ; le Café de nuit, 1966, coll. de
l'État belge). Préoccupé de l'aspect social
de la peinture, il prend une part active au renouveau, en Belgique,
de la tapisserie, de la céramique et de la peinture murale
(mural Notre temps, métro de Bruxelles, 1974-1976).
Fondateur du « Mouvement réaliste »
(1968), il est l'auteur d'un livre-manifeste, Pour le réalisme,
un peintre s'interroge (1970).
(Grand Dictionnaire Encyclopédique
Larousse, édition 1985.)
Table des matières :
- Un homme et son œuvre,
par Gita Brys-Schatan.
- Somville et l'architecture, par
Henri Guchez.
- Somville en Borinage, par Maurice
Willam.
- Catalogue.
- Le Borinage.
- Rétrospective.
- Quelques repères.
Vendu.
aura lieu
le mardi 7 janvier 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone ou sms (+32 (0) 472 51 52 63).
Ces livres peuvent être retirés à l'adresse figurant dans l'en-tête du blog.
En cas d'envoi postal, veuillez indiquer le pays vers lequel le colis devrait être expédié, cela me permettra de vous indiquer les modalités de livraison et de paiement.























.jpg)