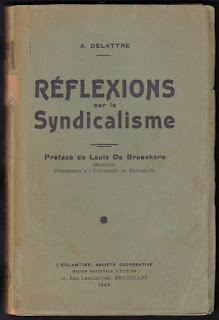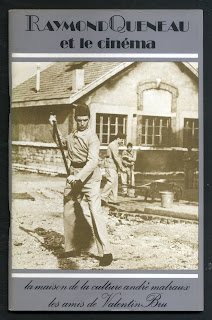MISE À JOUR DU 27 MAI 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone (+32 (0) 472 51 52 63)
pour obtenir d'autres informations à propos de ces livres.
ANSIEAU
(Cécile) et WATERLOT (Bernard) — Tous les chemins
mènent au Vodgoriacum. La représentation de la Gaule
et des chaussées romaines au travers des cartes anciennes.
Mons, Éditions Musea
Nostra, 2025. In-8° (200 x 271 mm.) collé, 48 p.,
illustrations en couleurs, 15 cartes à déplier.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
par l'A.S.B.L. Statio Romana, au Musée Gallo-Romain de
Waudrez, du 8 avril au 2 novembre 2025.
En quatrième de
couverture :
Malgré
son grand âge, la chaussée qui mène de Bavay
à Cologne, vestige archéologique antique, reste
bien inscrite dans le paysage de la Wallonie depuis plus de 2000
ans. De nombreuses fois remaniée, elle a été
utilisée au fil des siècles et continue à
l’être de nos jours sur de nombreux tronçons.
Le vicus de Vodgoriacum attesté
sur les itinéraires romains, aujourd’hui Waudrez près
de Binche, constitue la première station située
à une trentaine de kilomètres de la capitale des
Nerviens, Bavay.
Le Centre d’interprétation de la
Chaussée Romaine qui est installé au cœur même
du Vodgoriacum nous semblait l’endroit idéal pour
montrer au public comment cette importante voie de communication
et les agglomérations qui la jalonnent étaient représentées
dans la cartographie des XVIIe et XVIIIe siècles.
L’exposition qui a donné lieu à
cette modeste publication suscitera, nous l’espérons,
le développement d’un travail plus important afin
d’approfondir un sujet inédit et riche d’enseignement
historique...
25 euros (code de commande : 02198).
Archives et Bibliothèques de Belgique - Archief- en Bibliotheekwezen in België. Tome LXXVI - N° 1-4. Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, 2005. In-8° (160 x 240 mm.) broché, 247 p., quelques illustrations, exemplaire en parfait état.
Table des matières
:
- Centrale en gewestelijke besturen
en hun aankopen en bestellingen bij boekhandelaars en -drukkers
(16de eeuw), par Edmond Roobaert.
- Quelques documents d'archives concernant
des artistes, artisans et architectes de la première moitié
du XVIIIe siècle, par Anne Buyle.
- Un explorateur-naturaliste «
belge » en Amérique du Nord : les voyages oubliés
de Martin Maris (1810-1868), par Denis Diagre-Vanderpelen.
- « Propre à donner une
idée de mon savoir-faire» : een onbekende briefvan
Jan Frans Willems aan Karel Van Hulthem (1827), par Jan
Pauwels.
- Une décolonisation sous tutelle
: les militaires belges et le transfert de souveraineté
au Rwanda (1959-1963). Quelques réflexions à la
lueur de sources inédites, par Jean-Noël Lefèvre.
- Les archives hongroises au début
du 21e siècle : efforts de modernisation, par Lajos
Körmendy.
15 euros (code de commande : 02341).
[BELGIQUE
- RÉSEAU ROUTIER]. Esso Magazine. N° 4
- 1963. Anvers, S.A. Esso
Belgium, 1963. In-4° (235 x 300 mm.) agrafé, 33 p.,
illustrations photographiques en noir et cartes en couleurs, exemplaire
en bon état.
À la
grande époque de « Ma voiture, ma liberté »
!
Sommaire :
- Conceptions
actuelles de l'aménagement et du développement du
réseau routier belge.
- L'Autoroute de Wallonie.
- La concession de l'autoroute E3.
- Le laboratoire et la route.
- Les couleurs et la route.
6 euros (code de commande : 02318).
BERTIN
(Charles) — Je reviendrai à Badenburg. Bruxelles, André De Rache, 1970. In-8°
(170 x 253 mm.) broché sous couverture à rabats,
68 p., exemplaire numéroté sur Da Costa (n° 068),
en très bon état.
Cette pièce
a été créée le 10 février 1970,
au Palais des beaux-Arts de Bruxelles, par le Compagnie du Rideau
de Bruxelles (mise en scène de Pierre Laroche et Robert
Delieu).
L'écrivain
montois Charles Bertin (1919-2002) était le neveu de
Charles Plisnier. À l'exception des années 1925-1931
qu'il passa à Boussu, sa jeunesse se déroula à
Mons où il fréquenta l'Athénée pour
y suivre les humanités gréco-latines ; ensuite
à l'Université Libre de Bruxelles il fit des études
de droit. Il s'inscrivit au Bareau de Mons qu'il quitta rapidement
pour s'installer à Bruxelles et y mener une carrière
administrative. Il demeura très attaché à
sa ville natale et fut l'auteur en octobre 1969 d'un article publié
dans Le Soir intitulé « Le saccage de
Mons » dans lequel il dénonçait le naufrage
de la politique urbanistique de sa ville : ce fut l'acte
fondateur de l'association « Sauvegarde et Avenir de
Mons ». Tous les détails sur sa riche carrière
littéraire figurent dans l'ouvrage de Jeannine Abrassart :
Lettre lumeçonnes.
Extrait de l'article d'André Paris :
Un « message » inédit ?
Une « révélation » formelle ?
Non, il ne faut point chercher dans cette nouvelle pièce
de Charles Bertin ce qu'il n'a sans doute pas voulu y mettre.
Même si le spectacle est joué « en rond »
et apparaît assez insolite. C'est avant tout un jeu, tantôt
ironique, tantôt plus grave, souvent teinté d'une
poésie d'inspiration fort classique. Un jeu où la
fantaisie est mesurée et la dérision pesée
avec soin, mais où, par contre, la prolixité des
personnages n'a pas de frein.
Le thème ? C'est le plus ancien
du monde et le plus taraudant (quand on n'a plus vingt ans) :
la peur et la révolte de l'homme devant la mort. Le prétexte ?
L'aventure vécue d'un guérisseur allemand qui avait
acquis une popularité extraordinaire au lendemain de la
guerre. Quant à la forme, elle s'inspire parfois du mouvement
et de certains procédés de la commedia dell'arte.
Tout commence comme tout finira, car la pièce
dessine une boucle aussi parfaite que le cercle du public autour
de l'aire de jeu. Sur la route, à Badenburg, petit village
de Bavière, un étranger gît, malade, usé.
Qui est-il ? Pourquoi a-t-il employé ses dernières
forces à atteindre cette localité où nul
ne le connaît ? Quatre personnages jacassants, insolents,
habiles à se métamorphoser : Ernst, Mick, Pim
et Pam, se posent et nous posent ces questions, auxquelles ils
vont d'ailleurs se donner la joie de répondre... en action.
Ce sont, en effet, quatre serviteurs d'une dame
sage, aimable, compréhensive : la Mort. Celle-ci demande
à l'agonisant s'il veut sa « chance de lucidité ».
Il accepte. La dame et les valets lui montrent alors les visages
de sa vie et jouent, avec sa complicité, quelques épisodes
cruciaux de l'ascension et de la chute du « docteur »
Breuning, le fameux magnétiseur qui a guéri des
milliers d'Allemands et qui était devenu une sorte d'idole.
Et pourtant, ce « Docteur Miracle »
ne paie pas de mine. C'est un petit homme inculte, insignifiant,
d'apparence minable, avec un air de clown triste. Un charlatan,
un illuminé, un profiteur ? Au fur et à mesure
des scènes qui se déroulent en désordre chronologique,
nous le verrons atteindre peu à peu « sa »
vérité. Traumatisé, enfant, en découvrant
que sa petite compagne de jeu avait failli mourir tout à
coup sous ses yeux, il devient guérisseur précisément
par peur de la mort, pour nier sa propre mort. Sa seule force,
ce sera la foi que les faibles ont en lui. Sa patrie, c'est chaque
homme qui souffre. Il rend la santé à plus de 16.000
personnes. Mais les 70.000 médecins d'Allemagne se dressent
contre lui. Il est condamné. Abandonné par tous
ses collaborateurs, sauf par sa secrétaire, qui n'a cessé
de l'aimer, il erre à travers le pays. Jusqu'à ce
Badenburg où il est né, où il échoue
et où il a une révélation toute simple :
le bonheur, c'est la vie !
Bibliographie :
- Paris (André), « Je
reviendrai à Badenburg. Un jeu allègre sur fond
tragique », dans Le Soir, jeudi 12 février
1970.
- Abrassart (Jeannine), Lettres lumeçonnes.
Bio-bibliographie montoise : répertoire alphabétique
des auteurs nés, résidant ou ayant vécu à
Mons, 2012, t. I, pp. 72-77.
12 euros (code de commande : 02328).
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. 6e série - Tome VIII. Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1997. Deux volumes in-8° (161 x 246 mm.) brochés, 607 p., quelques illustrations.
Table des matières
:
Séance
du lundi 6 janvier 1997.
- Procès-verbal
(pp. 5-11).
- Exposé : Les
avatars de la conscience, par Marc Richelle (pp. 13-47).
Séance dit lundi 3 lévrier
1997.
- Procès-verbal
(pp. 49-58).
- Éloge : Orner
Jodogne 1908-1996, par Albert Henry (pp. 59-65).
- Présentation
d'orateur : Jean-Pierre Nandrin, par Philippe Godding
(pp. 67-68).
- Exposé : Justice,
magistrature et politique aux premiers temps de l'indépendance
de la Belgique, par Jean-Pierre Nandrin (pp. 69-111).
Séance du lundi 3 mars 1997.
- Procès-verbal
(pp. 113-116).
- Présentation
d'orateur : Alain Martin, par Jean Bingen (pp. 117-119).
- Exposé : D'Achmîm
à Strasbourg, sur les traces d 'Empédocle, par
Alain Martin (pp. 121-137).
Séance du lundi 24 mars 1997.
- Procès-verbal
(pp. 139-142).
Séance du lundi 5 mai 1997.
- Procès-verbal
(pp. 143-146).
- Éloge : Paul
De Visscher. 1916-1996, par François Rigaux
(pp. 147-165).
- Exposé : Compétition,
mondialisation et politiques de concurrence, par Alexis
Jacquemin (pp. 167-184).
Assemblée générale des
trois Classes du samedi 10 mai 1997.
- Procès-verbal
(pp. 185-187).
- Rapport annuel : Action
et Activités de l'Académie de mai 1996 à
avril 1997, par Philippe Roberts-Jones (pp. 189-205).
- Rapport annuel : Activités
de Commission de la Biographie nationale de mai 1996 à
avril 1997, par Jean-Marie Duvosquel (pp. 207-209).
Séance publique du lundi 12 mai 1997.
- Procès-verbal
(pp. 211-212).
- Discours : Statutaire,
histoire et politique au 19 siècle, par Philippe
Godding (pp. 213-240).
- Lecture : Un dossier
mystérieux : Les origines de Bruxelles, par Georges
Despy (pp. 241-303).
- Proclamation (pp. 305-308).
- Nécrologe (p.
309).
- Élections (p.
310).
- Concours annuel de
1997 : rapports des Commissaires (pp. 311-326).
- Prix et Fondations
académiques : rapports des jurys (pp. 327-328).
Séance du lundi 2 juin 1997.
- Procès-verbal
(pp. 329-330).
- Réception d'associé
: Thierry de Montbrial, par Philippe de Woot (pp.
331-334).
- Résumé
d'exposé : Nouvelles dimensions de la politique internationale,
par Thierry de Montbrial (pp. 335-337).
- Communication : Lecture
de Aube, par Albert Henry (pp. 339-352).
Séance du lundi 7 juillet 1997.
- Procès-verbal
(pp. 353-357).
- Hommage : Robert
Henrion, par Philippe Godding (p. 359).
- Rapport de mission
: 6e Congrès international d'Histoire de la Science
arabe. Ras-al-Khaimah, 16-20 décembre 1996, par André
Allard (pp. 361-363).
- Compte rendu de
la 71e session annuelle du Comité de l'Union académique
internationale (Jérusalem, du 15 au 20 juin 1997),
(pp. 365-502).
Séance du lundi 6 octobre 1997.
- Procès-verbal
(pp. 505-508).
- Hommage : Jules
Labarbe (1920-1997), par Philippe Godding (p. 509).
- Hommage : Veiko Vää,änen
(1906-1997), par Philippe Godding (p. 511).
- Exposé : Nomen
est omen. Du bon usage des noms propres dans le théâtre
de langue anglaise, par Gilbert Debusscher (pp. 513-539).
Séance du lundi 3 novembre 1997.
- Procès-verbal
(pp. 541-545).
- Présentation
d'orateur : Marianne Blomqvist, par Philippe Roberts-Jones
(pp. 547-548).
- Exposé : Les
noms, un miroir de la société, par Marianne
Blomqvist (pp. 549-557).
- Rapport de mission
: Le Tenessee Williams New Orleans Literary, par Gilbert
Debusscher (pp. 559-562).
Séance du lundi 1er décembre
1997.
- Procès-verbal
(pp. 562-566).
- Éloge :
Georges Duby (1919-1996), par Jacques Stiennon (pp.
567-576).
- Présentation
d'orateur : François Bédarida, par Jean
Stengers (pp. 577-580).
- Exposé : Y
a-t-il une crise dans l'histoire de France ?, par François
Bédarida (pp. 581-594).
Table analytique.
Table onomastique.
Les deux volumes : 15 euros (code de commande : 02356).
[CATALOGUE DE VENTE DE LIVRES]. Catalogue
de livres en plusieurs langues et facultés, consistant en livres de théologie, histoire,
belles-lettres, jurisprudence, histoire naturelle, voyage, livres
d'estampes etc. Dont la vente se fera publiquement par le ministère
du notaire Ghellynck dans la Salle ordinaire à la maison
commune à Courtrai, le 14 décembre 1814 et jour
suivant, le matin à 9 et l'après-midi à deux
heures juste, en francs et centimes avec augmentation du vingtième
denier, payable au Sieur J. Verbeke. Sous la direction de Louis
Blanchet, libraire. Courtrai,
Blanchet, 1814. [A Courtrai,
/ Chez Louis Blanchet, Imprimeur-Libraire, rue de la Lys. / Prix,
10 centimes ou un sou pour les Pauvres.]
In-8° (143 x 222 mm.) broché, 34, [2 bl.] p.,
exemplaire à toutes marges et en bon état, rare.
Les 440
ouvrages décrits sont classés en trois catégories
: les in-octavo (284), les in-quarto (74) et les in-folio (82).
15 euros (code de commande : 02342).
[COLLIN
(Isi)]. RIZZARDI (Luca) — Isi Collin. Anvers, Éditions Générales
d'Imprimerie, 1936. In-8° (120 x 187 mm.) broché,
147 p., illustrations hors texte.
Un ouvrage peu
courant sur le journaliste liégeois que fut Isi Collin
(Liège, 1878 - Uccle, 1931) qui signait ses billet dans
Le Soir du pseudonyme de Compère Guilleri.
Extrait :
L'œuvre
d'Isi Collin est relativement peu copieuse : quelque quarante
poèmes, réunis en deux plaquettes, un conte :
« Pan ou l'Exil littéraire », qu'il
publia tout d'abord sans nom d'auteur ni d'éditeur, mais
qui fut réédité plus tard sous le titre :
« La Divine Rencontre », une pièce
en un acte : « Sisyphe et le Juif Errant »,
qui n'était pas destinée à la représentation,
encore qu'elle puisse être un excellent spectacle pour théâtre
en plein air, un récit de voyage : « Quinze
âmes et un Mousse », qu'il publia sous la forme
de livre parce que le journal, pour lequel il avait fait ce reportage
d'une campagne de pêche dans la mer Blanche, tardait à
donner les articles qu'il lui avait remis, et, enfin, ce livre
posthume : « L'Almanach de Compère Guilleri »,
qui est un choix, assez rapide, des billets que, pendant vingt-cinq
ans, Collin écrivit quotidiennement pour divers journaux.
C'est un bagage assez maigre pour une existence
littéraire de plus de trente ans. Mais la valeur d'un écrivain
ne se mesure pas à l'abondance de son œuvre.
Au surplus, ce ne fut pas exclusivement la faute
de Collin s'il ne se manifesta pas davantage aux vitrines des
librairies.
L'impossibilité pour un écrivain
de vivre de sa plume en Belgique, les difficultés de l'édition
qui, non seulement, ne laisse aucun bénéfice à
l'auteur, mais souvent lui coûte de l'argent, l'ont contraint
à choisir quelque carrière administrative ou, par
une illusion qui est tôt détruite, à devenir
rédacteur de journal.
C'est un journalisme assez vieillot, solennel
et provincial. Il obligera l'écrivain de talent à
des besognes qui, sous l'aspect où on les conçoit,
eussent pu être confiées à n'importe quel
Monsieur prudhomme. Empêchés de traduire librement
une pensée, soumise à une foule de contingences,
mais, surtout, à un faux sérieux qui dissimule une
indigence d'esprit, il sera voué à des comptes-rendus
de cérémonies où la citation des noms des
personnalités – ainsi nommées, sans doute,
parce qu'elles en sont dépourvues –, « qui
les honorent de leur présence », aura bien plus
d'importance que la traduction juste de leur atmosphère.
On lui apprendra le respect apeuré des situations acquises,
des idées reçues et une façon de s'exprimer
qui n'obligera pas le lecteur, au vocabulaire assez indigent,
à réfléchir. Mais, par-dessus tout, il ne
devra pas avoir d'opinion, car les journaux belges, comme le pays,
ne devancent pas l'opinion, ils la suivent, et, encore, très
prudemment, de loin !
Quelques années de ce régime suffisent
à créer un être conforme à la médiocrité
générale, mais assuré de sa haute mission.
Par un miracle rare, Isi Collin y échappa.
Mais, si on lui permit d'écrire ses « petites
fantaisies », ce fut par surcroît, et à
la condition expresse qu'elles ne nuiraient pas au travail « sérieux ».
Et c'est ainsi que le poète si délicat, le délicieux
fantaisiste, l'écrivain qui aurait pu traduire, d'une façon
à la fois si originale et si profonde, les aspects du temps
où il vécut, fut surtout occupé à
noter des noms de faux grands hommes et leurs discours dont le
ridicule les eût tués si le belge avait le sens du
ridicule.
25 euros (code de commande : 02322).
DEBLICQUY
(Nicolas-A. de) — Almanach pour 1881. La mort de Christophe
Colomb drame-opéra en vers, par N.-A. De Bliquy, auteur
des Mariana et poésies diverses. Mons,
Thiemann, [1881]. [Mons,
/ Imp. mée. d'Alfred Thiemann, rue d'Havré, 134.] In-8° (122 x 172 mm.) broché,
50 p., envoi de l'auteur à Alphonse Lalinne, ex-libris
partiellement arraché de Dequesne-Masquillier.
Une très
rare édition montoise.
Jeannine
Abrassart nous indique qu'« on sait peu de choses sur
ce poète né à Mons le 12 mai 1839. Il était
employé à l'Administration des Hospices civils et
collaborait à La Gazette de Mons et à La
Tribune.
L'éditeur Alfred Thiemann commença
son activité d'imprimeur en 1856 lorsqu'il reprit l'établissement
typographique d'Henri Chevalier. Il avait acquis son expérience
en travaillant pendant dix-huit ans chez l'imprimeur Monjot dont
il racheta le matériel en 1873.
Quant au dédicataire, Alphonse Lalinne,
il naquit à Mons en 1865 et fut employé aux Hospices
Civils de Mons ; il était donc un collègue
de l'auteur.
Bibliographie :
- Abrassart (Jeannine), Lettres lumeçonnes.
Bio-bibliographie montoise : répertoire alphabétique
des auteurs nés, résidant ou ayant vécu à
Mons, 2012, t. I, p. 88.
- Poncelet (Édouard) et Matthieu
(Ernest), Les imprimeurs montois, p. 185.
Vendu.
DELATTRE (Achille) — Réflexions sur le syndicalisme. Préface de Louis De Brouckère. Bruxelles, L'Églantine, 1926. In-8° (120 x 182 mm.) broché, 272 p.
Avant-propos :
L'étude
qui va suivre n'a pas la prétention d'être complète,
le syndicalisme est devenu une science si profonde qui offre aux
observateurs et aux chercheurs un terrain si considérable
d'étude, de remarques et d'enseignement.
Mais au cours de notre collaboration à
la modeste revue « L'Aurore », nous avons reçu
tant d'approbations et d'encouragements que nous avons pensé
que peut-être la réunion de nos réflexions,
leur diffusion parmi les militants et la masse et même aussi
parmi les personnes qui veulent s'attacher à ce problème
nouveau du syndicalisme contribueraient peut-être à
faciliter, à aplanir la route du syndicalisme lui-même
en facilitant, si peut soit-il, la tâche de ses défenseurs,
de ses protagonistes et de ses sympathisants.
Notre étude a été faite
plus ou moins à bâtons rompus : nous avons commenté
des faits, traité des idées, critiqué des
opinions, étudié des institutions, etc., mais toujours
dans le cadre du syndicalisme et avec la pensée de sonder,
de creuser cette science nouvelle en apparence mais aussi vieille
cependant que la pensée même de l'homme.
Ceux qui voudront bien nous lire nous trouveront-ils
intéressant ? Je me garderai de répondre à
cette question : les intéressés se donneront
la réponse à eux-mêmes et quand elle sera
défavorable qu'ils me pardonnent en pensant que mon but
a été de servir notre classe dans sa lutte pour
un meilleur devenir.
15 euros (code de commande : 02345).
[DELTEIL (Joseph). DROT (Jean-Marie) — Vive Joseph Delteil. Paris, Éditions Stock, 1973. In-8° (132 x 205 mm.) broché, 257 p., illustrations, (collection « Dire / Stock 2 - Livre Caméra »).
En quatrième
de couverture :
Jean-Marie
Drot : né le 2 mars 1929 à Nancy. Écrivain,
poète, homme de télévision, grand voyageur,
gourmand et gourmet.
Ce Vive Joseph Delteil répond
aux Temps des Désillusions, livre publié
également chez Stock il y a deux ans : « Comment
réinventer à notre époque une vie autre ? ».
Peut-être, Joseph Delteil, écrivain
paléolithique... (Prix Femina pour sa Jeanne d'Arc)
et fils de bouscassier le sait-il, lui, que rien ni personne n'a
jamais pu asservir.
Ce Livre-caméra est aussi une
nouvelle lecture d'un film réalisé pour la télévision
française et diffusé au printemps 1972 sur la deuxième
chaîne couleur.
Bref, ce Vive Joseph Delteil raconte
par photos, textes, dialogues et documents, l'histoire d'une complicité
amicale entre deux générations, entre deux hommes,
l'un et l'autre convaincu que : « La civilisation à
l'américaine voilà l'ennemi ».
14 euros (code de commande : 02334).
DEPASSE (André) — Jemmapes 1792-1992. S.l., Chez l'Auteur, 1991. In-8° (157 x 224 mm.) broché, 220 p., illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en bon état.
Table des matières
:
1.
Avant-propos.
2. La bataille.
1. Engagement de Boussu.
2. Rappel de la bataille de
Jemappes.
3. Évocation de la
personne de Dumouriez.
4. Des militaires d'origine
belge dans l'armée française.
5. Essai de réhabilitation
de Dumouriez.
3. Souvenirs de la bataille. Évocation
par...
1. Les sculpteurs.
2. Un petit tour en Autriche.
3. Retour en Belgique et en
France.
4. Les écrivains.
5. La musique.
6. L'affiche.
7. Les peintres.
8. L'armée française.
Les drapeaux.
4. Le monument de Jemappes.
1. L'idée.
2. Les Amitiés françaises.
3. L'inauguration de 1911.
4. Et l'opposition...
5. La guerre 1914-1918.
1. La destruction.
2. Jemappes et la guerre.
3. La reconstruction, l'inauguration
de 1922.
6. La guerre 1940-1945.
7. Les commémorations.
1. Aspect particulier du 160e
anniversaire.
2. Et l'opposition...
3. Autres commémorations
et le Coq aujourd'hui.
8. Les morts de la bataille.
1. Le vide autour de leur
mémoire.
2. Questions et réponses
au sujet des fosses communes.
9. Supplément inédit. Histoire
de la bataille par ceux qui y prirent part.
10. Conclusion.
11. Bibliographie.
- Tables.
Vendu.
[DEPOOTER (Frans)]. CASO (Paul) — Frans Depooter. La profondeur vitale de l'Art. Bruxelles, Les Éditeurs d'Art Associés, 1981. In-4° (219 x 278 mm.) sous cartonnage d'éditeur, 94 p, illustrations en noir, quelques-unes en couleurs, (collection « La Mémoire de l'Art »), exemplaire en très bon état auquel on joint le petit catalogue de la Rétrospective Frans Depooter. 60 ans de peinture en 80 tableaux organisée à Wavre du 23 novembre au 2 décembre 1990 (12 p.).
En quatrième
de couverture :
Témoin
attentif de trente années de vie artistique, auteur d'une
vingtaine de monographies, [Paul Caso] le critique du Soir n'a
cessé d'exercer une tutelle bienveillante sur plusieurs
générations de peintres belges.
Bien que Frans Depooter [Mons, 1898 - Maffe,
1987] fût largement son aîné, l'ancien compagnon
de Paulus et d'Anto-Carte l'a choisi pour présenter une
œuvre qui s'étend sur plus de soixante ans et qui,
insensible aux modes, aux expériences, aux tendances divergentes
de la création esthétique, séduit, aujourd'hui
comme naguère, par sa sérénité, non
dépourvue d'un secret frémissement.
20 euros (code de commande : 02337).
[GRAVURE - PAYS-BAS - GRONINGEN].
Groningen, door den Graave van Rennenberg, aan de Spaansche
zyde overgebragt, in 't jaar 1580. Illustration
de Simon Fokke, datée de 1753, gravée par Isaak
Tirion, extraite de l'édition de 1770 de l'ouvrage de Wagenaar :
Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
nu Vereenigde Nederlanden...
Dimensions :
- Dessin
: 193 x 153 mm.
- Cuvette : 205 x 175 mm.
- Feuille : 227 x 200 mm.
Un événement
de l'histoire des Pays-Bas connu comme la « trahison de
Rennenberg ».
En
1580, Georges de Lalaing, plus connu aux Pays-Bas sous le titre
de comte de Rennenberg, abandonna la cause de Guillaume d'Orange
– qui, en 1577, l'avait nommé « stathouder »
des provinces du Nord – et remit la ville de Groningue
dans les mains des Espagnols.
Bibliographie :
- Kooistra (Lidia), « Stad Groningen
belangrijk schaakstuk bij Nederlandse Opstand », ressource
en ligne sur le site De
Verhalen van Groningen.
Vendu.
HEANEY (Seamus) — La Lanterne de l'aubépine. [Titre original : The Haw Lantern.] Traduit de l'anglais et préfacé par Gérard Cartier. Pantin, Le Temps des Cerises, 1996. In-12 (120 x 170 mm.) collé, 94 p., exemplaire en très bon état avec la bande d'annonce du Prix Nobel de littérature.
En quatrième
de couverture :
Seamus
Heaney est le poète de l’Ulster. Il a su, dans une
œuvre, à la fois savante et accessible où résonne
l’écho du destin de l’île, faire de son
univers personnel un élément de la mythologie nationale
des Irlandais. Ce livre en porte témoignage.
En 1995 lui a été décerné
le prix Nobel de littérature.
6 euros (code de commande : 02332).
HOEX (Corinne) — Saint Walhère. Culte - Vie - Iconographie. Gembloux, Duculot, 1974. In-8° (146 x 215 mm.) broché, 55 p., illustrations hors texte, (collection « Wallonie, Art et Histoire », n° 21).
Extrait :
« En l'an 1669, au mois d'août,
le jour de saint Bartholomé, le vicaire de Marche-en-Famenne
vint à Onhaye accompagné de quinze ou vingt paroissiens
; chez eux plus de cent vingt têtes de bétail étaient
mortes et beaucoup d'autres malades et, comme ils avaient envoyé
en vain des suppliques à certains saints et notamment à
saint Hubert en Ardenne, ils se tournèrent finalement vers
saint Walhère sur le conseil de l'abbé de Saint-Hubert,
qui leur avait même adjoint deux de ses religieux comme
compagnons de pèlerinage afin qu'ils apportassent l'offrande
d'une neuvaine. Ils affirmèrent que, de ce fait, depuis
l'année 1671, la mortalité des animaux avait cessé
chez eux et que toutes les bêtes malades avaient guéri.
Ainsi écrivit et confirma de sa signature celui qui fut
le précédent curé d'ici (Onhaye), D. Jean
Auxbrebis. »
Saint Walhère, figure peu connue de la
liturgie officielle, mais vénérée dans une
grande partie des campagnes wallonnes autour d'Onhaye, est illustré
par cet extrait des Acta Sanctorum dans son rôle
essentiel, celui de protecteur du bétail. De longue date,
le pèlerinage d'Onhaye attire les éleveurs désarmés
face aux ravages des épizooties. Le texte que nous venons
d'aborder atteste dès 1669 l'existence de ce pèlerinage,
renforcé par une neuvaine. Les bienfaits de Walhère
jouissaient alors d'une renommée capable de rivaliser avec
celle de saint Hubert même et de la supplanter pour ce qui
concerne spécifiquement l'espèce bovine. On n'hésitait
pas à parcourir la distance qui sépare Marche-en-Famenne
d'Onhaye pour venir confier au saint sa requête.
8 euros (code de commande : 02326).
HOVERLANT DE BEAUWELAERE (Adrien Alexandre Marie) — Essai chronologique pour servir à l'histoire de Tournay, par M. Hoverlant, Ex-Législateur, avec le portrait de l'Auteur. Tome XXIV. Supplément. Courtrai - Lille, Chez l'auteur - Dumortier, 1807. [A Courtray, / Chez l'Auteur, rue de Tournay, / Section St. George, N.° 648. / Et à Lille, chez P. Dumortier, / Imprimeur-Libraire rue des Manneliers. / (M. D. CCC. VII.)] In-8° (105 x 160 mm.) sous son brochage d'attente, 312 p., exemplaire non coupé.
Il s'agit du tome XXIV, seul, du gigantesque ouvrage d'Hoverlant dont la publication débuta en 1805 et s'acheva en 1834, elle est complète en 105 tomes.
20 euros (code de commande : 02346).
KŒNIG (Théodore) — Remblées. Précédé d'« Anagrammaire » par Alain Borer. Paris, Cheval d'Attaque, 1979. In-8° (134 x 205 mm.) broché, 141 p., couverture jaunie et défraîchie, édition originale.
En quatrième
de couverture :
Avec
Remblées, mot-valise qui endosse plusieurs significations,
on assiste à l’assemblée rafraîchissante
et comme écologique de diverses formes de l’écriture.
Précédé d’une étude d’Alain
Borer, ce livre constitue l’édition originale collective,
complétée d’inédits, de recueils à
tirage restreint, devenus parfaitement introuvables.
Notre logosphère reçoit ici l’impact
d’une ironie désinvolte, étroitement surveillée
par l’auteur qui a décidé d’écrire
là où un autre poète belge, Paul Colinet,
voyait la « communication directe avec les abîmes
de la sensation ». Formule qui caractérise fort
bien, par ailleurs, la conception de l’aphorisme de Kœnig
et de ses nombreuses notes a-critiques.
Théodore Kœnig est aussi l’animateur
de Phantomas, la « plus belle revue du monde ».
13 euros (code de commande : 02338).
[LANDUYT
(Octave)]. Octave Landuyt. Textes
de Jean Dypréau et A.L.J. Van de Walle. Gent,
Stadsbestuur van Gent, 1973. Grand in-4° carré (343
x 367 mm.) sous cartonnage illustré d'éditeur, [44] p.,
illustrations en noir, édition trilingue (néerlandais,
français, anglais), exemplaire en parfait état.
Cet ouvrage
a été édité à l'occasion de
l'exposition organisée au Centrum voor Kunst en Kultuur
gewezen St-Pietersabdij, à Gand, du 21 juin au 16 septembre
1973.
Extrait du texte de Jean
Dypréau :
Il
est rare que l'on se souvienne vingt ans plus tard de la toile
d'un jeune peintre entrevue lors d'une exposition d'ensemble,
de son emplacement précis sur la cimaise, comme de tous
les détails de sa composition. Je suis convaincu cependant
que je ne suis pas le seul dans ce cas : il s'agit en l'occurrence
de l'envoi que fit Octave Landuyt en 1953 au Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles pour le Prix de la Jeune Peinture.
Je n'ai pas oublié non plus le commentaire
élogieux que m'en fit un peintre qui était déjà
engagé dans une voie toute différente de la sienne,
celle de l'abstraction. À ce moment-là, les mots
« angoisse existentielle » n'étaient
pas encore galvaudés par un usage abusif et ils définissaient
avec pertinence le sentiment que cette toile nous faisait ressentir.
Inquiétude physique et inquiétude métaphysique
conjuguaient leurs maléfices dans ces visages de visionnaires
transis. Dans leurs regards apeurés qui interrogeaient
le ciel, on trouve un écho du grand effroi qu'éprouva
l'humanité après les explosions nucléaires
de Nagasaki et d'Hiroshima. On y trouve aussi la quête pitoyable
de ces êtres difformes sur la cause de leur damnation.
L'anxiété, l'épouvante,
l'horreur, resteront les thèmes favoris d'un peintre qui
n'acceptera d'en atténuer l'expression qu'en créant
entre eux et nous cette distance que la luxuriance, voir la séduction
du matériau, parvient à conférer à
ses plus tragiques apparitions.
Son but ultime ne serait-il pas de nous proposer
des manières de totems chargés de conjurer le sort,
d'éloigner le malheur par la projection de son image et
par la personnification d'un destin inexorable, de tromper le
ciel au profit de ses victimes désignées ?
Alors que pour beaucoup d'artistes, l'abstraction
fut un itinéraire de fuite devant une réalité
qu'ils redoutaient d'affronter, Octave Landuyt, comme l'Oreste
de Sartre dans « Les Mouches », tente peut-être
à sa façon de libérer la cité de la
colère des dieux.
Car, au-delà des faces monstrueuses et
des incicatrisables cancers, sont évoqués le luxe,
le calme et la volupté.
25 euros (code de commande : 02329).
LE BAIL (Anselme) et BOCK (Colomban) — Un siècle de vie monastique. Abbaye de Scourmont. Forges-lez-Chimay, Édition de l'Abbaye de Scourmont, 1950. In-8° (132 x 208 mm.) broché, 131 p., illustrations hors texte, exemplaire en bon état.
Table des matières
:
Chapitre
I. Aperçu historique sur l'Ordre de Cîteaux.
Chapitre II. Un siècle d'histoire
de Sourmont.
Chapitre III. La vie cistercienne.
Liste des monastères de l'Ordre des Cisterciens
de la Stricte Observance.
Appendice : Bibliotheca succurmontensis.
Vendu.
LEGGE (Jacky) — Le cimetière du Nord à Tournai. Des sépultures et des funérailles de la rive droite de l'Escaut. Postface par Xavier Deflorenne. Tournai, Maison de la Culture de Tournai - Présence et Action Culturelles, 1999. In-4° (239 x 296 mm.) broché, 112 p., nombreuses illustrations en noir.
En quatrième
de couverture :
Cet
ouvrage propose un itinéraire de découverte du patrimoine
du cimetière du Nord, à Tournai.
À travers la sélection d'une cinquantaine
de tombes, l'étude aborde les caractéristiques architecturales,
le registre symbolique et héraldique, l'évolution
des épitaphes ainsi que l'histoire de la nécropole.
Les éléments biographiques tentent
de cerner brièvement la vie des personnes inhumées.
Ils détaillent plus longuement les funérailles dont
les composantes se sont énormément simplifiées.
Des photographes ont eu carte blanche pour donner
leur vision de cet espace destiné au souvenir et au recueillement :
Bernard Bay, Yves Boucau, Damienne Flipo et Bruno Lestarquit.
Il en fut de même avec le dessinateur Luc Denis ou les auteurs
René Godet et Michel Voiturier.
Une postface de l'historien de l'art Xavier
Deflorenne offre une perception globale du patrimoine funéraire
relevé dans cette étude.
Vendu.
LEWUILLON (Ivan) — La chapelle funéraire des seigneurs de Boussu. Boussu, Comité Culturel de Boussu, 1977. In-8° (144 x 223 mm.) agrafé, 52 p., illustrations photographiques de Daniel Maroil, exemplaire en bon état.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- Un peu d'histoire.
- L'extérieur.
- L'intérieur.
- La crypte.
- Bibliographie.
Vendu.
[MONS - CANAL DE MONS À CONDÉ]. Carte postale sans nom d'éditeur ni de date, au format 138 x 87 mm.
Cette rare carte montre une vue de
l'écluse n° 1 du canal de Mons à Condé,
prise depuis le bassin de Cuesmes vers la ville de Mons.
Cette écluse se trouvait à la sortie de Mons, à
1324 mètres de l'origine du canal.
« La dérivation de la rivière
La Haine captée au lieu-dit Fort La Haine, se dirige plein
sud perpendiculairement au canal pour passer en siphon sous le
radier de la tête en amont de l'écluse dans un pertuis
en maçonnerie de briques de 8 x 5,8 m. de section et de
25 m de longueur. La rivière coule alors jusqu'à
Saint-Ghislain dans un nouveau lit parallèle au canal. »
« Le lieu porte encore le nom de « Pont-Canal »
car c'est en fait le canal qui enjambait la rivière par
un pont-canal comme il en existe tant sur les canaux creusés
au XIXe siècle. »
Bibliographie :
- Thomas (Willy), « Le paysage
le long du canal à travers les cartes postales »,
dans De Mons à Condé. Un canal et des hommes
(1807-1968), Cercle d'Histoire et d'Archéologie de
Saint-Ghislain et de la région, 2007, p. 148.
- Van Mol (Bruno), Le canal de Mons
à Condé au fil de l'eau et du temps..., Cercle
Archéologique de Mons, 2024, pp. 27-32.
20 euros (code de commande : 02327).
[MONS - PREMIÈRE GUERRE MONDIALE].
Éclairage des habitations.
Mons, Ville de Mons, 1914. Placard imprimé sur un papier
au format 253 x 163 mm., avec le filigrane partiel de la Ville
de Mons.
Daté
du 11 septembre 1914, signé par le Bourgmestre Jean Lescarts.
L'impression fut réalisée par
l'Imprimerie provinciale du Hainaut - L[éon] Lambert, à
Mons qui était installée au n° 12 de la
rue de Houdain.
Vendu.
MOURITSEN (Ole G.) — Algues marines. Propriétés, usages, recettes. Paris, Delachaux et Niestlé, 2015. In-8° (197 x 268 mm.) sous cartonnage illustré d'éditeur, IX, 287 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, glossaire, index, exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
Les
algues jouent un rôle de plus en plus important dans nos
vies quotidiennes et leur introduction dans nos habitudes alimentaires
a permis de populariser leur usage.
Le livre décrit l'histoire culturelle
des algues ainsi que leur biologie et écologie. Leur rôle
dans le domaine de la santé et la beauté est également
traité. D'autres usages dont les débouchés
pourraient s'avérer prometteurs dans les années
à venir sont détaillés : cultures destinées
à l'éradication de la faim dans le monde, fertilisants,
construction, usages industriels...
Les aspects nutritionnels des algues, riches
en minéraux, oligo-éléments, protéines,
vitamines, fibres alimentaires, acides gras polyinsaturés
rares sont abordés de manière approfondie. Par ailleurs,
60 recettes à base d'algues brutes ou préparées
y sont minutieusement décrites.
Un livre élégamment illustré
et à la pointe des connaissances.
25 euros (code de commande : 02325).
MOUTRIEUX
(Pierre) — Traduction
de l'Art poétique d'Horace. Mons, Société
des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, [1873]. In-8°
(158 x 234 mm.) broché sous une couverture muette verte,
18, [2 bl.] p., exemplaire non coupé et en très
bon état, étiquette de l'éditeur-imprimeur
montois Dequesne-Masquillier collée à la deuxième
page de la couverture.
Il s'agit d'un tiré-à-part
du t. IX - 3e série des Mémoires et publications
de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres
du Hainaut.
Notice de Claude Sorgeloos
:
Enseignant, écrivain,
poète et chansonnier. Pierre Moutrieux est le fils d'un
sergent de ville. Après ses humanités, il exerce
divers métiers à Mons : employé à
l'octroi communal, commis chez l'inspecteur des contributions,
comptable chez un commerçant, puis professeur dans des
écoles privées, parmi lesquelles l'Institution Moneuse,
rue de la Grosse Pomme. Il devient ensuite enseignant privé
afin de préparer les candidats aux concours des administrations
publiques. Parallèlement, il se consacre à la littérature
dialectale, en patois montois, écrivant aussi en français.
Son œuvre comprend des poèmes historiques et didactiques,
mais surtout des fables et des chansons. En 1848 et 1849, il fait
paraître, sous le pseudonyme de Titiss' Ladéroutte,
dit Louftogne, un annuaire intitulé Dés Cont'
dé Quiés, tiens !, almonach montois. De 1854
à 1856, il édite ses Chansons sous la forme
d'une publication mensuelle. Il alimente l'Armonaque dé
Mons de l'abbé Charles Letellier, un autre almanach,
El carïon d'Mons, publié par Moutrieux lui-même
de 1872 à 1876, et la gazette dialectale El Ropïeur,
fondée en 1895. Il est ainsi l'auteur de quelques textes
emblématiques comme El Carïon, El Doudou raconté
pa n'ein p'tit fieu et Rouiand Délatte. Ses œuvres
sont typiques de la littérature dialectale montoise en
raison de leur caractère enjoué, impertinent voire
irrévérencieux. Une plaque commémorative
rappelant le souvenir de Moutrieux, associé à d'autres
littérateurs montois, Henri Delmotte, Charles Letellier
et Jean-Baptiste Descamps, est apposée sur un mur du Jardin
du Mayeur.
Bibliographie :
- Abrassart (Jeannine), Lettres lumeçonnes. Bio-bibliographie
montoise : répertoire alphabétique des auteurs nés,
résidant ou ayant vécu à Mons, 2012,
t. II, pp. 348-350.
- Sorgeloos (Claude), « Moutrieux Pierre (Mons, 1824-1908) »,
dans 1000 personnalités de Mons & la région,
pp. 614-65.
6 euros (code de commande : 02347).
MUSATTI (Cesare) — Musatti au miroir ou Un psychanalyste interroge sa propre névrose pour soigner celles d'autrui. [Titre original : Curar nevrotici con la propria autoanalisi.] Traduit de l'italien par Anne Guglielmetti. Paris, Éditions Buchet/Chastel, 1988. In-8° (141 x 205 mm.) broché, 150 p., exemplaire en parfait état.
En quatrième
de couverture :
Cesare
Musatti, principal représentant de la première génération
de psychanalystes italiens, est né en 1897. Son enfance
et son adolescence se déroulèrent à Venise.
Titulaire des chaires de Psychologie aux Universités de
Padoue, Urbino et Milan, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages
scientifiques et en particulier d'un important Traité
de psychanalyse.
À la question : Peut-on guérir
un névrosé par la psychanalyse ? Musatti répond :
« Oui, si le psychanalyste est, lui aussi, un névrosé. »
En un volume riche de sagesse et d'humour, l'auteur
dénoue des confessions et des souvenirs qui guident le
lecteur à travers les méandres de la santé
et de la folie, du transfert et de la thérapie analytique.
« Ce livre dont je prends congé
à présent fut un retour délibéré
sur moi-même. Afin de me remémorer ces expériences
personnelles qui m'aidèrent à comprendre les si
nombreuses personnes venues me demander assistance. »
7 euros (code de commande : 02317).
MUSIN
(Alfred) — Les grèves des mineurs au Pays Noir
au cours du mois de mai 1935. Préface
de Victore Van Laerhoven. Huy, Imprimerie Coopérative,
1935. In-8° (135 x 200 mm.) agrafé, 103 p.
Ouvrage fort
rare.
Table des matières
:
1. Préface.
2. Avant-propos.
3. L'action pour une nouvelle Convention.
4. La politique des Gouvernements des Banquiers.
5. La politique patronale.
6. Retour à la convention « Coût
de la vie ».
7. L'avènement du Gouvernement de Rénovation
économique.
8. L'arrière-faix des Gouvernements
de la déflation.
9. La rentrée des Chevaliers du Travail
à la Centrale.
10. La conférence nationale du Parti
communiste, à Charleroi.
11. La grève du Carabinier, à
Pont-de-Loup.
12. La grève du puits Sainte-Barbe, à
Tamines.
13. La grève s'étend.
14. Les propositions de la C.N.M.M. mettent
fin à la grève.
15. Le conflit local du Carabinier, à
Pont-de-Loup, devant la C.R.M.M.
16. L'intrusion dans la grève d'éléments
étrangers au mouvement.
17. La nouvelle mystique de l'occupation des
puits.
18. Considérations générales
sur les grèves et les méthodes employées.
19 Pour un renforcement de l'organisation syndicale
et de ses cadres.
20 Les nécessités du Syndicalisme
moderne.
21. Vers le Socialisme par le Syndicalisme.
Vendu.
[PARMENTIER
(Johan)]. Johan Parmentier. Tournai.
Chez l'Auteur, 2001. In-4° (205 x 270 mm.) broché,
nombreuses illustrations en couleurs, exemplaire en très
bon état.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'inauguration des trois sculptures sur
le rond-point Michel Lemay dédié à la Pierre
de Tournai, le 14 octobre 2011.
Texte de Jacky Legge :
La
pierre de Tournai et Johan Parmentier : une rencontre.
Implanté durant quelques années
à Gijverinckove, en Flandre occidentale, le muséum
George Grard invitait chaque été un sculpteur à
imaginer une installation de ses œuvres en complicité
avec les bronzes de Grard.
C'est à cette occasion que Johan Parmentier
s'est familiarisé avec la pierre de Tournai, rendant indirectement
hommage à George Grard, né dans la Cité des
Cinq Clochers en 1901 et qui resta attaché à sa
ville natale malgré les protestations d'un autre temps
qui ont suivi l'installation de la Naïade sur le pont-à-pont,
en 1950.
Johan Parmentier est venu dans la carrière
de Michel Lemay choisir les pierres qu'il façonna dans
son atelier pour aboutir à une exposition, en 2000, véritable
rencontre entre des choix esthétiques et des matériaux
différents : figuration - abstraction, bronze - pierre.
Mais une force réunissait les deux artistes : la palpitation,
la vie.
Grard exprimait la chair, le sang, l'amour,
la sexualité au moyen du plâtre et du bronze. Quand
Parmentier parle de la pierre, il perçoit un organe naturel
sorti d'un banc. Il dit de la pierre de Tournai qu'elle a une
personnalité qui lui convient bien, elle est à la
fois assez rude et très fine, ce qui n'est pas contradictoire
pour lui qui la façonne. Décidément, Grard
et Parmentier sont proches. Ce sont les apparences qui les différencient.
Ils ont la même exaltation quand ils s'attaquent aux matériaux
leur donnant une forme, une autre vie.
Johan Parmentier a rencontré Michel Lemay
à l'occasion de cette manifestation. Une profonde sympathie
s'est construite entre les deux hommes. C'est, donc, tout naturellement
vers le sculpteur que s'est tourné le maître de carrière
lorsqu'il a décidé d'installer une création
artistique au rond-point de la Pierre de Tournai.
Johan Parmentier est venu choisir des blocs
de pierre pour leur teinte particulière, l'inclinaison
et les dimensions. Elles furent confiées à Monument,
à Zottegem, où les tailleurs de pierre connaissent
le matériau depuis longtemps suite à de nombreux
chantiers, dont les restaurations de l'église Saint-Jacques
et de la cathédrale de Tournai, par exemple. Ces travailleurs
spécialisés donnèrent les formes voulues,
selon la maquette dressée par Johan Parmentier et ses recommandations
sur place. Ici encore, la complicité fut de mise, les tailleurs
de pierre suggérant des astuces et des techniques particulières
pour arriver au résultat voulu.
Le travail ne fut pas toujours aisé,
car il fallait scier trois différents blocs de pierre,
les ajuster afin de pouvoir les poser verticalement et donner
l'impression qu'il s'agit d'un monolithe. Mais la réussite
fut la récompense des efforts. Le naturel ayant subi l'action
de l'artificiel pour offrir finalement une image naturelle...
Entre-temps, Johan Parmentier a intégré
la pierre de Tournai dans d'autres réalisations, en Flandre.
D'un hommage à George Grard à
un triple hommage à Tournai, la cathédrale et l'Escaut,
le nom de Johan Parmentier est dorénavant lié à
l'histoire de nos carrières.
15 euros (code de commande : 02344).
['PATAPHYSIQUE]. Monitoires du Cymbalum Pataphysicum. N° 2. Rilly-la-Montagne, Cymbalum Pataphysicum, 1986. In-8° (151 x 210 mm.) agrafé, 32 p., illustrations, une carte à déplier, exemplaire numéroté sur papier couché (n° CXVI), avec sa bande d'annonce et en parfait état.
Avant-propos :
L'antique
question des rapports entre hommes et femmes, posée depuis
longtemps par les mouvements féministes (la grève
de l'amour des Athéniennes conduites par Lysistrata, qu'illustra
Aristophane), a commencé de se formuler de façon
voyante après la Première Guerre mondiale avec la
mode qui, chez les femmes, symbolisait leur indépendance:
cheveux courts, robe rétrécie, long fume-cigarette,
fréquentation des bars, au cours des années vingt,
pour se manifester plus fortement encore après le second
conflit. Les petites-filles de Flora Tristan, d'Olympe de Gouges,
de Mrs Pankhurst, de la « garçonne »
allant jusqu'à descendre dans la rue pour témoigner
contre l'homme et son machisme.
Bien sûr, ne s'est-il agi là que
de l'action menée par une minorité agissante. L'homme,
cependant, ne s'en est pas moins trouvé au tapis, comme
jadis Louis XVI et, naguère, le Czar. Comme eux, il
a dû céder son royaume et son empire, et même
partager jusqu'à son pantalon, sans pour autant avoir droit,
à l'exception des religieux et des magistrats, à
la robe. Il ne lui reste plus guère que le privilège
un peu désuet de faire pipi contre le mur, ce dont il n'est
pas peu fier, et celui d'arborer moustache et barbe pour autant
que la femme n'a pas encore jugé bon, malgré les
précédents de sainte Wilgeforte, de Marguerite d'Autriche,
de Madeleine Lefort ou de Clémentine Delait, de se les
laisser pousser.
Cela n'est pas sans conséquences.
Nous avons aujourd'hui une Organisation des
droits de l'homme où la femme est preneuse à 50 %
et un ministère des Droits de la femme où l'homme
n'a pas voix au chapitre.
Pour nous, qui voyageons dans le train de l'Histoire,
nous enregistrons soudainement un changement de paysage tandis
que, çà et là, des mains féminines
se saisissent des commandes de la locomotive.
Comme tous les événements importants,
celui-là se traduit par une modification des mœurs
et, partant, par une modification du langage. Polytechnicienne,
colonelle et colonel, capitaine, lieutenant, soldat et soldate,
préfet et préfète, député,
maire, on ne sait plus trop, en ce qui concerne nos sœurs,
à qui l'on a affaire, même s'il convient de dire
: madame le président ou madame le ministre.
Si nous ouvrons notre Rabelais (Gargantua,
chap. III : « Comment Gargantua fut unze moys
porté ou ventre de sa mère »), nous remarquons
que navire était, au XVIe siècle, un mot féminin,
comme il l'est encore, de nos jours, dans la langue anglaise :
« Julie, fille de l'empereur Octavian, ne se abandonnoit
à ses taboureurs (tambourineurs) sinon quand elle se sentoit
grosse, à la forme que la navire ne reçoit
son pilot que premièrement ne soit callafatée et
chargée ».
Si nous prenons Le Surmâle d'Alfred
Jarry, ou encore un dictionnaire Larousse de 1913, nous constatons
qu'automobile, mot-symbole du modernisme, était un vocable
masculin ; dans le dictionnaire nous pouvons admirer les
vignettes illustrant un automobile couvert (omnibus) et
un automobile découvert (voiturette). Ce mot, d'abord
pionnier, est devenu pionnière et se promène de
nos jours en jupe-culotte.
La Science se bornant, pour nous, à observer
et à constater les faits ou phénomènes qui
se présentent, à en tirer les enseignements et à
en étudier les conséquences et les applications,
nous notons que beaucoup de mots transsexuels, tels ceux cités
plus haut, se trouvent actuellement dans les magasins du prêt-à-porter
féminin. Sans préjuger des costumes qui vont leur
être choisis en l'an 2000, nous présenterons ici,
dans notre collection Quiproquos, quelques modèles
de travestis, de genre féminin aussi bien que masculin.
En hors-d'œuvre, nous ferons précéder cette
présentation de deux modèles d'allure plus classique,
destinés aux épaules soumises d'O et à celles,
plus carrées, de René, amants que, il y a trente
ans, nous fit connaître Pauline Réage.
Vendu.
[PEREC (Georges)]. Cahiers Georges Perec, n° 1 : Colloque de Cerisy (juillet 1984). Paris, P.O.L., 1985. In-8° (156 x 242 mm.) broché, 286, [44 (reproduction de pièces originales)] p., exemplaire en très bon état.
Sommaire :
I. Pistes.
- Perec et la judéité,
par Marcel Bénabou.
- Perec et la cruauté,
par Claude Burgelin.
- Perec ou le paysage
du conditionnel utopique : pour une syntaxe de la logique littéraire,
par Constantin Crisan.
- L'auto(bio)graphie,
par Anne Roche.
II. Pièges.
- Du double-jeu,
par Jean-Michel Raynaud.
- Fausses notes,
par Vincent Colonna.
- Embellir les lettres,
par Warren Motte.
- Georges Percé,
par Bernard-Olivier Lancelot.
- Alphabets, par
Mireille Ribière.
- Le Voyage d'hiver,
par Claudette Oriol-Boyer.
III. Paris, 11 rue Simon-Crubellier.
- Cinquième
figure pour la Vie mode d'emploi, par Bernard Magné.
- Échafaudages,
par Benoît Peeters.
- La Vie mode d'emploi
: archives en jeu, par Alain Goulet.
- Citation, prise
d'écriture, par Ewa Pawlikowska.
- Lavis mode d'emploi,
par Bernard Magné.
- L'inscription de
la pièce du lecteur dans le puzzle de la Vie mode d'emploi,
par Marie-Odile Martin.
IV. Partitions.
- Perec et la musique,
par Philippe Drogoz.
V. Parutions.
- L'autobibliographie ;
notes préliminaires à l'étude d'un corpus
et d'un genre, par Eric Beaumatin.
VI. Pièces originales.
- Pièce n°
1 : Manuscrit préparatoire du Voyage d'hiver.
- Pièce n°
2 : La Vie mode d'emploi : les peintures (dactylogramme).
- Pièce n°
3 : Souvenir d'un voyage à Thouars (partition).
- Pièce n°
4 : Bibliographie approximative (dactylogramme).
- Pièce n°
5 : Tentative de description d'un programme de travail pour
les années à venir (dactylogramme).
Vendu.
PHILIPPART (Solange) — Bonsecours au fil du temps... Illustration : Jean-Pierre Paemelaere. Bonsecours, Paroisse Notre-Dame de Bon Secours, 1985. In-8° (150 x 219 mm.) broché, 184 p., illustrations en noir, exemplaire en très bon état.
Table des matières
:
I. De
l'arbre à la chapelle.
II. Le temps des chapelles.
III. Le temps des malheurs.
IV. La naissance du hameau.
V. Le temps des révolutionnaires.
VI. Le temps de la croissance.
VII. Le temps des conflits.
VIII. La nouvelle église.
IX. L'irrésistible essor.
X. Bonsecours, commune.
Vendu.
PIENAAR (Andries Albertus) — Histoire d'une famille de lions. Récit africain. [Titre original : The Adventures of a Lion Family and other Studies of Wild Life in East Africa.] Traduit de l'anglais par J. Benais. Préface de J. Percy Fitzpatrick. 28e édition. Paris, Éditions Stock, 1948. In-8° (121 x 187 mm.) broché, 251 p., (collection « Les Livres de Nature »), exemplaire non coupé et en bon état.
Préface :
Celui
qui a décrit ces scènes de la vie des animaux sauvages
dans les vastes parties inexplorées du Sud africain, cette
patrie du gros gibier, dans les plaines sans abri et dans la brousse,
dans les marais, les lagunes et les rivières, dans les
montagnes et dans le silence émouvant de la forêt,
est un des rares hommes doués d'un vrai tempérament
d'écrivain, à qui le hasard a ouvert cette terre
des merveilles de la nature. Ce jeune Sud-Africain hollandais,
âgé de vingt ans à peine, a passé son
enfance dans ces régions dont il s'est assimilé
le sens et l'esprit, comme peuvent le faire ceux qui ne se contentent
pas de se laisser vivre dans un pays ; mais qui vivent de
sa vie même.
Ces récits, l'auteur les a écrits
pour un petit cercle, écrits juste comme on les avait racontés,
entre amis, dans sa propre demeure et dans son langage familier,
en cette langue que, dans l'Africain du Sud, on appelle l'africain.
Ce n'est pas le hollandais de la Hollande. Ce n'est pas une langue
classée ; c'est le taal, un dialecte, un patois. Il
n'a pas de littérature propre. Tout récemment ses
plus ardents défenseurs se sont mis d'accord sur certaines
idées essentielles et ont revendiqué pour lui une
existence à part, une individualité et une personnalité
propres. Mais, dans l'Afrique du Sud, c'est un vrai langage, aimé
de tous ceux qui le parlent ; il fait partie d'eux-mêmes,
de leur amour-propre, de leur orgueil national. Et si quelqu'un
doute encore que cette langue soit capable d'exprimer ce que l'œil
peut voir, ce que l'intelligence peut comprendre, ce que le cœur
peut ressentir, eh bien, ce petit livre contribuera utilement
à dissiper ces doutes.
Ce n'est pas en anglais que pense notre auteur ;
l'anglais n'est pas sa langue familière. Et quand ses amis,
désirant qu'un cercle plus étendu pût apprécier
l'œuvre de ce jeune homme, insistèrent pour que le
livre fût publié en anglais, on le confia à
des traducteurs qui l'ont rendu avec une intelligente sympathie.
Mais ce ne sont pas les qualités littéraires de
cet ouvrage – traduction ou bien original –
qui font son attrait ; il plaît parce qu'il est vécu.
Selon l'opinion du lecteur, ce peut être
un grand éloge ou une condamnation hautaine que de ranger
ce livre parmi les œuvres d'imagination ; les juges
compétents sont trop peu nombreux pour bien voir la différence
et rendre hommage à la fidélité de la peinture.
Il semble que ce genre de description ne puisse se passer d'imagination.
Mais il ne s'agit pas de l'imagination de l'invention, il s'agit
simplement de cette qualité de l'esprit ou du cœur
qui permet de se placer, pour voir les objets, au point de vue
d'un autre personnage. L'effacement de l'auteur, sa complète
impuissance à se montrer dans le récit, peuvent
prêter quelque vraisemblance à l'idée que
ce livre n'a pas été écrit d'après
ses observations et son expérience ; que tout cela
est assez plausible, convaincant même, mais cependant imaginaire.
On pourrait croire qu'une sentimentalité bienveillante
a pourvu tous ces animaux : lions, éléphants,
rhinocéros et hippopotames, solitaire hartebeest mâle,
vieux sangliers, singes colobes, de qualités et de sentiments
humains, trop humains. Des livres merveilleux et splendides ont
été écrits – œuvre du génie
auxquelles nous souhaitons l'immortalité – où
les animaux sont devenus des hommes et les hommes des animaux.
Ils ne sont pas l'image de la vie, mais qu'importe ! Ils
sont vrais pour eux-mêmes, à la manière des
contes de fées, et avec un fondement plus réel.
Nous les aimons : ce sont les classiques de l'enfance. Et
cependant l'enfant qui est en chacun de nous ne manquera pas de
se demander, à propos de n'importe quelle histoire :
« Est-ce une histoire vraie ? » Si
elle est vraie, elle passe dans le sanctuaire où règnent,
incontestées et incontestables, les Bibles humaines de
notre enfance. Ainsi quand un auteur, si modeste soit-il, raconte
une histoire vraie et la donne simplement pour telle, il ne sera
sensible à aucun compliment fait à son imagination
ou à son habileté si vous contestez sa modeste prétention
de n'être que le témoin enregistreur de la vérité
pure. Il sera déçu, peut-être même aigri
que vous n'aperceviez pas ce qui fait la valeur de son livre.
Ridicule ? Peut-être, mais vrai. Et c'est l'excuse
de cette note gratuite et si peu conforme à l'usage.
Une expérience intime et personnelle,
une sympathie inaltérable et intelligente imprègnent
ce petit livre. Faut-il dire que ces histoires sont conformes
à la vérité ? Certainement non. Mais
elles enchanteront, elles convaincront le lecteur dont le jugement
ne repose pas sur l'expérience personnelle ; quant
à ceux qui connaissent le Transvaal, leurs yeux brilleront
et leur pouls battra plus vite lorsqu'ils reconnaîtront
les détails précis qui composent le portrait du
gros gibier dans son élément.
Le texte ne vous apprendra pas, lecteur, que,
au moment où les vieux lions rôdaient prudemment
autour du cadavre du rhinocéros, l'auteur, dans un profond
ravissement, se trouvait à quelques pieds du chemin suivi
par eux ; ni qu'il aurait pu atteindre l'un d'eux avec une
de ces boulettes de papier dont nous nous servions en classe et
que nous lancions avec un petit arc à caoutchouc. Rien
ne vous dira que, lorsque les lionceaux rassasiés désiraient
jouer, il aurait pu les toucher avec son fusil, ni que le petit
hippopotame lui glissa des mains comme un cochon huileux et que,
pris de panique, il le jeta dans l'eau. Vous ne saurez pas que,
pendant des jours, il suivit la piste des lionceaux, les guetta,
les attendit, pour s'emparer d'eux – lutte d'intelligence
et d'adresse – et qu'il n'y réussit pas. Si parfois
vous pensez qu'il a donné à ces animaux des sentiments
humains et une intelligence d'homme – pensées,
souvenirs, émotions – nous ne pouvons discuter
là-dessus et vous prouver que ses portraits sont exacts.
Mais rappelez-vous que ces choses n'ont pas été
notées à la légère, que l'auteur est
persuadé de dire vrai. Il interprète, peut-être,
mais – et c'est un grand « mais » –
il a été vraiment témoin des choses qu'il
rapporte comme des faits exacts. L'erreur – si erreur
il y a – ne peut altérer les faits, mais seulement
les conclusions qu'en a tirées cet observateur attentif,
sympathique et intelligent.
De gros livres ont été écrits
sur le gros gibier de l'Afrique du Sud, mais ce petit volume me
semble unique en ce qu'il raconte la vie des grands fauves, chez
eux, et d'un point de vue qui n'est pas celui du chasseur, mais
celui des fauves.
9 euros (code de commande : 02333).
PLUCHE (Noël-Antoine) — Le spectacle de la nature ou Entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l’esprit. Tome cinquième, Contenant ce qui regarde l'Homme considéré en lui-même. Nouvelle édition. Paris, Estienne, 1755. [A Paris, / Chez les Freres Estienne, rue S. Jacques, / à la Vertu. / M. DCC. LV. / Avec Approbation & Privilege du Roi.] In-12 (99 x 158 mm.) broché, [1 (faux-titre)], [1 bl.], [1 (titre)], [1 bl.], 596, [3 (table et explication du frontispice)], [1 bl.] p., bien complet du frontispice et des 20 planches hors texte à déplier la plupart gravées par J. P. Le Bas.
Table des matières
:
Entretien I : La destination de l'Homme sur
la terre.
Entretien II : Le domaine de l'Homme.
Entretien III : Le gouvernement de l'Homme,
prouvé par les proportions & par l'excellence du corps
humain.
Entretien IV : Le gouvernement de l'Homme,
prouvé par l'excellence de ses sens.
Entretien V : Le domaine de l'Homme, prouvé
par ses plaisirs.
Entretien VI : Le gouvernement de l'Homme,
aidé par la certitude des fonctions animales.
Entretien VII : Le gouvernement de l'Homme,
démontré par les facultés de son esprit.
L'activité de l'Homme.
Entretien VIII : Le gouvernement de l'Homme,
prouvé par son intelligence.
Entretien IX : Le domaine de l'Homme, prouvé
par son imagination.
Entretien X : Le gouvernement de l'Homme,
prouvé par sa mémoire.
Entretien XI : Le gouvernement de l'Homme,
prouvé par l'étendue de sa volonté, par le
choix de sa liberté, & par la direction de sa conscience.
Entretien XII : Les sciences usuelles. La
logique usuelle.
Entretien XIII : La science usuelle. Les
faits. Les mesures.
Entretien XIV : La science usuelle. Les
forces mouvantes.
Entretien XV : L'optique.
Détail
des gravures :
1. Frontispice : Qu'est-ce que l'Homme.
2. Les mesures, en regard de la
p. 259.
3. Les mesures, en regard de la
p. 281.
4. L'usage des mesures, en regard
de la p. 305.
5. Les cadrans, en regard de la
p. 341.
6. L'anneau astronomique, en regard
de la p. 389.
7. Les forces mouvantes, en regard
de la p. 401.
8. Les forces mouvantes, en regard
de la p. 437.
9. Les moulins, en regard de la
p. 472.
10. Le moulin à vent, en
regard de la p. 479.
11. Le moulin à vent vû de face
et de profil, en regard de la p. 480.
12. Elevation et coupes du moulin sur batteau,
en regard de la p. 485.
13. Plan et coupe d'un moulin sur batteau,
en regard de la p. 485.
14. Le moulin à sier, en regard
de la p. 489.
15. Plan et coupe du moulin à sier,
en regard de la p. 489.
16. Plan du moulin à poudre, en
regard de la p. 495.
17. Elevation d'un moulin à poudre,
en regard de la p. 495.
18. L'optique, en regard de la p. 527.
19. Suite de l'optique, en regard de
la p. 565.
20. Le microscope, en regard de la p.
582.
21. Le telescope, en regard de la p.
592.
50 euros (code de commande : 02343).
PRIMUS. Feuille publicitaire de la
société Primus, à Gullegem. Impression recto verso au format 275 x 408 mm.
Cette
société spécialisée en matériel
de nettoyage de textiles (lessiveuses, essoreuses, sèche-linge,
repasseuses, équipements d'alimentation et de pliage, etc.)
sous les marques Primus, Lavamac et Deli. Fondée à
Gullegem (section de la commune de Wevelgem, près de Courtrai)
en 1911 par la famille Theys, elle fut intégrée
en février 2014 dans la société Alliance
Laundry Systems, disparaissant ainsi du paysage industriel de
Flandre Occidentale...
4 euros (code de commande : 02350).
[QUENEAU
(Raymond)]. Raymond Queneau et le cinéma. Reims, Maison de la Culture André Malraux
- Les Amis de Valentin Bru, 1980. In-8° (136 x 210 mm.)
agrafé, [72] p., illustrations, (collection « Supplément
des Cahiers de la Maison de la Culture André Malraux »,
n° 2), tirage limité à 800 exemplaires,
en très bon état.
Un des 200 exemplaires
numérotés (n° 113) réservés
aux membre de l'Association des Amis de Valentin Bru, constituant
le numéro double 10-11 de la Revue des Amis de Valentin
Bru.
Extrait de Bâtons,
Chiffres et Lettres :
« Pour
ceux qui comme moi sont nés à peu près avec
le cinéma et fréquentent assidûment les salles
obscures au moins trois fois par semaine depuis plus de trente-cinq
ans, il y a une émotion supplémentaire à
remémorer des films tels que Les vampires, Fantomas
ou Le voyage dans la lune que j'ai vu dans toute leur nouveauté
et dans toute leur fraîcheur..
On ne peut qu'admirer ceux qui, loin des « élites »
ont travaillé avec enthousiasme et désinvolture,
avec conviction et fantaisie, à l'élaboration de
tout simplement : un nouveau mode d'expression de l'humanité. »
18 euros (code de commande : 02321).
QUIÉVREUX (Louis) — Bruxelles notre capitale. Histoire, folklore, archéologie. Bruxelles - Liège, Pim-Services, [1954]. In-8° (130 x 186 mm.) broché, 362, [5 (index)] p., exemplaire en bon état.
Introduction :
Il
y a quelque amertume à exercer la profession de journaliste,
car ce qu'écrit le reporter dure à peine le temps
de la chute d'une feuille de papier, c'est-à-dire vingt-quatre
heures. Hier emporte souvent un enfant chéri, fruit fugitif
d'une idée, d'un spectacle ou d'une enquête. Aussi,
comme le faisait remarquer un jour un de mes confrères,
le journaliste soucieux de conserver, pour la postérité,
ce qu'il estime être le meilleur de sa production, cherche-t-il
dans le livre le havre où quelques-unes de ses pages seront
sauvées. C'est ce que j'ai fait. Le texte de ce recueil,
consacré à l'histoire, au folklore et à l'archéologie
de Bruxelles, est composé d'articles écrits, en
ordre principal, pour La Lanterne. Un index alphabétique
permet à l'ami de Bruxelles de trouver rapidement le renseignement
qu'il me ferait l'honneur de chercher dans ce livre que je dédie
à ma fille, afin qu'elle aime sa petite patrie comme je
l'aurai aimée.
10 euros (code de commande : 02352).
ROSNER (Karl) — Die Sendung des Leutnants Coignet - La Mission du Lieutenant Coignet. Traduction française de M. M. Gavard et L. Muldner von Mülnheim, avec le texte allemand en regard. Paris, Payot, 1931. In-8° (122 x 188 mm.) broché, 249 p., édition bilingue (allemand-français), couverture un peu défraîchie.
Fils de l'écrivain
Léopold Rosner, Karl (Vienne, 1873 - Berlin, 1951) écrivit
des nouvelles, des poèmes et des romans qui connurent un
grand succès, notamment ceux de sa veine « nationale »
: Le Roi dont l'action se déroule au quartier général
impérial pendant la deuxième bataille de la Marne
en 1918 mémoires du prince héritier prussien Guillaume.
Rosner était un conservateur, mais n'adhéra pas
aux théorises des nationaux-socialistes ; il ne publia
aucun autre ouvrage entre 1933 et 1945...
Le roman présenté ici met en scène
Jean-Roch Coignet (1776-1867) qui participa à toutes
les campagnes militaires du Consulat et de l'Empire dont il devint
le mémorialiste.
Vendu.
SARTRE
(Jean-Paul) — Critique de la Raison dialectique. Précédé de Questions
de méthode. Texte établi et annoté
par Arlette Elkaïm-Sartre. Tome I : Théorie
des ensembles pratiques. Tome II : L'intelligibilité
de l'histoire. Paris, Gallimard, 1985. Deux volumes
in-8° (150 x 225 mm.) toilés sous jaquettes d'éditeur,
921 et 469 p., (collection « Bibliothèque
de Philosophie »), le tome I est épuisé
au catalogue de l'éditeur.
La première
édition est parue en 1960, du vivant de Sartre. Cette dernière
édition est établie d'après le manuscrit
original.
En quatrième de
couverture du tome I :
Sartre
présentait ainsi lui-même cette Critique de la
Raison dialectique :
« Y a-t-il une Vérité
de l'homme ? Personne – pas même les empiristes –
n'a jamais nommé Raison la simple ordonnance – quelle
qu'elle soit – de nos pensées. Il faut, pour
un « rationaliste », que cette ordonnance
reproduise ou constitue l'ordre de l'Être. Ainsi la Raison
est un certain rapport de la connaissance et de l'Être.
De ce point de vue, si le rapport de la totalisation historique
et de la Vérité totalisante doit pouvoir exister
et si ce rapport est un double mouvement dans la connaissance
et dans l'Être, il sera légitime d'appeler cette
relation mouvante une Raison ; le but de ma recherche sera
donc d'établir si la Raison positiviste des sciences naturelles
est bien celle que nous retrouvons dans le développement
de l'anthropologie ou si la connaissance et la compréhension
de l'homme par l'homme impliquent non seulement des méthodes
spécifiques mais une Raison nouvelle, c'est-à-dire
une relation nouvelle entre la pensée et son objet. En
d'autres mots, y a-t-il une Raison dialectique ? »
En quatrième de couverture du tome II :
Sartre poursuit :
« L’expérience dialectique,
dans son moment régressif, ne peut nous livrer que les
conditions statiques de la possibilité d’une totalisation,
c’est-à-dire d’une Histoire. Il conviendra donc
de procéder à l’expérience inverse et
complémentaire : en recomposant progressivement le
processus historique à partir des rapports mouvants et
contradictoires des formations envisagées, nous ferons
l’expérience de l’Histoire : cette expérience
dialectique doit pouvoir nous montrer si les contradictions et
les luttes sociales, la praxis commune et individuelle, le travail
comme producteur d'outils, l'outil comme producteur d'hommes et
comme règle des travaux et des relations humaines, etc.,
composent l'unité d’un mouvement totalisateur intelligible
(donc orienté). Mais avant tout... l’expérience
critique vise à recomposer l'intelligibilité du
mouvement historique à l'intérieur duquel les différents
ensembles se définissent par leurs conflits. Elle cherche,
à partir des structures synchroniques et de leurs contradictions,
l'intelligibilité diachronique des transformations historiques,
l'ordre de leurs conditionnements, la raison intelligible de l’irréversibilité
de l’Histoire, c’est-à-dire de son orientation. »
Les deux volumes : 40 euros (code de commande : 02348).
SCHARDT (Alois) — Das Initial. Phantasie und Buchstabenmalerei des Frühen Mittelalters. Mit 106 abbildungen und 4 farbigen tafeln. Berlin, Rembrandt Verlag, 1938. In-4° (215 x 270 mm.) sous reliure et jaquette (déchirée) d’éditeur, 180 p., illustrations in et hors texte en noir et en couleurs.
Vorwort :
« Beschäftigt mit der Kunstgeschichte
des Mittelalters, wurde ich von der Eigenart der vor- und frühmittelalterlichen
Buchstabenwelt so stark beeindruckt, daß ich mich entschloß,
eine Auswahl derselben herauszugeben. Da ich kein Spezialist auf
diesem Gebiet bin, liegt mir die Absicht fern, die Fachliteratur
durch neue Studien und Erkenntnisse bereichern zu wollen. Allen
Forschern auf diesem Gebiete bin ich zu Dank verpflichtet, da
sie es mir durch ihre Arbeiten ermöglichten, diese Zusammenstellung
zu treffen, die in erster Linie für die breitere Öffentlichkeit
bestimmt sein soll. Datierungen, Einreihungen in Schulzusammenhänge
usw. habe ich im allgemeinen aus der Spezialliteratur übernommen,
wenn mir auch bei dem Studium dieser Literatur in manchen Fällen
Bedenken kamen, da mir schien, daß die Schlußfolgerungen
aus aktenmäßigen Provenienz- und anderen Urkundennachweisen
nicht immer mit dem tatsächlichen Stilbefund zusammengehen
wollten. Über diese Bedenken hinaus aber ist erfreulicherweise
das gesamte Material soweit erforscht und geordnet, daß
man den unmittelbaren künstlerischen Eindruck der einzelnen
Blätter mit ihrer Einreihung in einen größeren
geschichtlichen Gesamtablauf verbinden kann.
Bei der Auswahl der Blätter ergaben sich
mancherlei Schwierigkeiten, die wiederum die Auswahl selbst mitbeeinflussen
mußten. Die bereits vorhandenen Aufnahmen stammten zum Teil
aus früherer Zeit und waren mit nicht genügend rotempfindlichen
Platten und oft bei einseitiger Beleuchtung aufgenommen, so daß
das Tonwerteverhältnis zum Teil ungünstig war und oftmals
Licht und Schattenbänder den Gesamteindruck beeinträchtigten.
Bei Neuaufnahmen stellte sich heraus, daß bestimmte Farbklänge
– z. B. goldenes Riemenwerk auf orangefarbenem Grund –
von der Platte nicht genügend registriert wurden, so daß
verwaschene Bildstellen entstanden, während das Original
in Wirklichkeit klare Kontraste aufzeigte. Diese Schwierigkeiten
mußten zum Teil die Auswahl mitbestimmen, zum Teil habe
ich mir durch nachträgliche Richtigstellungen so gut es ging
zu helfen gesucht.
Die Mehrzahl der Bilder ist unter Originalgröße
wiedergegeben, da das Format des Buches aus Gründen der Wohlfeilheit
nicht vergrößert werden konnte. Einige Buchstaben und
besonders eine Reihe von Einzelheiten sind über ihre natürliche
Größe hinaus wiedergegeben worden. Zwei Gründe
haben mich zu diesen Vergrößerungen veranlaßt.
Einmal gewöhnt sich der Mensch von heute durch die vergrößerten
Bildwiedergaben auf Plakaten und auf der Kinoleinwand immer mehr
daran, nur den Gesamteindruck in sich aufzunehmen. So wichtig,
ja in mancher Hinsicht nützlich eine solche andere Seheinstellung
sein mag, so hat sie doch in der Kunst und insbesondere der in
diesem Buche aufgezeigten Kunst den Nachteil, daß dem Betrachter
wichtige, den Gesamteindruck mitbestimmende Einzelheiten entgehen,
falls man ihm nicht diese Einzelheiten gesondert und in vergrößerter
Wiedergabe zeigt. Der zweite Grund liegt darin, daß viele
Gebilde der mittelalterlichen Buchstabenmalerei zwar klein im
Format, aber monumental in der Art ihrer Formgebung sind.
Den Direktoren und Betreuern der verschiedenen weltlichen
und kirchlichen Bibliotheken und Bücherschätze bin ich
für ihr Entgegenkommen sehr dankbar. Besonderen Dank sage
ich dem Herrn Verleger, der durch liebevolles Eingehen auf meine
Wiinsche und Anregungen das Zustandekommen dieses Buches ermöglicht
hat. »
10 euros (code de commande : 02355).
THARAUD (Jérôme et Jean) — Rendez-vous espagnols. Paris, Librairie Plon - Plon-Nourrit et Cie, 1925. In-8° (125 x 179 mm.) demi-reliure toilée à la Bradel, couverture rempliée conservée, 84 p., exemplaire du tirage courant de l'édition originale, en très bon état.
Table des matières
:
I.
Un prologue sanglant.
II. Visite chez le roi.
III. Primo de Rivera ou l'optimisme d'un joueur.
IV. Les tristesses d'un vieux libéral.
V. Moulay Hafid ou le paradis perdu.
VI. Un mois après.
9 euros (code de commande : 02323).
TILLIER
(Claude) — Belle-Plante
et Cornélius. Bois gravés par Deslignères.
Paris, Mornay, 1921. In-8° (155 x 206 mm.) broché
sous couverture rempliée, XXXVII, 288 p., (collection
« Les Beaux Livres », n° 7), exemplaire
numéroté sur Rives (n° 132), exemplaire
en bon état.
Le roman est précédé du
texte du discours prononcé par Jules Renard à
l'inauguration du buste de Claude Tillier, à Clamecy, le
17 septembre 1905.
Extrait du Dictionnaire des œuvres :
Petit roman de mœurs provinciales,
à intentions philosophiques, publié en 1841 [...].
Les héros sont deux frères, héritiers d'un
riche hobereau de campagne, qui crut pourvoir à leur éducation
en les confiant à un maître, charlatan et Ivrogne.
L'un, Belle-Plante, est avide, avare jusqu'à la ladrerie
et fermé à tout appel du sentiment : il ne
songe qu'à accumuler de l'argent, à dépouiller
son frère ou toute autre personne quand il en a l'occasion.
L'autre, Cornélius, est exactement l'opposé :
généreux, rêveur, adonné à des
études philosophiques, il dépense le peu qu'il possède
en expériences utopiques et en générosités
irréfléchies. Aidé de Louise, bonne et pleine
de bons sens, il mène à bien son invention :
un aérostat dirigeable, qui devra lui procurer la richesse
et grâce auquel il obtiendra pour son mariage avec Louise,
le consentement, tant souhaité, du père de la jeune
fille. Tout le monde s'oppose à ce mariage ; depuis
Belle-Plante qui convoite la dot de la jeune fille, jusqu'au curé
qui professe pour elle une admiration qui n'a rien d'innocent,
alors qu'il nourrit une haine inexorable pour Cornélius
libre-penseur. Pendant que Cornélius essaie son aérostat,
un coup de fusil tiré par le curé troue l'appareil,
et le pauvre rêveur disparaît sans retour dans le
ciel. Par le ton du récit qui se tient entre le pathétique
et l'humoristique, par l'anticléricalisme et les préoccupations
sociales dont fait preuve l'auteur, cette œuvre rappelle
les écrits de Voltaire et de Diderot. La langue et le style
sont parfaits. Sans doute y a-t-il dans le personnage de Cornélius
un peu de l'auteur lui-même qui, soldat, écrivain
et maître d'école, mena précisément
dans le village où se passe le récit, une vie de
travail et de luttes ingrates pour la justice et le progrès.
Bibliographie :
- Laffont-Bompiani, Dictionnaire des
œuvres, t. I, p. 433.
40 euros (code de commande : 02324).
aura lieu
le mardi 3 juin 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone ou sms (+32 (0) 472 51 52 63).
Ces livres peuvent être retirés à l'adresse figurant dans l'en-tête du blog.
En cas d'envoi postal, veuillez indiquer le pays vers lequel le colis devrait être expédié, cela me permettra de vous indiquer les modalités de livraison et de paiement.








.jpg)