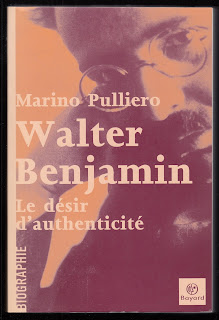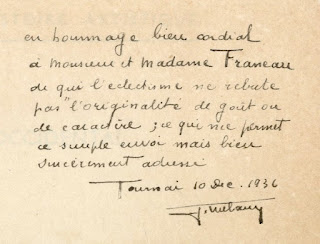MISE À JOUR DU 7 JANVIER 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone (+32 (0) 472 51 52 63)
pour obtenir d'autres informations à propos de ces livres.
[BELGIQUE - ENSEIGNEMENT]. La Ligue de l'Enseignement et la Défense de l'École Publique avant 1914. [Bruxelles], Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation Permanente, 1986. In-4° (220 x 310 mm.) sous reliure et jaquette (un peu défraîchie) d'éditeur, 127 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
Table des matières
:
- Préface,
par Hervé Hasquin.
- Quelques aspects de l'action éducative
de la Ligue à travers ses finances, par Alain G.
Massart.
- La Ligue de l'Enseignement et les
associations d'instituteurs, 1864-1895, par Frank Simon.
- Les affiches et autres moyens de propagande
de la Ligue de l'Enseignement concernant la loi scolaire,
par Nadine Triest.
- La Grande Mascarade du 31 mars 1878,
par Jean Dubois.
- Une enquête sur la situation
de l'enseignement primaire sous la loi scolaire de 1884, par
Christian Vandenberghen.
- Une conséquence de la loi Jacobs
(20 septembre 1884) : la création d'écoles libres
laïques, par André Uyttebrouck.
- Le projet de loi Schollaert et le
bon scolaire (1911), par Roger Desmed.
Vendu.
[BENJAMIN (Walter)]. PULLIERO (Marino) — Le désir d'authenticité. Walter Benjamin et l'héritage de la Bildung allemande. Paris, Bayard, 2005. In-8° (162 x 240 mm.) broché, 1054 p., exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
Cette
biographie intellectuelle de Walter Benjamin est en même
temps un travail d'histoire de la culture qui s'attache à
brosser une fresque de l'Allemagne wilhelminienne, comme à
en dégager une ligne rectrice : le désir d'authenticité.
Cet axe dominant résulte de l'analyse des courants et des
conflits philosophiques, esthétiques, religieux et politiques
qui animèrent l'Allemagne au tournant du XIXe siècle
et qui se manifestèrent dans toute leur ampleur, juste
après la fin de la Première Guerre mondiale, comme
un rejet du monde d'avant 1914. Toutes les grandes thématiques
sont abordées par l'ouvrage : la critique de la culture
(puissamment entretenue par l'influence nietzschéenne),
la transformation de la vie et de la sensibilité au sein
des grandes métropoles modernes, les différentes
faces de la refonte de l'identité juive (les sionismes
et les réactions qu'ils déclenchèrent), les
mouvements de jeunesse et leurs idéologies du retour à
la nature et au corps, les conflits religieux autour de la problématique
de la sécularisation et du désenchantement, les
thèmes socio-politiques de la « communauté »
opposée à la « société »,
enfin la question de la philosophie de l'histoire et celle, plus
philosophique, de la conception nouvelle de l'expérience
réagissant au positivisme et au scientisme.
Ce livre est l'histoire d'une formation ; mais
si la figure de Benjamin apparaît à ce point exemplaire,
c'est que les éléments de cette formation ont exercé
leur influence bien au-delà de la Grande Guerre, et jusque
dans la réception contemporaine et, notamment, française,
de cet auteur. L'ouvrage nous propose ainsi un miroir de nos propres
conflits en nous offrant les moyens de retrouver leurs racines
et de reconstituer leur généalogie.
Vendu.
BENOIT (Benoit Van Innis, dit) — Felle Hemel. [Antwerpen], Loempia, 1993. In-4° (299 x 278 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, 127 p., illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en très bon état.
Le texte
du poème Cielo Vivo, extrait du recueil posthume
de Federico Garcia Lorca Poeta en Nueva York a été
traduit en néerlandais par Dolf Verspoor.
La plupart des dessins de Benoit ont été
publiés dans The New Yorker, de 1991 à 1993.
20 euros (code de commande : 01952).
CELLÉRIER (Jean) — Saint Serge. Paris, La Colombe - Éditions du Vieux Colombier, 1963. In-8° (136 x 209 mm.) broché, 129 p.
En quatrième
de couverture :
1963
: 1650e anniversaire de la mort de saint Serge.
Nous sommes ici bien loin de ces vies de saints
belles et bonnes, mais banales et douceâtres. Loin aussi
de ces vies de saints, qu'on veut ultra-modernes, de ces saints
qu'on habille à la mode du jour et qui deviennent si méconnaissables
qu'on arrive à contester qu'ils aient jamais existés.
Saint Serge est le livre d'un chrétien,
d'un historien, d'un philosophe, d'un poète, d'un voyageur.
Cette hagiographie a lentement mûri depuis le temps où
Jean Cellérier, officier de méharistes, campait
au désert de Syrie, sur le tombeau de saint Serge, colonel
de cavalerie. Le tombeau dégagé, les documents retrouvés,
l'amour venu à l'auteur peu à peu pour son grand
ancien, les encouragements, les conseils, l'aide de Henry Bordeaux,
de René Dussaud, de Louis Bréhier, sa science archéologique,
la rigoureuse méthode historique qui a été
sa règle, sa foi de grand chrétien, ont eu pour
résultat ce livre si divers dans son unité.
Descriptions vivantes du désert de Syrie, vue
cavalière des trois premiers siècles depuis la venue
de Jésus-Christ, vie et mort de saint Serge, d'après
des documents inconnus, dans un décor où l'auteur
a vécu, histoire du grand pèlerinage de Resafa sur
les bords de l'Euphrate, une des plus belles villes mortes du
désert de Syrie; pèlerinage de Resefa qui fut, jusqu'à
l'Islam, aussi important que celui de Saint-Jacques-de-Compostelle
au Moyen Âge ou de Lourdes et de Notre-Dame-de-Fatima de
nos jours : tout cela est raconté, pour la première
fois, dans un style vivant, baigné de foi et d'une poésie
prenante.
Serge, saint d'Orient, que tout l'Occident a
vénéré ; Serge, que S.S. Jean XXIII
a honoré d'une particulière dévotion ;
Serge, intercesseur qualifié pour l'unité de l'Église ;
Serge, modèle de foi, de charité, d'héroïsme,
est un protecteur et un guide dont l'Église et le monde
ont besoin.
Tous les Serge qui ignorent leur patron ;
tous les chrétiens, tous les officiers, tous les cavaliers ;
tous les esprits que l'archéologie du lointain Orient attire
en cette Syrie où l'architecture est née de Sumer
par la Perse ; tous ceux qui cultivent l'anis, le transforment,
le vendent ou le boivent ; tous les membres de la confrérie
mondiale et ancienne des anisettiers du Roy, qui ont choisi saint
Serge pour protecteur ; tous les Angevins, heureux possesseurs
de la magnifique basilique du VIe siècle dédiée
à saint Serge ; tous les lettrés trouveront
dans ce livre une forte nourriture pour l'âme et l'esprit,
un bel exemple et quelles joies !
13 euros (code de commande : 01929).
CHAVÉE (Achille) — Une foi pour toutes. Poèmes. La Louvière, Éditions des Cahiers de Rupture, 1938. In-8° (141 x 181 mm.) broché, 98 p., un des 175 exemplaires numérotés sur papier vergé (n° 17), en très bon état.
Hommage d'Achille Chavée à Eugène [illisible] et transmission de ce dernier à Robert Dascotte.
Ce recueil est augmenté de la transcription de la main d'Achille Chavée du poème Doigté de fer qui fut publié, en 1948, dans le recueil De neige rouge.
Il
s'agit du troisième recueil publié par Achille Chavée.
Dédié à Paul Éluard, il comprend trente-six
poèmes répartis en trois parties : 1. Belgique
- 2. Espagne - 3. Retour d'Espagne.
Notice de René Poupart à propos des recueils
D'ombre et de sang, Une foi pour toutes et La
question de confiance :
Les poésies D'ombre et de sang
publiées immédiatement après la Seconde Guerre
mondiale portent des dates antérieures à 1942 et,
par conséquent, se rattachent aux recueils parus après
la participation de Chavée à la guerre civile espagnole :
Une foi pour toutes (1938) et La question de confiance
(1940).
Toutes ces œuvres confirment le ralliement
du poète à la doctrine surréaliste. Les méthodes
de l'automatisme poétique sont plus que jamais considérées
comme « des sources authentiques d'images irréfutables ».
De nombreux poèmes (« Eva », « Refuge »,
« Matière première », « Tronçons »,
etc.), nous offrent un véritable feu d'artifice d'images
fulgurantes. Le lecteur est d'abord fasciné par ce délire
verbal dont il subit le charme, au sens premier du terme, sans
s'interroger sur la cohérence du sens, car le discours
poétique est le carrefour de tous les contrastes ;
il charrie tour à tour le sublime et le trivial, le mystère
et le réel, la violence et la douceur, l'émotion
et la dérision, la gravité et l'humour. Ce même
lecteur s'aperçoit ensuite que l'apparente dispersion de
la pensée masque une construction rigoureuse et que la
folle créativité du langage s'articule sur une ou
quelques armatures syntaxiques très simples, mais disjointes,
écartelées parce que leurs noyaux – sujets
et verbes – surgeonnent de déterminants, ce qui
confère au flot poétique une allure incantatoire
de litanie. Rien n'est plus révélateur de la relation
qu'entretient Chavée avec le langage que le poème
« Matière première » dont
le titre même indique que les mots constituent le matériau
brut livré à l'activité transformatrice du
poète.
La plupart des textes sont datés de façon
très précise, ce qui indique une inspiration ponctuelle
et passagère, traductrice de la vie intérieure de
leur auteur en quête d'absolu : « Nous les
princes de la folie/ inaliénable/ croisés de l'impossible/
maudits qui n'avons rien renié/ de nos premiers serments
d'enfance ». Malgré l'angoisse de vivre, Chavée
a foi en « L'homme/ ce terrible animal »
car, finalement, « L'éternel miracle humain »
peut faire « du mal et de la damnation (...) la source
prométhéenne de l'espoir ». Ce miracle
humain, c'est celui de la jeunesse « aux pieds de cartouche
allumée/ sur le tonneau de dynamite ». L'espoir
suprême réside dans la révolution, dans la
libération totale de tous les conformismes imbus de certitude.
Bibliographie :
- Poupart (René), « D'ombre
et de sang », dans, Lettres françaises de
Belgique. Dictionnaire des œuvres. La poésie,
pp. 158-159.
- Achille Chavée. 1906-1969, catalogue
de l'exposition organisée à l'occasion du dixième
anniversaire de sa mort, à La Louvière, en 1979,
n° 295.
Vendu.
CHAVÉE (Achille) — Être bon. Illustré par Pascal Lemaître. Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018. In-8° (80 x 210 mm.) agrafé, 20 p., illustrations en noir.
Plaquette éditée
à l'occasion de « La Fureur de lire »
2018.
Le poème Être bon a été
publié dans le recueil L'Enseignement libre, en
1958 ; il figure également sur le disque Achille Chavée.
Textes dits par l'auteur, Robert Delieu et Paul Louka (Daily-Bul,
1971).
Préambule nécessaire
de l'illustrateur :
Chère
Lectrice, Cher Lecteur,
L'autre hiver, pendant que Jean, mon coiffeur,
me coupe les cheveux, je lui demande s'il connaît le poète
Achille Chavée.
– Bien évidemment ! me
répond-il.
– Alors je lui annonce que je veux
rendre hommage à Chavée en adaptant un de ses poèmes
en livre. Je diviserai le poème en doubles-pages illustrées
par ligne de texte.
Là, mon coiffeur s'arrête net.
Peigne planté dans ma tignasse et ciseaux en l'air.
– Mais tu ne peux pas faire ça !
Un poème se lit en une seule fois, comme une chanson, en
respectant la musicalité des mots, les temps de pause des
ponctuations et des passages à la ligne. Tu ne respecteras
pas l'œuvre en séparant les lignes l'une de l'autre,
page après page !
Mon coiffeur est outré.
– Tu as raison, dis-je. Je vais quand
même le faire, mais je préviendrai que ça
ne se fait pas et, à la fin, je mettrai le poème
en entier pour que le lecteur puisse le lire d'une traite et éventuellement
l'apprendre par cœur.
Mon coiffeur s'apaise et reprend sa coupe. Justice
sera donc faite à Achille Chavée.
Cher lecteur, chère lectrice, te voici
prévenu.
Vendu.
CLESSE
(Antoine) — Pièce d'inauguration du théâtre
de Mons ouvert le 17 octobre 1843 par Antoine Clesse. Mons, Moureaux et Compagnie, [1843]. [Mons, / Typographie de L. F. Moureaux
et Compagnie, / Vieux Marché aux Poissons, 13.] In-8° (130 x 200 mm.) broché,
10, [2 bl.] p., couverture très fragile coupée
en deux au pli central, ex-libris de Léopold de Sailly.
Une plaquette
rarissime !
Hippolyte
Rousselle nous apprend que « Louis-François
Moureaux, né à Coulonges-sur-Sarthe, près
d'Alençon, qui résidait à Mons depuis 1834,
fut le gérant d'une association qui établit, en
1840, une imprimerie en cette ville. » Il a recensé
neuf publications sorties de ses presses.
René Plisnier nous fait découvrir le programme
de l'inauguration du théâtre :
La première représentation
a débuté par l'exécution d'une ouverture,
œuvre d'un musicien local, Jules Denefve, professeur à
l'École de musique ; ensuite Haquette, le directeur
de la troupe a lu une pièce en vers due à la plume
d'un poète montois, Antoine Clesse, « inspirée
par une pensée patriotique, celle de créer une littérature
nationale, de développer dans le pays le génie poétique,
par l'indulgence d'abord, puis par des encouragemements. »
La lecture a été applaudie plusieurs fois. Pour
suivre, le public a eu droit à un prologue écrit
par le régisseur de la troupe, Félix Potel et intitulé
L'Épreuve préparatoire. Enfin, représentation
du Domino noir, opéra-comique en trois actes de
Daniel-Esprit Auber, sur un livret d'Eugène Scribe.
Bibliographie :
- Plisnier (René), Le théâtre
à Mons au XIXe siècle, Mons, Société
des Bibliophiles séant à Mons, 2001, pp. 83-84.
- Rousselle (Hippolyte), Bibliographie
montoise. Annales de l'imprimerie à Mons, Mons-Bruxelles,
1858, n° 1526.
- Poncelet (Édouard) et Matthieu
(Ernest), Les imprimeurs montois, Mons, Société
des Bibliophiles séant à Mons, 1913, pp. 170-171.
Vendu.
CORRIGAN (Gordon) — Sepoys in the Trenches. The Indian Corps on the Western Front 1914-1915. Staplehusrt, Spellmount, 1999. In-8° (164 x 241 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, XIV, 274 p., illustrations hors texte, exemplaire en très bon état.
Sur la jaquette :
Professionally
excellent though it was, the British Expeditionary Force of August
1914 was tiny compared with the mass conscript armies of the other
European powers. At this stage of the war the only possible reinforcement
by trained regular manpower was the Indian Army.
Four days after declaration of war, an Indian
corps of two infantry divisions and a cavalry brigade was ordered
to mobilise and embark for the Western Front. Commanded by their
British officers, the men of many Indian races began to arrive
in Marseilles in September 1914. They were to endure one of the
bitterest winters Europe had known, clad only in tropical uniforms,
and they remained in France and Belgium until being re-deployed
to Mesopotamia in November 1915.
In a country which they had never seen, against
an enemy of which they knew little and in a cause which was not
their own, the men of the Indian Army fought in all the major
battles of 1914 and 1915. True to their salt, they fought for
the honour of their race and the name of their regiments. They
have rarely been given the credit they deserved.
This book, drawing on a mass of hitherto unpublished
sources and extensive interviews by the author in India and Nepal,
tells the story of that Indian Corps. It describes and explains
their battles, their trials and tribulations and how they dealt
with the many difficulties which, as an army trained and equipped
for skirmishes on the Indian frontiers, they faced in their first
experience of high intensity warfare against a first-class enemy.
This is the first modern history of the Indian
Corps and as such will become the definitive work on its contribution
to the early years of the war on the Western Front.
12 euros (code de commande : 01925).
[DANNEEL]. DE DECKER (Francis) — La famille Danneel. Courtrai, Cercle Royal Historique et Archéologique de Courtrai, [1948]. In-4° (208 x 294 mm.) broché sous couverture à rabats, 50 p., tirage limité à 200 exemplaires signés par l'auteur et numérotés (n° 163), exemplaire en bon état auquel on joint une lettre de l'auteur.
Extrait des Mémoires du Cercle Royal historique et archéologique de Courtrai 1946-1948 - Nouvelle série - Tome XXII - 1re livraison.
L'auteur précise que si les patronymes Daniel, Daniele, Daniels, Danielssen, Daneels, Danneels, ne sont pas rares dans différentes régions actuellement encore, celui de Danneel ne se retrouve plus qu'au sein de la famille qu'il se propose d'étudier dans son ouvrage.
25 euros (code de commande : 01931).
[DAVID (Jacques-Louis)]. MAUROIS (André) — J.-L. David (David ou le génie malgré lui). Paris, Éditions du Dimanche, 1948. In-4° (242 x 310 mm.) broché, [24] p., 100 reproductions en héliogravure dont une partie de détail d'œuvres, (collection « Les Demi-Dieux »), exemplaire en très bon état.
Avant
les reproductions, texte original d'André Maurois David
ou le génie malgré lui. Suivi d'une biographie
par Françoise Gaston-Chérau. Les notices
des tableaux sont rédigées aussi par Françoise
Gaston-Chérau et éclairent succinctement le contexte
du tableau.
Extrait :
« Les thèses d’un artiste
le séduisent toujours à aimer ce qu’il n'aime
pas et à n'aimer pas ce qu’il aime. » La
phrase est de Paul Valéry et rappelle celle de Rousseau
sur Madame de Warens qui, au lieu d'écouter son cœur
qui était bon, suivait son esprit qui était faux.
David est l'exemple frappant d’un admirable artiste qui n'avait,
pour produire chef-d'œuvre après chef-d'œuvre,
qu’à écouter son génie et qui, pendant
une partie de sa vie, se laissa séduire par ses doctrines
à faire ce pour quoi il n'était pas fait. David
peintre de portraits, réaliste impeccable, de goût
infaillible, semblait créé pour être, dans
l'histoire de l'art français, le naturel chaînon
de passage du dix-huitième au dix-neuvième siècle,
l'ancêtre d'Ingres, Manet, Degas, et c’est bien en
fait sous cet aspect et dans ce rôle qu’il reste si
grand. Cependant il a cru, lui, que sa vocation était de
ressusciter les Grecs et les Romains, de peindre le Serment
des Horaces, les Sabines et Léonidas aux
Therniopyles. Il avait tant de talent que ces « dessus
de pendule » eux-mêmes ont leurs beautés,
mais de même que Voltaire qui se croyait immortel par Zaïre
le devint par Candide, à ses yeux simple jeu de
salon, David nous touche bien plus par le portrait de Madame Sériziat
ou par celui de Charlotte du Val d'Ognes, qu'il dut peindre avec
un facile bonheur, que par la Distribution des Aigles.
Et pourtant...
18 euros (code de commande : 01953).
[DELACROIX (Henry-Eugène)]. VENDRYES (Charles) — Delacroix (H.-Eugène). Paris, Baschet, [1877]. In- f° (280 x 376 mm.), 4 p., trois reproductions de dessins (dont un à pleine page) et un portrait de l'artiste en photoglyptie (82 x 115 mm.) collé à la p. 1, une planche hors texte (cliché de Michelez (188 x 243 mm.) du tableau Les Anges rebelles par Goupil), (collection « Galerie Contemporaine Littéraire Artistique », 1re série - n° 40), exemplaire en très bon état.
Extrait :
Parmi
les talents nouveaux que le salon de 1876 a signalés à
l'attention du public, il n'en est pas de plus curieux à
étudier que celui de M. E. Delacroix, de voir où
peut parvenir une intelligence d'élite, aidée d'une
volonté ardente et d'un travail acharné, arrivant
à constater de nouveau la vérité du Labor
improbus omnia vincit. [...]
La foule a donné raison à M. Delacroix
en se pressant autour de son œuvre ; la presse entière
a remarqué et loué de nombreux morceaux bien dessinés
et franchement peints ; le Jury a décerné une
troisième médaille à l'auteur que nous sommes
heureux de reproduire dans la Galerie Contemporaine, convaincus
qu'il saura soutenir et élever le nom écrasant qu'il
porte.
40 euros (code de commande : 01955).
[DIEU (Victor)]. AUQUIER (André) — Victor Dieu : graveur et peintre, sa vie, son œuvre. Avant-propos par Philippe Moureaux. Préface par Abel Dubois. Postface sur papier volant par Valmy Feaux. [Quaregnon], Chez l'auteur, [1988]. In-8° (157 x 240 mm.) collé, 87 p., illustrations en noir, envoi de l'auteur, exemplaire en très bon état.
Postface de Valmy Feaux
:
L'œuvre
de Victor Dieu n'est pas de celles qui appellent de longs commentaires.
Elle est directe, simple, délicate coure son créateur.
Elle s'adresse avant tout à la sensibilité de chacun.
L'homme fut discret et paisible. Il a consacré
toute sa vie à son art et ne prit pas le temps ou ne jugea
pas utile de faire part à la postérité de
ses réflexions, de ses interrogations sur son travail.
Les recherches qu'André Auquier dut entreprendre,
pour nous présenter une image aussi complète de
l'artiste, n'en furent que plus méritoires.
Le regard que l'on porte sur les œuvres
d'art évolue avec le temps. Ses contemporains aimaient
son réalisme poétique, la finesse et la douceur
de son trait.
Nous les apprécions toujours mais en
regardant les toiles, les gravures, les eaux-fortes de Victor
Dieu, c'est un monde disparu qui ressurgit : celui des gestes
quotidiens d'autrefois, celui des mines et des mineurs d'un Borinage
encore rural.
De ce monde où la violence de l'accident
minier fait parfois son apparition, l'artiste a privilégié
le souvenir bucolique des paysages figés par l'hiver, des
moulins, des chemins creux, des églises de village.
Œuvre profondément enracinée
dans une région dont elle tire sa vérité,
œuvre proche du public, œuvre classique sans lourdeur
ni mièvrerie... ainsi pourrait-on qualifier le travail
de Victor Dieu auquel son biographe rend un hommage bien mérité
qui permettra une meilleure connaissance d'une facette de notre
peinture wallonne si diverse et si riche.
Vendu.
[ENFANTS DANS L'ART]. Pride and Joy. Children's Portraits in the Netherlands 1500-1700. Edited by Jan Baptist Bedaux & Rudi
Ekkart. Gent-Amsterdam, Ludion, 2000. In-4° (206 x 297 mm.)
broché sous couverture à rabats, 319 p., nombreuses
illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en bon état.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
au Frans Halsmuseum, à Haarlem, du 7 octobre au 31 décembre
2000, puis au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, à
Anvers, du 21 janvier au 22 avril 2001.
Table des matières
:
- Foreword.
- Preface.
- Introduction, par Jan Baptist Bedaux.
- « Bounty from Heaven ».
The counter-reformation and childlikeness in the Southern Netherlands,
par Katlijne Van der Stighelen.
- Proudly raising vulnerable youngsters.
The scope for education intne Netherlands, par Jeroen Dekker,
Leendert Groenendijk et Johan Verberckmoes.
- Images of toys. The culture of play
in the Netherlands around 1600, par Annemarieke Willemsen.
- Children's costume in the sixtheenth
and seventeenth centuries, par Saskia Kuus.
- Catalogue, par Jan Baptist Bedaux,
Rudi Ekkart, Saskia Kuus et Katlijne Van der
Stighelen.
- Out of children's hands surviv!ing
toys and attributes, par Annemarieke Willemsen.
- Bibliography.
- Index.
25 euros (code de commande : 01951).
[ÉPIDÉMIES]. Comment lutter contre les épidémies, par un groupe de médecins. Soixantième mille. Dammarie-les-Lys, Les Signes des Temps, [ca 1923]. In-8° (136 x 204 mm.) agrafé, 128 p., illustrations, couverture défraîchie.
Table des matières
:
1.
Les épidémies, leurs causes.
2. La grippe, son traitement.
3. Encéphalite léthargique.
4. Les rhumes.
5. La tuberculose pulmonaire ; prévention
et cure.
6. Maladies infantiles.
7. Comment prévenir les maladies.
8. L'eau, un remède souverain.
9. Traitements hydrothérapiques.
10. Dans la chambre d'un malade.
11. Les lois de la santé.
13 euros (code de commande : 01949).
FAEHRÈS
(André) — Messines notre quartier en photographies
d'hier et d'aujourd'hui. Éditorial
par Jean Schils. Introduction par Katia Martoye
et Gérard Gobert. Mons, Maison de la Mémoire,
2022. In-4° (212 x 297 mm.) agrafé, 48 p., nombreuses
illustrations en noir et en couleurs, (collection « Cahiers
de la Maison de la Mémoire », n° 10),
exemplaire à l'état de neuf.
Ce numéro
parut à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
aux Ateliers des FUCaM, à Mons, du 12 mars au 16 avril
2022.
Extrait de l'éditorial
:
Ce
dixième Cahier de la Maison de la Mémoire de
Mons était attendu par nombre de personnes ayant visité
l'exposition « Messines, notre quartier, en photographies
d'hier et d'aujourd'hui » aux Ateliers des FUCaM, du
12 mars au 16 avril 2022. Il en est en quelque sorte le catalogue,
le fidèle reflet. Comme l'exposition, ce Cahier
a pour auteur principal André Faehrès.
Membre très actif du Groupe Porteur de
notre Maison de la Mémoire, André se passionne depuis
toujours pour le passé de sa ville. Profitant de sa bijouterie
établie dans la Grand-Rue, il invitait les Montois et Montoises
à déposer dans son magasin leurs photos anciennes
se rapportant à Mons qu'il reproduisait avant de les rendre
à leurs propriétaires.
Au fil des années, il a accumulé
un fonds d'archives photographiques de plus de 11.000 clichés.
Contrairement aux cartes postales, très connues du public,
le Fonds d'André Faehrès se compose de photos inédites.
Les huit expositions qu'il a présentées dans le
cadre de la Maison de la Mémoire de Mons ont donc toujours
été très attendues car elles constituaient
une vraie découverte.
En juxtaposant ces clichés anciens, originaux,
argentiques, avec des photos contemporaines, ce Cahier
nous invite à découvrir les mutations du quartier
de Messines, le plus vaste de la ville, depuis un siècle
et demi.
S'y ajoutent des commentaires explicatifs mais
aussi des jugements portés sur l'évolution du bâti.
Ses appréciations sont évidemment subjectives car
chacun pourra, de son point de vue, apprécier ou regretter
telle ou telle transformation architecturale.
La diversité des regards vaut aussi pour
l'identité du quartier : qu'est-ce qui fait la spécificité
de Messines ? Elle s'attache également aux jugements
que chacun peut porter sur ce qui fait sa cohérence ou
son incohérence, sur sa beauté ou sa laideur, sur
son attractivité constante ou en régression.
7 euros (code de commande : 01937).
GIDE
(André) — Un esprit non prévenu. Paris, Kra, 1929. In-8° (205 x 190 mm.)
broché sous couverture rempliée, 100 p., (collection
« XXe Siècle », n° 1), un
des 200 exemplaires numérotés sur Hollande (n° 300),
exemplaire à toutes marges.
Édition
originale.
Extrait :
Un
esprit non prévenu (ou qui sut se déprendre de ses
préventions), il n'est sans doute rien de plus rare ;
et c'est à la non-prévention que j'attache le plus
de prix.
Ce que l'on cherche le plus souvent dans la
vie, c'est de quoi s'entêter, non s'instruire. Chacun ne
regarde dans l'événement que ce qui lui donne raison.
Le reste échappe, qui désoblige ; et l'événement
n'est jamais si simple que chacun n'y puisse trouver confirmation
de ses convictions, fussent elles les plus erronées. Il
semble que rien ne plaise davantage à l'esprit que de s'enfoncer
dans l'erreur.
Vendu.
HASQUIN (René P.) et MAYENCE (Serge) — Salves sambriennes. Préface de A. Haulot. Avant-propos de Alexandre André. [Charleroi], [Héraly], 1959. In-8° (165 x 225 mm.) broché sous jaquette d'éditeur (papier arraché sur environ 2 cm²), 210 p., illustrations hors texte, un des 300 exemplaires numérotés sur blanc-vélin (n° 79), non coupé.
Table des matières
:
- Préface, par Arthur Haulot.
- Avant-propos, par Alexandre André.
- En avant, marche !
- Marcheur, d'où viens-tu ?
- Carte des localités où
l'on marche.
- Dates des marches.
- Sainte-Rolende, Gerpinnes.
- Saint Roch et ses marcheurs de Thuin.
- La Trinité à Walcourt.
- La Saint-Roch à Ham-sur-Heure.
- La Saint-Pierre à Thy-le-Château.
- La marche de la Grande Terre à
Châtelineau.
- Saint-Roch et Saint-Grégo à
Acoz.
- La Saint-Roch à Couillet.
- La marche de Saint-Eloi à Châtelet.
- Incursion au Royaume des Madeleineux,
à Jumet.
- Le Tour Saint-Jean à Gosselies.
- La Saint-Pierre à Florennes.
- La Saint-Pierre à Morialmé.
- La Saint-Feuillen à Fosse.
- Les autres marches.
- Entre deux salves.
20 euros (code de commande : 01941).
KAFKA (Franz) — La muraille de Chine. Traduit et présenté par Jean Carrive. Villeneuve-lès-Avignon, Seghers, 1944. In-12 (118 x 183 mm.) broché, 91 p., exemplaire en bon état.
Extrait de la préface
:
À
l'exception d'Un Vieux Parchemin et du Message Impérial,
que Kafka a publiés en 1920 parmi les récits du
Médecin de Campagne, les textes suivants font tous
partie des papiers posthumes. J'ai rassemblé ici, épars
dans trois des tomes des Œuvres Complètes, toutes
les esquisses se rapportant à « la Muraille
de Chine », et que des siècles auraient
sans doute séparées, si le récit n'était
resté à l'état de simple ébauche.
Kafka y travaillait dans les années 1918-1920 ; il
en a lui-même détruit une grande partie.
Les fragments qui nous restent révèlent
une des formes de la question où s'est trouvée engagée
la pensée de Franz Kafka avec une intensité particulière :
l'Homme aux prises avec le Transcendant, c'est-à-dire dans
la période nietzschéenne de « la Mort
de Dieu », avec la négativité,
en quelque sorte, du Transcendant. Car, chez Kafka, Dieu reste
innommé et n'apparaît pas (ou à peine, comme
ici, dans d'obscures allégories). Comme une « Ombre
Monstrueuse », il demeure à l'arrière-plan.
Présent par Son Absence même, Il se révèle
autant dans un insupportable sentiment de culpabilité que
dans l'angoisse d'un inexplicable vide ou dans l'indéfinissable
pressentiment d'un Oubli catastrophique– d'où
l'ambiance de rêve, l'atmosphère d'inconditionné
où baignent les créatures kafkaïennes.
Vendu.
[LEFRANCQ
(Marcel-G.)]. CANONNE (Xavier) et LEFRANCQ (Michel) — Marcel-G.
Lefrancq. Aux mains de la lumière. [Charleroi], [Musée de la Photographie],
2003. In-4° (216 x 281 mm.) broché sous couverture
à rabats, 165 p., nombreuses illustrations, exemplaire
en très bon état.
Cet ouvrage a été édité
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
au Musée de la Photographie de la Communauté française
à Charleroi, du 22 février au 1er juin 2003.
Table des matières
:
- Portrait partial et partiel d'un photographe
surréaliste, par Michel Lefrancq.
- Aux mains de la lumière,
par Xavier Canonne.
- La photographie est-elle un art ?,
par Marcel-G. Lefrancq.
- Images des hommes, par Marcel-G.
Lefrancq.
- Biographie.
- Bibliographie.
Vendu.
[LEMAIRE
DE BELGES (Jean)]. SPAAK (Paul) —
Jean Lemaire de Belges. Sa vie, son œuvre et ses meilleures
pages. Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion,
1926. In-8° (140 x 225 mm.) broché, 276 p., exemplaire
en bon état.
Un ouvrage devenu
rare.
Table des matières
:
I.
Introduction.
II. Les débuts du rhétoriqueur.
III. L'indiciaire de Marguerite d'Autriche.
IV. Le tempérament de l'artiste. Modes
divers de son activité.
V. Les grandes œuvres.
VI. Les dernières années.
- Les meilleures pages :
- Les illustrations de
Gaule et singularités de Troie.
- Rondeaux.
- La première
Épître de l'Amant vert.
- La seconde Épître
de l'Amant vert.
- Le traité intitulé
la Concorde des deux langages.
- Ouvrages français
à consulter.
- Index alphabétique.
- Corrections et additions.
Vendu.
LIBIOULLE
(Pierre) — La poterie de Sars-la-Bruyère, de 1914
à 1922. Catalogue d'une exposition. Eugie, Pierre Libioulle, 2013. A4 (213 x 297 mm.)
sous reliure spirale plastique et couverture transparente, [28] p.,
illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en parfait état.
Cette publication
fut éditée à l'occasion de l'exposition organisée
à l'église Saint-Jean-Baptiste, à Sars-la-Bruyère,
les 7 et 8 septembre 2013.
Sommaire :
- Une
exposition exceptionnelle...
- L'abbé Edmond Puissant et la création
de la poterie d'art de Sars-la-Bruyère.
- La production de poteries à Sars,
à partir de 1915.
- Techniques, motifs marques de fabrique
et artistes.
- Catalogue.
Vendu.
[LIVRE DES MORTS TIBÉTAINS]. Bardo Thödol. Le Livre des morts tibétains ou Les expériences d'après la mort dans le plan du Bardo. Suivant la version anglaise du lama Kazi Dawa Samdup. Éditée par W. Y. Evans-Wentz. Traduction française de Marguerite La Fuente. Préface de Jacques Bacot. Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient - Maisonneuve, 1977. In-8° (164 x 251 mm.) broché, VIII, 227 p., (collection « Classiques d'Amérique et d'Orient », n° I).
Préface :
La
provenance de ce livre n'est pas connue. Adaptation tibétaine
d’un original indien, ou, beaucoup plus vraisemblablement,
adaptation bouddhique d’une tradition tibétaine antérieure
au VIIe siècle, le Bardo Thödol est un traité
de la mort reposant sur un fond d'animisme extrême-oriental.
La description, non extérieure, mais interne et vécue
de l'agonie est si précise, qu'on pourrait croire cette
science eschatologique acquise par des hommes revenus du seuil
même de la mort. Le traducteur anglais, Dr W. Y. Evans Wentz,
la croit plutôt dictée par de grands maîtres,
agonisants attentifs, qui eurent la force d'enseigner à
mesure, à leurs disciples, le processus de leur propre
fin.
Mais les enseignements de ce Guide vont plus
loin. Après s'être adressés au mourant, ils
dirigent l’esprit du mort à travers les visions infernales
qui l'épouvantent et l'égarent. Dans l’état
intermédiaire – le Bardo – entre la
mort et la renaissance, se développent selon un déterminisme
rigoureux, les effets nécessaires dont les causes furent
les œuvres de la vie. Car enfers, dieux infernaux, tourments
sont créés par l'esprit lui-même, ils n'existent
pas en dehors de lui. Ils ne sont que phantasmes ni plus réels,
ni plus médiats que les mauvais rêves des mauvaises
consciences.
Enfin, ce Livre des Morts aborde avec
assurance le problème difficile, la pierre d'achoppement
du Bouddhisme, le point où se ferme, sans se souder, l'anneau
de la connexion causale, où finit un cycle et commence
le suivant : le mécanisme de la transmigration. Alors
que des textes plus canoniques font intervenir, assez maladroitement,
les Gandharvas, véritables dei ex machina, le Bardo
Thödol poursuit son développement discursif plus
satisfaisant, et il détermine par le jeu des attractions
et répulsions non seulement les parents mais aussi le sexe
de l’être qui s'incarne.
Mme M. La Fuente a traduit de l'anglais tout
l’ouvrage du Dr Evans Wentz, introduction, texte, notes et
opinions personnelles, sans rien ajouter ni retrancher. Cet effacement
du traducteur et sa persévérance devant une tâche
si ardue font honneur à son goût désintéressé
de la recherche objective. Le document que nous révèle
Mme La Fuente ne s'adresse pas seulement aux « Amis »,
mais à tous les curieux du Bouddhisme. Son intérêt
déborde même les frontières du Bouddhisme
par la gravité et l'universalité du sujet.
Vendu.
MAROT (Clément)
— Les oeuvres de Clement Marot, De Cahors en Quercy, Valet de chambre du Roy. [Lyon] [Gauthier], [1597]. In-16 (87 x 124 mm.)
plein parchemin à rabats, [1 (page de titre factice], [1
bl.], 796 p., les 32 pages de titre et de tables placées
au début de l'ouvrage manquent.
Relié à la suite :
Cinquante psalmes de David : Traduits par Clement Marot.
151, [1 bl.], [5 (table)], [1 bl.] p.
Il s'agit
de la dernière édition imprimée au XVIe siècle
des œuvres de Clément Marot.
La page de titre factice porte erronément
la date de 1543.
Bibliographie :
- Déguilly (Francis), Les
impressions lyonnaises du XVIe s. conservées à la
Bibliothèque municipale de Versailles, p. 8, n° 24.
Vendu.
OCCLESHAW (Michael) — Armour against Fate. British Military Intelligence in the First World War [and the secret rescue from Russia of the Great Duchess Tatiana]. London, Columbus Books, 1989. In-8° (164 x 240 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, XVI, 423 p., illustrations hors texte.
Sur la jaquette :
This
is not another book about spies, though they do have their place
in the book as one element of military Intelligence. Perhaps because
of its sensitivity in what was the Golden Age of the spy, there
exists no serious study of military Intelligence between 1914
and 1918 and its crucial development, in conditions of total war,
into the complex enterprise the term denotes today.
Intelligence developed the way it did because
of the kind of war the First World War became, and because of
the realization that the new mass-industrialized and democratic
nature of society was the key to a potentially decisive contribution
by Intelligence to the conduct of the war, a war that shaped the
modern world. The manipulation of whole populations by governments
or executive agencies was developed during this time.
Turning from discussion of total war and of
traditional methods of reconnaissance, Dr Occleshaw's engrossing
account describes the emerging character of Intelligence and the
human problems entailed in obtaining information from civilians
or prisoners, and of evaluating documents. He examines the early
opportunities with wireless and the development of codes and ciphers,
and deals especially with the very different, remarkable men engaged
in this vital work. Failure of communication was a major problem,
together with the undeniable conflicts that existed between the
personalities involved, such as that between Field-Marshal Sir
Douglas Haig and his Chief of Intelligence, Brigadier-General
John Charteris, a conflict on which Dr Occleshaw sheds some interesting
new light.
The story of Secret Service and special operations,
and of the spy rings, is given serious study. Again, it is the
story of the men behind the ideas which provides much of the fascination,
not just the accounts of their actions ; men like Smith-Gumming,
Kirke, Drake, Marshall-Cornwall, Meinertzhagen, Wallinger, Cameron
and Best : the agents and their covers ; and, especially,
the presiding genius of Intelligence, George Macdonogh.
Dr Occleshaw's research, conducted over several
years, was made largely among unpublished private papers, by recorded
interviews with veterans and among the less well known documents
in the Public Records Office. Even after seventy years, much documentary
evidence is still withheld from researchers ; more frequently
evidence came to light of official « weeding »
of files and of other files now unaccountably « missing ».
Despite these drawbacks, Dr Occleshaw's sources
have uncovered new information about the details of the financing
of the Secret Services, the air-dropping of agents over enemy
lines, and have made possible a new interpretation of the value
of British trench raids. Other chapters disclose fresh facts on
several contentious issues, such as an attempt to wage biological
warfare, the active assistance given to the British by the Dutch
Secret Service in breach of their neutrality, the propaganda campaign
of 1917-18 to subvert the German people, and a daring attempt
to rescue the Imperial Romanov family that affected the fate of
at least one of its members.
In Dr Occleshaw's view, work undertaken by British
military Intelligence shortened the First World War by at least
a year, saving countless lives. Further than that, Armour Against
Fate argues, convincingly, that the shape of things today
is in large measure due to a small number of brilliant men unafraid
to take some of the most controversial decisions ever made.
4 euros (code de commande : 01926).
[ORVAL - ABBAYE D']. Orval. Une promenade dans les ruines et la nouvelle abbaye. 4e édition revue et augmentée. Orval, Comité pour la Restauration de l'Abbaye d'Orval, [1950]. In-8° (148 x 195 mm.) broché, 94 p., illustrations, exemplaire en bon état.
Table des matières
:
Première
partie. Sommaire historique de la fondation à nos jours.
Deuxième partie. Promenade dans l'ancien
Orval.
1. Aperçu général.
2. La cour des Aumônes.
3. La cour d'honneur.
4. La salle des Hôtes.
5. La pharmacie.
- Cultures.
- Justice.
6. La cour des Bernardins.
7. La cour des Novices et
la fontaine Mathilde.
8. L'église de Moyen
Âge.
9. La chapelle Montaigu, désormais
chapelle Notre-Dame des Scouts.
10. Le cloître et la
salle du Chapitre.
Troisième partie. Promenade dans le nouvel
Orval.
Quatrième partie. Les principales activités
d'Orval.
1. Bibliothèque d'Orval.
2. Moines d'Orval, peintres
et forgerons.
3. Industries.
4. Les incorporations d'églises.
5. Les refuges.
6. Gérouville.
Cinquième partie. La vie des moines Blancs.
Appendice I. Horaire des offices les dimanches
et jours de fêtes.
Appendice II. Les 52 abbés d'Orval.
Appendice III. Les grandes dates d'Orval ressuscité.
Appendice IV. Plan pour la visite sans guide.
Vendu.
[PARMIGIANINO (Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit)]. CHIUSA (Maria Cristina) — Parmigianino. Regesto dei documenti a cura di Marzio Dall'Acqua. Nuova edizionze ampliata. Milano, Mondadori Electa, 2003. In-4° (257 x 282) sous reliure souple d'éditeur, 238 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, couverture un peu défraîchie.
Table des matières
:
- Introduzione.
- Per une biografia ragionata del Parmigianino.
- Le narrazioni mitologiche.
- La ritrattistica.
- I dipinti di devozionalità sacra.
- Le nuove acquisizioni.
Apparti :
- Opere da escludere
dal catalogo dell'artistaz.
- Catalogo delle opere.
- Parmigianino :
i documenti.
- Bibliografa.
- English Abstract.
18 euros (code de commande : 01954).
PAYNE-KNIGHT
(Richard) — Le culte
de Priape et ses rapports avec la théologie mystique des
anciens. Suivi d'un Essai sur le culte des pouvoirs
générateurs durant le Moyen Âge. Paris,
Losfeld, sd. In-8° (179 x 231 mm.) broché, 222
p., 40 planches hors texte, exemplaire non coupé, rousseurs
sur la couverture.
Réimpression
de l'édition de Londres, en 1786.
Extrait de la préface
de la deuxième édition anglaise :
Les
pages que nous offrons aujourd'hui au public éclairé
ne sont autre chose qu'un pur tribut apporté à la
science.
L'humanité, dans son développement
à travers les âges, présente le tableau de
faits et d'usages horribles et révoltants ou honteux, sur
lesquels nous sommes obligés de glisser légèrement,
sinon de nous taire tout à fait, en traitant l'histoire
au point de vue vulgaire. Cependant, si nous supprimions ou si
nous altérions ces faits, nous nuirions à l'intégrité
historique, de même que nous le ferions à la constitution
d’un individu, en supprimant quelques-uns des muscles ou
des nerfs de son corps.
Les superstitions traitées dans ces deux
Essais sont un élément inhérent à
la constitution sociale des temps anciens. Elles ont, en fait,
exercé une immense influence sur les caractères,
sur les mœurs et sur les sociétés elles-mêmes.
Il est donc nécessaire pour l'historien de les connaître
et de les apprécier, et leur étude est une des obligations
de l'archéologue.
La dissertation de Richard Payne Knight, qui
forme la première partie de notre volume, est connue, au
moins de nom, des bibliophiles et des antiquaires, comme un livre
d’une grande érudition, devenu extrêmement rare
et ne pouvant s'obtenir, lorsque l'occasion s'en présente,
qu’à des prix très-élevés.
L’auteur était membre de la Chambre
des communes et il appartenait au parti libéral. Comme,
lorsque son livre parut, les passions politiques étaient
violemment surexcitées, il fut immédiatement attaqué
par la malveillance, et on chercha à dénaturer le
caractère de son travail. Mathias, dans sa satire peu littéraire,
intitulée : Pursuits of literature, et beaucoup
d'autres dont on a reconnu aujourd'hui l'inanité des critiques,
le dénigrèrent longtemps et avec acharnement. Ce
n'était cependant pas la première fois que de semblables
sujets étaient traités, et, à cet égard,
les archéologues du continent avaient depuis longtemps
devancé Payne Knight.
Nous avons pensé qu'une nouvelle édition
du curieux travail de Payne Knight, faite dans des conditions
à le rendre plus accessible aux gens d'étude, serait
accueillie favorablement. Et comme notre auteur s'était
borné à rechercher l'origine et les premières
formes d’un culte dont l'histoire embrasse les diverses races
humaines et les temps modernes aussi bien que les anciens, nous
avons cru pouvoir ajouter une seconde partie à notre volume.
L'objet de la deuxième partie est donc
de rechercher la trace de ces superstitions parmi nous, de les
suivre à travers l'Europe occidentale pendant les époques
de transition, de déterminer l'influence qu'elles ont eue
sur l'histoire du moyen âge et sur la formation de la société
moderne ; enfin de mettre sous les yeux du public lettré
les matériaux que nous avons pu réunir.
Vendu.
RASSINIER (Paul) — Le véritable procès Eichmann ou les Vainqueurs incorrigibles. Paris, Les Sept Couleurs, 1962. In-8° (149 x 228 mm.) broché, 249 p., couverture défraîchie.
Exemplaire dédicacé par l'auteur à Jean Bernard d'Astier de la Vigerie.
Table des matières
:
- Introduction.
Première partie. Nüremberg.
Chapitre I. De Stalingrad
à Nüremberg.
Chapitre II. Nüremberg
:
A. Définition
du crime et du criminel.
B. Les
crimes de guerre.
C. Les
crimes contre la Paix.
D. Les
crimes contre l'Humanité.
E. ...
Et autres broutilles.
Chapitre III. Le Procès
Eichmann ou... Les nouveaux Maîtres-chanteurs de Nüremberg.
Deuxième partie. Versailles.
Chapitre IV. De l’entrée
en guerre des États-Unis à l’Armistice du 11
Novembre 1918.
Chapitre V. Les traités
de Versailles.
Chapitre VI. Le problème.
Appendices à la première partie.
I. Requête collective
de la Défense au Procès de Nüremberg.
II. Le Document Gerstein.
III. Le Document Kasztner.
IV. Germany must perish !
V. Médecin à
Auschwitz du Dr. Miklos Nyiszli.
40 euros (code de commande : 01945).
Revue du Nord. Tome XXXIII - n° 130-131 - Avril-Septembre 1951. Lille, Revue du Nord, 1951. In-8° (158 x 238 mm.) broché, [136 (pp. 81-216)] p.
Sommaire :
- La
fortune des Robespierre., par Gaston Martin, p. 81
- Esquisse d'une évolution industrielle.
Roubaix au XIXe siècle, par C. Pohlen,
p. 92.
- Grève des planteurs de tabac
de l'arrondissement de Saint-Pol en 1830, par A. Fortin,
p. 103.
- Le préfixe latin « foris »
dans le picard et le wallon, par N. Dupire, p. 109.
- Le convoi de la pêche à
Dunkerque aux XVe et XVIe siècles, par B. Degryse,
p. 117.
- Mélanges et Documents.
- L'emprisonnement
de l'ex-constituant Renaut à Cambrai, par M. Chartier,
p. 128.
- Le transit des émigrants
allemands par la région du Nord en 1849, par F.
Lentacker, p. 134.
- Douai aux premiers
temps de la Réforme protestante, par G. Deghilage,
p. 136.
- Répertoire
des maîtres-maçons artésiens et picards (XIe-XVIe
siècle), par P. Héliot, p. 142.
- Comptes rendus.
- Souveraineté
nationale et corporatisme en Flandre : ouvrages de F. L. Ganshof
et de J. Dhondt (E. Perroy), p. 208.
- Textes en dialecte
picard : ouvr. de N. Dupire (E. Perroy), p. 210.
- D. Hay, The Anglica
historia of Polydore Vergil (M. Mollat), p. 210.
- Inventaires et documents
publiés en Belgique (P. de Saint-Aubin et J. Godard),
p. 212.
- Chronique : Noël Dupire,
par H. Roussel, p. 149.
- Bibliographie de l'histoire de Belgique
1950, par J. Dhondt et A. Scufflaire, p. 150.
9 euros (code de commande : 01921).
Revue du Nord. Tome LXIX - n° 275 - Octobre-Décembre 1987. Le processus d'industrialisation et le secteur textile dans la France du Nord XIIIe-XXe siècle (numéro préparé dans le cadre de l'U.A. C.N.R.S. 04-1020 - Lille III). Villeneuve d'Ascq, Revue du Nord, 1988. In-8° (160 x 240 mm.) collé, [226 (pp. 709-935)] p., illustrations.
Sommaire :
- Avant-propos,
par Albert Broder.
- Articles.
- L'héritage
des draperies médiévales, par Alain Derville.
- Capitaux et industrie
textile au Moyen Âge dans les régions septentrionale,
par Gérard Sivéry.
- La situation des
industries textiles du Pas-de-Calais sous l'Ancien Régime
et au début du XIXe siècle : première
approche, par Dominique Rosselle.
- Les entreprises
textiles de Tourcoing (XVIIe-XXe siècle), par Paul
Delsalle.
- Un épisode
de la Révolution industrielle : Ouvriers à demeure,
ouvriers immigrés dans l'industrie cotonnière de
Roubaix de 1857 à 1864, par Firmin Lentacker.
- Le complexe industriel
de Roubaix-Tourcoing et le marché de la laine (1840-1950),
par Jean-Pierre Daviet.
- Le textile artificiel
: substitut de la soie ou ersatz, par Odette Hardy-Hemery.
- Vers la constitution
du textile en secteur dominant de l'économie régionale,
par Fédérico Cuñat.
- L'industrie du fil
à tricoter main, par Michel Battiau.
- Document.
- Textile
: le conflit entre Lille et Roubaix-Tourcoing au début
du XVIIe siècle, par Alain Lottin.
- Comptes rendus.
- Les pays du Nord.
Nord/Pas-de-Calais. Cadre naturel, histoire, art, littérature,
langue, économie, traditions populaires, par Robert
Muchembled.
- Histoire de Douai,
(sous la direction de Michel Rouche), par Marcel Gillet.
- Histoire de Tourcoing
(sous la direction d'Alain Lottin), par Jean Vavasseur-Desperriers.
- Jean-Claude Debeir,
Jean-Paul Deleage, Daniel Hemery, Les Servitudes de la puissance,
une histoire de l'énergie, par Jean-Pierre Daviet.
- P. Spuffort, Handbook
of médiéval exchange (Royal Historical Society
Guides Handbooks, 13), par Alain Derville.
- G. Sivéry, L'économie
du Royaume de France au siècle de saint Louis, par
Marie-Thérèse Caron.
- Ph. Wolff, Automne
du Moyen Âge ou printemps des temps nouveaux ? L'économie
européenne aux XIVe et XVe siècles, par Alain
Derville.
- Jean-Pierre Chaline,
L'affaire Noiret, par Paul Delsalle.
- Informations diverses.
- Notes et Nouvelles.
- Liste des ouvrages
reçus pour annonce ou compte rendu, 4e trimestre 1987.
- Résumés
(français, anglais, néerlandais).
- Table des matières
du tome LXIX - année 1987.
Vendu.
SANCIAUME (Joseph-Louis) — L'assassin mystérieux (Les quatre doigts). Paris, La Bruyère, 1950. In-8° (125 x 188 mm.) broché sous une couverture illustrée par Ray Ducatez, 148 p., (collection « La Cagoule », n° 75).
Extrait de la notice
de Henri-Yvon Mermet :
Joseph-Louis
Sanciaume (1903-1976) fut l'auteur de nombreux romans populaires
(dont certains écrits avec son frère Julien), il
a produit des romans sentimentaux ou pour la jeunesse mais s'est
surtout consacré au genre policier. Dans les années
30, il publie dans la célèbre collection « À
ne pas lire la nuit », puis alimente après-guerre
des collections moins prestigieuses, notamment « La
Cagoule ». L'un de ses romans eut toutefois les honneurs
du « Masque », Meurtre à la Préfecture
(1957), une histoire pleine de rebondissements mais d'un sentimentalisme
falot.
Il connut un certain succès avec ses
pièces radiophoniques, « Les Aventures de l'inspecteur
Vitos », « Gil Montagne détective »,
« Inspecteur Léonard », « Inspecteur
Vif », et avec la série « Serge Murat
détective », écrite en collaboration
avec Raymond Labonne.
Bibliographie :
- Mermet (Henri-Yvon), Chase, James
Hadley, dans Dictionnaire des littératures policières,
t. 2, pp. 618-619.
8 euros (code de commande : 01922).
SMITH (David W.) — Types reconnaissables de malformations humaines. [Titre original : Recognizable Paterne of Human Malformation Genetic, Embryologic ans Clinical Aspects.] Traduit de l'anglais par Pierre Haegel. Paris, Masson et Cie, 1974. In-8° (190 x 258 mm.) sous reliure toilée d'éditeur, XIII, 387 p., nombreuses illustrations en noir, rare.
Introduction :
Les
questions soulevées par Paget sont toujours d'actualité.
Chaque malformation représente une erreur innée
de la morphogenèse. De même que l'étude des
erreurs innées du métabolisme a fait progresser
la compréhension de la biochimie normale, de même
l'accumulation de notions concernant les anomalies de la morphogenèse
pourra nous aider dans le défrichage ultérieur de
l'histoire du développement de l'organisme.
La majeure partie de ce livre est consacrée
à des types de malformations, mais on y trouvera aussi
des chapitres traitant de la morphogenèse et de la génétique
ainsi qu'un chapitre de diagnostic des anomalies mineures comprenant
les altérations dermatoglyphiques. Nous espérons
que la présentation du texte facilitera son application
clinique pratique aussi bien que son emploi comme référence
de base pour ceux qu'intéresse une meilleure compréhension
des troubles de la morphogenèse. En outre, les tableaux
ont été conçus pour être directement
utilisables quand on est amené à conseiller les
patients et les parents.
Sept enfants sur mille naissent avec des malformations
multiples. Faire le diagnostic exact du syndrome malformatif est
un préalable impératif pour évaluer correctement
le pronostic, établir un plan thérapeutique pour
l'enfant et conseiller les parents au point de vue génétique.
Ce qui suit est la méthode personnelle
de l’auteur pour l'investigation d’un sujet atteint
de malformations multiples.
1. Rassembler l'information. Un aperçu
de l’anamnèse et de l'examen physique est détaillé
dans l'appendice A. Le chapitre 5 présente quelques-uns
des défauts mineurs qui sont des indices valables de syndromes
malformatifs.
2. Interpréter les anomalies dans
leur contexte morphogénétique en s'efforçant
de répondre aux questions suivantes :
a) pour un sujet donné,
quelle est l'anomalie qui relève du défaut morphogénétique
le plus précoce ? Un tableau à cet usage est
inclus dans le chapitre 3, Morphogenèse. On peut alors
situer avec exactitude l'anomalie du développement à
un âge prénatal précis, et aucun facteur tératogène
ultérieur à ce stade ne peut être à
l'origine de la malformation.
b) le défaut envisagé
est-il primaire ou secondaire ? La morphogenèse est
un processus chronologique séquentiel dans lequel le défaut
d’une structure peut compromettre le développement
ultérieur d'autres structures. On doit essayer de déterminer
rétrospectivement quelle a été l'anomalie
initiale. Cette notion permet de grouper les sujets atteints de
syndromes malformatifs multiples sous deux rubriques générales :
- Ceux
qui ont un syndrome unique dans lequel les anomalies constatées
relèvent toutes d’un seul défaut localisé
initial, à conséquences secondaires variées.
Le chapitre 1 décrit quelques-uns de ces syndromes.
- Ceux
qui ont été atteints de plusieurs défauts
primaires, soit en plusieurs endroits d’un même appareil,
soit disséminés à plusieurs organes différents.
Ils font l'objet du chapitre 2.
3. Essayer d'arriver à un diagnostic
général, à confirmer dès que possible
et en tirer la conduite ultérieure. Quand c’est
possible, la ligne de conduite est la suivante : compréhension
du processus qui a altéré les structures, description
physique de la malformation, mesures qui peuvent être envisagées
pour aider l'enfant, précisions sur l’étiologie
et recommandations génétiques (risque de récidives).
75 euros (code de commande : 01948).
[SOIGNIES].
Soignies. Mons et Frameries,
Union des Imprimeries, 1930. In-8° (164 x 249 mm.) broché,
15, 23, 2, 2, 89 p., illustrations et 22 planches hors texte avec
leurs serpentes, rousseurs éparses, exemplaire non coupé
et en très bon état.
Cet ouvrage
a été publié à l'occasion du Congrès
Archéologique et Historique de Mons.
Sommaire :
1.
Soignies, par l'abbé J. Desmette.
2. La Collégiale Saint-Vincent,
par le chanoine R. Maere.
3. La « mise au tombeau »
de la Collégiale Saint-Vincent.
4. La vierge de la Collégiale Saint-Vincent
et la vierge de Bonne-Espérance, par le comte J.
de Borchgrave d'Altena.
5. Les objets d'art et d'antiquité
du canton de Soignies, par E.-J. Soil de Moriamé.
Cette étude concerne
les localités de Soignies (la ville), Braine-le-Comte,
Écaussinnes d'Enghien, Écaussinnes Lalaing, Hennuyères,
Henripont, Horrues, Naast et Ronquières.
12 euros (code de commande : 01935).
STEEMAN
(Stanislas-André) — La maison des veilles. Roman. Bruxelles, Les Auteurs Associés,
1942. In-8° (120 x 183 mm.) broché, 226 p.,
(collection « Les Meilleurs Romans Policiers »,
n° I), rousseurs à la couverture.
Un « roman
qui a le tort de venir trop tôt et que refusera « Le
Masque ».
En quatrième de
couverture de la réédition dans la collection « Espace
Nord » :
L’immeuble
bruxellois où habite l’inspecteur Côme ne s’anime
vraiment que pendant la soirée. Mais ce soir-là…
un coup de feu. Dans un placard, le cadavre d’un inconnu.
Lequel des locataires soupçonner ? Quelles intrigues et
quels secrets se cachent derrière les portes de ces dix
appartements ? Steeman agence son récit comme un orfèvre,
et c’est l’âme de la maison qui s’éveille.
Si vous entrez, faites attention : le mystère est dans
l’escalier.
Bibliographie :
- Thoveron (Gabriel), « Steeman,
Stanislas-André », dans Dictionnaire des
littératures policières (Claude Mesplède
dir.), t. II, pp. 708-710.
Vendu.
[STENDHAL (pseudonyme de Henri Beyle)]. Album Stendhal. Iconographie réunie et commentée par V. Del Litto. Paris, Gallimard, 1966. In-8° (113 x 177 mm.) sous reliure, jaquette (imprimée pour la librairie J. Bonnel, à Maubeuge), Rhodoïd et étui d'éditeur, [8], 321, [19] p., (collection « Albums de la Bibliothèque de la Pléiade », n° 5), exemplaire en très bon état.
Extrait de l'avertissement
:
Plusieurs
des études biographiques consacrées à Stendhal
depuis une trentaine d'années sont accompagnées
d'une illustration plus ou moins sommaire et, en quelque sorte,
accessoire, depuis le Stendhal d'Alain paru chez Rieder
en 1935, et qui a constitué une nouveauté pour l'époque,
jusqu'à notre très récente Vie de Stendhal
(1965), en passant par le petit livre île Claude Roy,
Stendhal par lui-même (1951), et l'ouvrage que tout
stendhalien se doit de connaître, Le Cœur de Stendhal,
par Henri Martineau.
Le seul recueil iconographique – car
on ne peut qualifier de ce nom L'Iconographie de Stendhal entrebâillée
de Paul Guillemin (1916), stendhalien passionné certes,
mais candide et non préparé à ce genre de
travaux – est celui d'Henry Débraye, Stendhal.
Documents iconographiques, publié en 1950 chez Cailler
à Genève. En réalité, il ne s'agit
pas d'une véritable iconographie systématique, mais
simplement du catalogue illustré du Musée Stendhal
de Grenoble, dont l'auteur a été le conservateur
de 1938 à 1948. En effet, l'ouvrage reproduit – avec
un classement rudimentaire et contestable : portraits et
faux portraits de Stendhal, portraits de ses amis et connaissances,
sites et paysages, fac-similés – un certain nombre
de pièces de ce Musée, pièces dont l'intérêt
est fort inégal, les portraits originaux et d'une inestimable
valeur par Dedreux Dorcy et par Lehmann voisinant avec de médiocres
reproductions, d'anciennes et mauvaises photographies, voire des
cartes postales ; il faut souligner aussi que les collections
du Musée sont loin d'être complètes.
Cet Album est donc le premier essai d'iconographie
stendhalienne proprement dite.
70 euros (code de commande : 01940).
[VANDERVELDE (Émile)]. POLASKY (Janet) — Émile Vandervelde, le patron. Préface de Philippe Moureaux. Bruxelles, Labor, 1995. In-8° (150 x 215 mm.) broché, 298 p., illustrations hors texte, (collection « Archives du Futur - Histoire »), exemplaire en bon état.
En quatrième
de couverture :
Émile Vandervelde, homme de pensée
et d'action, socialiste, révolutionnaire et démocrate,
figure centrale de l'histoire de Belgique, est une source certaine
d'inspiration en un temps où la gauche cherche à
redéfinir ses valeurs.
« Patron » du Parti Ouvrier
Belge de 1885 à 1938, date de son décès,
Émile Vandervelde a construit l'instrument politique qui
donna la parole à la classe ouvrière. Cherchant
la voie difficile entre ses convictions marxistes, son enthousiasme
révolutionnaire et ses exigences morales, il utilisa pleinement
les ressources du régime parlementaire qu'il contribua
à démocratiser. Inventeur de ce réformisme
révolutionnaire qui conduisit de la grève générale
politique, particularité belge, à la transformation
par l'intérieur du système social, en passant par
le rôle particulier qu'il joua dans la question congolaise
et la Révolution russe, il lança ses dernières
forces dans le combat pour l'Espagne républicaine.
Émile Vandervelde fut aussi Président
de l'Internationale socialiste pendant près d'un demi-siècle,
côtoyant Engels, Jaurès, Kautsky, Lénine,
aussi bien que Adler et Léon Blum.
Vendu.
VERGÈS
(Jacques), ZAVRIAN (Michel) et COURRÉGÉ (Maurice)
— Le droit et la colère. Paris,
Les Éditions de Minuit, 1960. In-8° (120 x 187 mm.)
broché, 174 p., (collection « Documents »),
exemplaire non coupé.
Exemplaire du
tirage courant de l'édition originale de cet ouvrage publié
en pleine guerre d'Algérie.
En quatrième de
couverture :
Les
trois avocats du barreau de Paris auteurs de cet ouvrage ont adressé
il y a quelque temps un mémoire au Comité international
de la Croix Rouge. Ils y attiraient notamment l'attention de cet
organisme sur le caractère proprement inouï de la
nouvelle organisation judiciaire instituée par la France
en Algérie.
L'émotion provoquée par cette
démarche, en France et dans le monde, n'est pas près
de s'apaiser. C'est tout le principe en effet du droit dans les
nations civilisées qui est mis en cause par le décret
du 12 février 1960. Verrons-nous notre législation
traditionnelle céder la place à ce que M. Michel
Debré a appelé un jour, paradoxalement, « les
droits légitimes de la colère » ?
La question est posée.
30 euros (code de commande : 01927).
VOLLARD
(Ambroise) — Le père Ubu à la guerre. Dessins de Jean Puy. Paris, Éditions
Georges Crès & Cie, 1920. In-8° (144 x 170 mm.)
sous couverture rempliée, 116 p., 3 illustrations
(une à la couverture, une vignette de titre, une à
pleine page), un des 500 exemplaires numérotés sur
Hollande (n° 131), exemplaire à toutes marges
et non coupé, comme sur la plupart des exemplaires, la
couverture rempliée a bruni les marges des premier et dernier
feuillets.
Édition
originale.
En quatrième
de couverture de la réédition dans la collection
« Mille et une nuits » :
Ubu
roi est mort, vive le Père Ubu !
En 1917, la créature d'Alfred Jarry,
disparu en 1907, reprend du service. Le Père Ubu passe
en revue les troupes, inspecte les états-majors, visite
les hôpitaux et se fait expliquer la guerre. Merdre !
Il en découvre de belles. Des estropiés, des éclopés,
des gueules fracassées, des médecins vicieux et
des officiers planqués. Et des politiciens soucieux de
sauver leur peau, qui se contredisent sans complexe.
Ambroise Vollard, le fameux marchand de tableaux
et ami complice de Jarry, met en scène, avec force détails
délirants, tout le cirque du grand « casse-pipe »
qu'est la guerre de 1914-1918.
Vendu.
WILBAUX (Jules) — Contribution à l'histoire artistique. L'origine de l'art occidental par l'âge de la cathédrale de Tournai. Tournai, Casterman, 1936. In-4° (193 x 259 mm.) broché, 62 p., illustrations hors texte, petit manque au coin supérieur du premier feuillet de la couverture.
Un livre peu courant avec une belle dédicace de l'auteur.
Extrait :
Sur
le plan des questions scientifiques ou historiques, l'origine
de la Cathédrale de Tournai peut occuper une place en vedette
qui lui est refusée arbitrairement. La gravité de
l'objet semble avoir échappé à la trop grande
majorité des chercheurs et surtout à la sagacité
de la critique moderne.
L'âge du monument fait toujours l'objet
d'une controverse des plus animées entre les partisans
d'une haute antiquité rapportée par la tradition
orale et les défenseurs des axiomes archéologiques
dont l'application ne permet pas de situer l'œuvre avant
le milieu du XIIe siècle, comme il résulte des débats
du Congrès de 1921 à Tournai.
Soucieux de précisions à cet égard,
nous avons réclamé avec insistance la raison exacte
de cette fixation d'origine. Voici la réponse qui nous
fut donnée : L'œuvre est trop belle, trop complète
pour s'accorder avec la logique de l'évolution de l'art
Roman et ne pas représenter une réelle expression
d'apogée de ce style, c'est-à-dire une œuvre
en marge, une exception impossible, comme le prétendaient
les défenseurs de la version précédente qui
acceptèrent la fameuse dédicace du 9 mai 1066. Une
pareille date offense la doctrine généralement acceptée ;
en conséquence, Tournai n'a pas à invoquer le droit
d'exception. D'ailleurs, la raison constructive du monument nous
serait fournie par le fait de la séparation diocésaine
qui voit Tournai reconquérir, en 1146, l'avantage d'un
Évêque particulier : Anselme occupant le siège,
la cathedra de l'Église. Il y a donc relation de
cause à effet s'accordant avec la logique, comme il y a
concordance entre l'œuvre et les principes archéologiques.
La question est entendue !
20 euros (code de commande : 01933).
WILLARD
(Marcel) — Le procès de Moscou. Boukharine, Rykov,
etc. Comment ils ont avoué. Paris,
Bureau d'Éditions, 1938. In-8° (135 x 211 mm.)
agrafé, 32 p., rousseurs à la couverture.
Une publication
peu courante.
Marcel Willard (Paris, 1889-1956) fut
secrétaire du Groupe des avocats communistes, secrétaire
général à la Justice à la Libération
et membre du Conseil de la République. À son retour
de la Première Guerre mondiale, il adhéra à
la S.F.I.O. et en 1923 il participa aux activités de la
Fédération communiste de la Seine avant de devenir
chroniqueur judiciaire à l'Humanité. À
la Libération, en août 1944, il devint, après
quelques péripéties, le premier Secrétaire
général à la Justice.
Ses activités au sein du PCF le menèrent
à effectuer des voyages en U.R.S.S.. À ce propos,
Rachel Mazuy écrit : « Ses convictions
communistes ont encore été renforcées par
ce deuxième voyage qui l’intègre davantage
dans le réseau international du MOPR [ou Secours rouge
international]. Ce séjour lui permet en effet de multiplier
les contacts soviétiques et de jouer un rôle de propagandiste
et de lobbyiste pour le SRI et l’AJI, non seulement en dehors
de l’URSS, mais également en URSS.
Au retour, Marcel Willard participe aux activités
de propagande antifasciste des organisations communistes, même
s’il conviendrait de revenir plus longuement sur les détails
de son action. Il serait ainsi intéressant de savoir comment
Marcel Willard a réagi en apprenant l’exécution
d’une partie de ses correspondants soviétiques de
1934, quelques mois après son retour d’URSS. S’il
intervient lors de réunions publiques, donne des entretiens,
il n’écrit cependant pas immédiatement de véritable
récit de voyage, ni d’essai sur l’URSS. Ses activités
militantes, de plus en plus prenantes, expliquent sans doute cette
absence. Cependant, en 1938, il a sans doute utilisé les
notes constituées lors de ses deux voyages soviétiques
pour publier sa brochure de défense des procès de
Moscou ainsi que son important essai La Défense accuse.
Sa vision est en effet parfaitement conforme à la représentation
qu’il a construite en percevant la réalité
soviétique de 1934. En visitant les grands chantiers des
plans quinquennaux, il a en particulier parfaitement intégré
l’idée que le sabotage serait le principal facteur
qui nuit à la construction du socialisme. Aussi, en 1938,
n’a-t-il plus besoin de voir, pour croire que les accusés
des procès de Moscou sont des espions et des saboteurs.
Bibliographie :
- Mazuy (Rachel), « Propagandiste
pour la solidarité internationale et l’URSS : Marcel
Willard et le SRI (été-automne 1934) »,
dans Histoire documentaire du communisme, Jean Vigreux
et Romain Ducoulombier [dir.], Territoires contemporains
- nouvelle série [en ligne], 3 mars 2017, n° 7.
15 euros (code de commande 01928).
aura lieu
le mardi 21 janvier 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone ou sms (+32 (0) 472 51 52 63).
Ces livres peuvent être retirés à l'adresse figurant dans l'en-tête du blog.
En cas d'envoi postal, veuillez indiquer le pays vers lequel le colis devrait être expédié, cela me permettra de vous indiquer les modalités de livraison et de paiement.