MISE À JOUR DU 15 AVRIL 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone (+32 (0) 472 51 52 63)
pour obtenir d'autres informations à propos de ces livres.
ANSIEAU
(Cécile) et WATERLOT (Bernard) — Tous les chemins
mènent au Vodgoriacum. La représentation de la Gaule
et des chaussées romaines au travers des cartes anciennes.
Mons, Éditions Musea
Nostra, 2025. In-8° (200 x 271 mm.) collé, 48 p.,
illustrations en couleurs, 15 cartes à déplier.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
par l'A.S.B.L. Statio Romana, au Musée Gallo-Romain de
Waudrez, du 8 avril au 2 novembre 2025.
En quatrième de
couverture :
Malgré
son grand âge, la chaussée qui mène de Bavay
à Cologne, vestige archéologique antique, reste
bien inscrite dans le paysage de la Wallonie depuis plus de 2000
ans. De nombreuses fois remaniée, elle a été
utilisée au fil des siècles et continue à
l’être de nos jours sur de nombreux tronçons.
Le vicus de Vodgoriacum attesté
sur les itinéraires romains, aujourd’hui Waudrez près
de Binche, constitue la première station située
à une trentaine de kilomètres de la capitale des
Nerviens, Bavay.
Le Centre d’interprétation de la
Chaussée Romaine qui est installé au cœur même
du Vodgoriacum nous semblait l’endroit idéal pour
montrer au public comment cette importante voie de communication
et les agglomérations qui la jalonnent étaient représentées
dans la cartographie des XVIIe et XVIIIe siècles.
L’exposition qui a donné lieu à
cette modeste publication suscitera, nous l’espérons,
le développement d’un travail plus important afin
d’approfondir un sujet inédit et riche d’enseignement
historique...
25 euros (code de commande : 02198).
[ALBANIE]. Conférence nationale des études sur la lutte antifasciste de libération nationale du peuple albanais. Tirana, Éditions « 8 Nëntori », 1975. In-8° (137 x 193 mm.) sous reliure d'éditeur, 209 p., exemplaire en très bon état.
En quatrième
de couverture :
- Discours
d’ouverture du Président de l’Académie
des Sciences, le Professeur Aleks Buda.
- La Lutte antifasciste de libération
nationale, grande révolution populaire conduite par le
Parti Communiste d’Albanie, par Nexhmije Hoxha.
- L’union du peuple autour du Parti
Communiste d’Albanie dans le Front de libération nationale,
par Ndreçi Plasari.
- L’insurrection armée du
peuple albanais dans la Lutte antifasciste de libération
nationale, par Vehbi Hoxha et Ndreçi Plasari.
- La question du pouvoir dans la Lutte
antifasciste de libération nationale du peuple albanais,
par Luan Omari.
- Le Mouvement de libération
nationale du peuple albanais et la Lutte antifasciste mondiale,
par Shyqri Ballvora et Sotir Manushi.
- Problèmes de la culture nouvelle
durant la Lutte antifasciste de libération nationale,
par Bedri Dedja et Dhimitër S. Shuteriqi.
- Conclusions de la Conférence
nationale des études sur la Lutte antifasciste de libération
nationale du peuple albanais, par Ndreçi Plasari.
- Discours de clôture du Président
de l’Académie des Sciences, par le Professeur Aleks
Buda.
10 euros (code de commande : 02209).
ANDROPOV (Iouri Vladimirovitch) — Le léninisme, science et art de la création révolutionnaire. Rapport présenté à la réunion solennelle tenue à Moscou à l'occasion du 106e anniversaire de la naissance de V.I. Lénine. Moscou, Agence de Presse Novosti, 1976. In-8° (116 x 165 mm.) agrafé, 28 p., exemplaire en très bon état.
Préambule :
Camarades,
Il y a aujourd'hui 106 ans naissait Vladimir
Ilitch Lénine, révolutionnaire et penseur de génie,
créateur de notre parti, fondateur du premier État
socialiste du monde. État des ouvriers et des paysans.
Nous commémorons cette date marquante peu après
le XXVe Congrès du P.C.U.S., dans le climat d'un nouvel
élan de tout le peuple, d'une croissance continue de l'activité
des Soviétiques dans le domaine politique et au travail.
C'est avec le nom de Lénine, continuateur
de la grande œuvre de Marx et d'Engels, qu'est entrée
dans le XXe siècle la révolution prolétarienne
victorieuse qui a inauguré une ère nouvelle dans
l'histoire mondiale. C'est avec le nom de Lénine qu'est
entrée dans notre siècle la communauté mondiale
des pays du socialisme. Sous le drapeau de Lénine, du marxisme-léninisme,
grandit et s'étend le mouvement irrésistible vers
la liberté et la justice, vers le socialisme, vers les
sommets du progrès social.
Le temps est impuissant devant le léninisme.
Impuissant parce que celui-ci, reflétant fidèlement
les lois objectives de l'histoire, prenant appui sur tous les
acquis de la pensée sociale avancée, assimile sans
cesse tout ce que le temps apporte de nouveau. Le léninisme,
c'est la création permanente, l'analyse et la généralisation
des changements sociaux, c'est le renouvellement incessant de
la théorie révolutionnaire sous l'influence de la
pratique révolutionnaire.
« Toute la vie de Lénine,
a souligné le camarade Brejnev, a été une
œuvre de création permanente, création en théorie,
en politique, dans l'organisation de la lutte des classes, dans
l'édification du parti et de l'État. Et il a inculqué
ces qualités de créateur à notre grand parti
qui continue à porter aujourd'hui avec honneur son drapeau,
le drapeau du communisme. » (L. Brejnev. L'œuvre
de Lénine vit et triomphe, Moscou 1970, p. 20.)
Le Parti communiste de l'Union Soviétique
considère la fidélité au léninisme
comme une loi intangible de son activité théorique
et pratique. Aussi, le caractère scientifique le plus strict
et l'esprit révolutionnaire conséquent, l'analyse
approfondie des phénomènes sociaux et le service
dévoué des intérêts du peuple sont-ils
inséparables pour le parti. C'est la raison pour laquelle
le parti relie le développement créateur de la théorie
à l'activité pratique des masses, aux tâches
fondamentales de l'édification du communisme dans notre
pays, au progrès du socialisme mondial, de tout le mouvement
communiste et ouvrier international.
Le léninisme a toujours été
et reste, pour le P.C.U.S., pour les révolutionnaires prolétariens
du monde entier, une véritable science de la victoire,
une science et un art de la création révolutionnaire
qui ouvre de nouveaux horizons à toute l'humanité.
10 euros (code de commande : 02200).
BARTEL (Paul) — Napoléon à l'Île d'Elbe. Préface de Jacques Bardoux. Paris, Librairie Académique Perrin, 1947. In-8° (145 x 226 mm.) broché, IX, 370 p., illustrations hors texte, couverture partiellement souillée.
Préface :
L'excellent
écrivain Paul Bartel nous raconte, dans les pages qui suivent,
que nombreux furent les Français et étrangers qui,
avant le retour de l'Île d'Elbe, allèrent, en touristes,
visiter le royaume miniature et saluer l'Empereur découronné.
Toujours reçus, accueillis avec courtoisie, ils revinrent
moralement conquis.
L'ombre de Napoléon a reçu de
même Paul Bartel. Elle l'a accompagné partout. Elle
lui a tout montré. Elle lui a présenté ses
compagnons. En outre, Paul Bartel a recueilli tous les témoignages
et dépouillé bien des dossiers. Et voici qu’à
travers ces pages émouvantes, dans les tableaux qu’il
brosse et dans les portraits qu'il campe, éclate la même
admiration qu'éprouvaient les touristes de 1814.
Comment a-t-il été conquis ?
Par les victoires du Général ?
Certainement pas. Paul Bartel n'en parle pour ainsi dire jamais.
Par la silhouette de l'Empereur ? Alourdie,
épaissie, bouffie, elle n’est plus celle si prenante,
au visage émacié, au torse amaigri, du premier Consul.
Mais Paul Bartel n'a pas été insensible
à l'attirance des yeux, qui brillent d’un éclat
magnétique et reflètent la lumière du génie.
Il a noté les caractères de cette
bouche napoléonienne petite et pure, aux lèvres
étroites et aristocratiques, qui n'a ni la sensualité
du soldat, ni la dureté du maître, mais participe
à la spiritualité du penseur et à l'affinement
de l'artiste.
Certes l’auteur du livre a dû constater,
même au cours de ce bref épisode et dans ce domaine
restreint, l'universalité de l'intelligence napoléonienne
et la capacité de ce magnifique constructeur. On comprend
mieux ce qu'a pu être le rendement de l'œuvre consulaire
et l'ordre de l’Empire français, lorsqu'on voit avec
quelle rapidité dans la conception et quelle précision
dans l'exécution le Bonaparte de l'Île d'Elbe a,
en quelques mois, assaini et nettoyé, défriché
et bâti, recruté et organisé, administré
et armé.
Mais, si Paul Bartel insiste autant sur les
propos et les gestes qui révèlent à l'historien
que ce César était profondément peuple et
ce soldat naturellement humain, c’est que ces traits caractéristiques
lui ont inspiré son culte pour Napoléon, de même
qu'ils expliquent rattachement des vieux soldats et l'emprise
sur les masses françaises. L'ouvrage abonde en anecdotes
lumineuses cl en citai ions probantes. Malgré la richesse
de l'histoire napoléonienne, qu'ont brossée les
Madelin, Frédéric Masson et Octave Aubry, l'écrivain
a pu nous apporter sur la vie sentimentale cl sur la religiosité
païenne de Napoléon des analyses qui révèlent
ses réactions et sa mentalité de paysan corse.
D'autre part, je ne connais pas, dans cet ouvrage
solide et abondant, de pages plus émouvantes que celles
consacrées au Bataillon des grenadiers de la Garde qui
accompagna l'Empereur dans la descente vers l'exil, dans l'Île
d'Elbe et dans la remontée vers Paris.
Conquis par le génial ouvrier de la Reconstruction
et de la Victoire, qui sut, en même temps, parce qu'il était
humain et paysan les comprendre et leur parler, les grognards
et leurs petits-fils, mes montagnards d'Auvergne, ont pardonné
à Napoléon d'avoir, par son orgueil et par ses fautes,
compromis l'œuvre politique de la Révolution française
qu’il incarnait, laissé une France plus petite que
celle qu'il avait reçue et ainsi gâché la
plus rapide et la plus étonnante montée, depuis
un millénaire, de la Nation Française, vers la grandeur
impériale, sur la route de Charlemagne.
9 euros (code de commande : 02214).
BOINVILLIERS (Jean-Étienne-Judith Forestier) — Apollinei operis carminum, redditi quibus priores numeri, libri tres ; Accurante J. S. J. F. Boinvilliers. (Ou corrigé de l'Apollineum opus). Quinta editio. Paris, Delalain, 1824. [Parisiis, / Ex Typis Augusti Delalain, / Bibliopolae-Editoris, viâ Mathurinensium, n° 5. / 1824.] In-12 (102 x 168 mm.) modeste demi-parchemin, dos lisse, 6, 268 p.
Préface :
Il
ne suffisait pas, à notre avis, de présenter aux
jeunes nourrissons des Muses un grand nombre de matières
de compositions poétiques où les difficultés
fussent graduées à dessein ; il fallait encore
donner aux Professeurs ces mêmes compositions telles qu'ils
doivent, suivant une sage institution, les mettre sous les yeux
de leurs disciples, comme des modèles à suivre :
c'est pourquoi nous avons cru devoir imprimer séparément
le Corrigé de l'Apollineum Opus.
On ne nous fera pas sans doute un crime d'avoir
donné ce Corrigé ; on ne supposera pas qu'en
l'offrant aux personnes qui sont aujourd'hui chargées de
l'enseignement public, nous ayons conçu une opinion trop
peu avantageuse de leur savoir. Il est possible, nous sommes-nous
dit, qu'un grand nombre de Professeurs et surtout de Maîtres
d'études, n'aient pas le loisir de travailler les matières
renfermées dans cet ouvrage, ou qu'ils aient perdu l'habitude
de composer des vers latins : ce sera donc un service à
rendre aux uns et aux autres, que de leur présenter le
Corrigé des poésies qu'ils auront données
en matières de compositions. Le besoin de nous rendre utile
a seul déterminé notre conduite à cet égard ;
il doit pleinement nous justifier. Le présent Recueil ne
contenait que les poésies du troisième et du quatrième
livre ; mais nous avons cru devoir renfermer dans cette nouvelle
édition celles du livre second, quoique, à dire
vrai, elles ne comportent aucune difficulté capable d'arrêter
un Professeur, (en effet ce second livre n'offre que des vers
à retourner, quelques changements de mots, ainsi que des
synonymes et des épithètes par nous indiqués).
Quant au premier livre il est exclusivement consacré à
la théorie des règles de la versification latine,
à l'enseignement des différentes espèces
de vers, et de là manière de les assortir, enseignement
qu'on a fort mal à-propos négligé jusqu'à
cette époque.
Comme nous avons fait précéder
notre Dictionnaire poétique latin-français (ou Gradus
ad Parnassum) de vingt-six pièces de vers hexamètres,
offertes aux étudiants en matières de compositions,
et qu'il est nécessaire, à notre avis, d'en donner
le Corrigé à MM. les Instituteurs, nous avons fait
précéder du Corrigé de ces matières,
la cinquième édition que nous publions aujourd'hui
de l'Apollinei Operis Carmina.
Nous croyons devoir rappeler ici, que ne voulant
pas favoriser la paresse de quelques élèves, nous
ne fournirons ce Corrigé imprimé, qu'aux personnes
qui justifieront de leur profession d'Instituteurs ; elles
le trouveront, ainsi que l'Apollintum Opus, chez le même
Imprimeur-Libraire, rue des Mathurins-St.-Jacques, n° 5,
à Paris.
20 euros (code de commande : 02205).
BUSLIN (Hector) et COLMANT (Richard) — Nouvelle histoire de Cuesmes. [Cuesmes], [chez les auteurs], 1970. In-8° (160 x 240 mm.) broché, 78 p., bon exemplaire.
Table des matières
:
Chapitre
I. Le milieu, les premières armes, les premiers outils.
- Étymologie de
Cuesmes.
- Les chartes de Cuesmes.
- Le sceau communal.
- Particularités
onomastiques et géographiques.
- Chevaliers et Maires
de Cuesmes.
- Les Bourgmestres de
1802 à nos jours.
- Curés et Pasteurs
protestants de notre paroisse à travers les siècle.
Chapitre II. Géographie physique et politique.
I. L'Éribus.
II. Le Genestroit.
III. Le Joncquois.
Chapitre III. La vie à Cuesmes sous les
différentes dominations.
- Période belgo-romaine.
- La domination franque.
- La période féodale.
- Première période
autrichienne (1482-1555).
- Période espagnole
(1555-1714).
- Deuxième période
autrichienne (1714-1794).
- Bataille de Jemappes.
- Période française
(1794-185).
- Domination hollandaise
(1815-1830).
- La guerre mondiale
(1914-1918).
- De 1920 à 1940.
- La guerre 1940-1945.
Chapitre IV. Le sol de Cuesmes et ses richesses.
- Le charbon.
- Formation de la S.A.
des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu.
- Les autres richesses
du sol de Cuesmes : craie grise, craie blanche, tuffeau,
argile.
- Briqueteries et panneteries.
- Anciennes usines -
Usines actuelles.
Chapitre V. Sports et agréments.
- Le jeu de balle.
- La boxe.
- Le football.
- Le cyclisme.
- La lutte.
- Le ping-pong.
- Le basket-ball.
- Les sociétés
de gymnastique.
- Les sociétés
musicales.
- Les sociétés
chorales.
- Les cercles dramatiques.
- Les sociétés
de tir à l'arc.
- Les autres sociétés.
Vendu.
[CANTILLON (Arthur)]. RENARD (Raymond) — Arthur Cantillon. Sa vie, son œuvre. Préface par Alexandre André. Mons, Éditions du Fonds Raoul Warocqué, 1958. In-8° (142 x 203 mm.) broché, 206 p., exemplaire non coupé et à l'état de neuf.
Préface :
L'intéressant
et substantiel discours prononcé en octobre 1957 devant
le Conseil Provincial par M. le Gouverneur Émile Cornez
était exclusivement destiné à signaler la
valeur inestimable du patrimoine spirituel du Hainaut.
Il faut le reconnaître, l'imposant inventaire
qu'a minutieusement dressé M. le Gouverneur Cornez a surpris
bon nombre d’Hennuyers cultivés. La Wallonie a possédé
et possède encore des talents abondamment divers, tant
dans le domaine des arts que dans ceux des sciences ou des lettres,
mais beaucoup de ses richesses demeurent souvent méconnues
ou insoupçonnées, faute d’une documentation
suffisante.
On comprendra donc aisément que je salue
avec enthousiasme l'attachante contribution à cette nécessaire
information qu'apporte aujourd'hui M. Raymond Renard, Docteur
en Philologie romane et Professeur d’une de nos plus hautes
Écoles.
À ce jour, aucune étude critique
d'ensemble n'a été publiée sur Arthur Cantillon,
écrivain délicat dont les mérites incontestables
furent consacrés par l'attribution, en 1925, du Prix du
Hainaut pour la Littérature.
Arthur Cantillon, conteur, essayiste, dramaturge,
poète, appartient à cette race d'hommes dont l'existence
douloureuse et édifiante a considérablement influencé
l'œuvre. M. Raymond Renard a donc fort opportunément
présenté les avatars de l'une avant d'envisager
les aspects multiples de l'autre.
Il l'a fait avec la rigueur scientifique et
dans la langue sobre et élégante qui caractérise
ses travaux ; il l'a fait aussi avec l'amour qui saisit le
cœur de tout homme de bien lorsqu'il approfondit l'œuvre
d’un pur poète.
Je suis convaincu qu’il aura ainsi réussi
à ranimer le souvenir d’une personnalité exceptionnelle
qui voua sa vie au mieux-être de ses semblables et voulut
faire de son œuvre un authentique chant d'espérance
et une poignante leçon de fraternité.
13 euros (code de commande : 02222).
[CARTE-POSTALE - MARIAKERKE]. Mariakerke.
Vue de la digue. Les hôtels. Carte
postale 137 x 90 mm.
On distingue,
à l'avant-plan, l'hôtel Quimann, bâti à
la fin du XIXe siècle, il devint ensuite l'hôtel
Monopole avant d'être détruit et remplacé
par l'actuelle « Résidence Monopole »,
à l'adresse Albertushelling, 1, à Mariakerke (Ostende).
Cette carte ne porte pas de mention d'édition,
mais un numéro : « 77 ». Au verso
on trouve, imprimée en rouge, la publicité du « Chocolat
des Chartreux - Dépôt : Confiserie Ducardon,
Mons ».
7 euros (code de commande : 02197).
[CHARLEROI]. Documents et Rapports de la Société Royale d'Archéologie et de Paléontologie de l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Tome XLVIII. 1950. Charleroi, Héraly, 1951. In-8° (168 x 249 mm.) broché, XI, 286 p., illustrations, exemplaire en bon état.
Table des matières
:
- Commission administrative de la Société
Royale d'Archéologie et de Paléontologie de Charleroi,
p. V.
- Rapport sur l'activité de la Société
de 1948 à 1950, p. VII.
- Nécrologie, p. XI.
- Le trésor de Lompret, par
G. Faider-Feytmans, p. 1
- Contribution à l'histoire de
l'archidiaconé liégeois de Hainaut et spécialement
du doyenné de Thuin (sources, documents et notes),
par André Culot, p. 11.
- Beaumont sous la restauration et les
Cent Jours (deux ans d'histoire de France vus d'une petite ville
wallonne), par Francis Dumont, p. 53.
- Les charbonnages de Mariemont-Bascoup
(des origines à 1830 environ), par Franz Hayt,
p. 147.
- Notes pour l'armorial des abbayes
de Lobbes et d'Aulne, par Léonce Deltenre, p. 251.
20 euros (code de commande : 02231).
CLOTUCHE
(Raphaël, dir.) — La ville antique de Famars. Valenciennes, Service Archéologique de
Valenciennes, 2013. In-4° (212 x 298 mm.) broché
sous couverture à rabats, 135 p., très nombreuses
illustrations en couleurs, exemplaire en parfait état.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition « Aux origines
de Valenciennes, la ville antique de Famars », organisée
au Musée des Beaux Art de Valenciennes, du 12 avril au
16 septembre 2013.
En quatrième de
couverture :
Depuis
le XVIIe siècle, la ville de Famars est reconnue comme
étant fondée sur les vestiges d'une agglomération
antique, Fanum Martis, dont elle tire son nom. Elle a,
de ce fait, attiré de nombreux « chercheurs »
et collectionneurs « d'antiquailles » dont
les découvertes ont été disséminées
en France ou à l'étranger. Les nombreux travaux
d'aménagement qui transforment la ville depuis la fin du
XXe siècle ont permis aux archéologues qui précèdent
les destructions de comprendre l'organisation de cette ville antique
et déterminer quels types d'activités pouvaient
y être pratiqués. D'une petite agglomération
secondaire bordant un diverticule en dehors des réseaux
principaux, cette bourgade gallo-romaine est devenue une ville
couvrant plus de 150 hectares, au réseau viaire organisé
et bénéficiant de toutes les infrastructures d'une
ville importante. Cette exposition s'attache à montrer
quelle pouvait être la vie quotidienne des habitants de
la fin du Ier siècle apr. J.-C. jusqu'au début du
IVe siècle apr. J.-C. Les objets issus des « fouilles »
anciennes qui ont, en partie, pu être retrouvés sont
présentés, associés à un historique
concernant l'ensemble des recherches menées du XVIIe au
XIXe complété par une description des nouvelles
méthodologies permettant de mieux comprendre le fonctionnement
d'une ville antique. Une part importante est consacrée
aux différentes activités artisanales développées
dans l'agglomération et dont de nombreux indices ont été
découverts au cours des opérations archéologiques
récentes.
Vendu.
COULON (Denis) — Petite histoire des plus légers que l'air. L'aérostation d'Annonay à Saint-Ghislain. Avec la collaboration de Jacques Vandormael. Introduction de A. Vanden Bemden. Saint-Ghislain, Ursidongue, 1994. A4 () collé, 142 p., illustrations en noir.
Table des matières
:
- Préface.
- Introduction. Le rêve d'Icare.
1ère partie. L'aérostation depuis
1783.
Chapitre I. Du papier à
la fumée.
Chapitre I. L'engouement pour
les ballons.
Chapitre III. Le ballon prend
du service.
Chapitre IV. Du ballon au
dirigeable.
Chapitre V. Un mécène,
James Gordon Bennett.
Chapitre VI. Le nouvel engouement.
Chapitre VII. Les femmes aéronautes.
2e partie. Le ballon à gaz de Saint-Ghislain.
- Introduction. En quête
de vérité.
Chapitre I. La première
ascension.
Chapitre II. La kermesse du
mois de mai.
Chapitre III. 1902, la concurrence.
Chapitre IV. La tradition
s'installe.
Chapitre V. Une kermesse communale
à l'Ascension.
Chapitre VI. Comités
et anecdotes.
Chapitre VII. L'après-guerre.
Chapitre VIII. L'après
Scutenaire.
Chapitre IX. De l'hydrogène
à l'hélium.
Chapitre X. Aéronautes
et anecdotes.
Chapitre XI. L'activité
aérostatique dans l'entité.
- Bibliographie.
- Remerciements.
Vendu.
COYOS (Célestin) — Ma captivité en Corée du Nord. Lettre du cardinal Pietro Fumasoni-Biondi. Préface de Paul Mousset. Paris, Bernard Grasset, 1954. In-8° (145 x 193 mm.) broché, 217 p., illustrations hors texte.
En quatrième
de couverture :
Né
le 7 novembre 1908, le Père Coyos a quarante-six ans. Entré
au séminaire de la rue du Bac en 1927, ordonné en
1933, il fit ses premières armes coréennes en 1934.
La Corée !... Parmi les prêtres des Missions
étrangères, ce nom entraîne des résonances
pénibles. Si longtemps fermée aux étrangers
qu'on l'appelait « le Royaume Ermite »,
la Corée persécuta les catholiques jusqu'à
la fin du XIXe siècle et martyrisa de très nombreux
missionnaires de chez nous. Protectorat japonais en 1904, puis
simple colonie en 1910, la péninsule connut jusqu'en 1945
la dure paix nippone. Du moins, en 1934, les Pères qui
se rendaient entre Fusan et le Yalou ne risquaient-ils plus le
martyre...
Hélas ! en dépit de son climat
sec et de son air tonique, la Corée se montra si peu clémente
au jeune missionnaire que sa santé obligea celui-ci, très
gravement atteint, à revenir en France. Il s'y soigna,
s'y guérit. En 1950. le Révérend Père
Coyos était de nouveau en Corée, à Séoul
depuis trois mois quand, le 28 juin, la ville fut occupée
par les Nord-Coréens. La captivité du Révérend
Père devait durer trente-trois mois, vers le Yalou, aux
abords de la frontière mandchoue. Quand il fut rapatrié
– par Moukden, Irkoutsk et Moscou –, il était
le seul survivant des treize prêtres ou missionnaires capturés
en Corée...
Dépouillé, presque sec, sans vaine
recherche littéraire, son récit traite surtout de
ce qu’il a vu, du défi au droit et aux coutumes internationales
qu'ont été l'arrestation, la détention de
civils, en même temps que des brutalités et des meurtres
commis par des gens en uniforme n'appartenant généralement
point à l'armée, mais aux services de sécurité,
autrement dit : à la police. L'objectivité
de son témoignage, où le souci d'impartialité
éclate à chaque ligne, lui confère une force
irréfutable.
« Mais, comme le dit Paul Mousset
dans sa préface, si nul mieux qu'un prêtre ne pouvait
l'écrire, ce volume est aussi l'œuvre d’un homme
dans toute l'acceptation du terme. Il contraindra beaucoup de
ceux qui le liront à un examen de conscience. Il les amènera
à s'interroger sur l'attitude qui, en des circonstances
semblables, aurait été la leur...
« La grandeur de ce livre, je l'affirme,
réside en ceci : autant qu'un exposé sans passion
de faits épouvantables, il constitue, pour quiconque connaît
la fragilité humaine, une inoubliable leçon. »
Ajoutons que le Révérend Père
Coyos, qui a pardonné à ses bourreaux, est à
la veille d’une troisième expédition en Corée...
10 euros (code de commande : 02227).
[CRETEN
(Johan)]. Johan Creten. Sculptures. Manufacture nationale de
Sèvres. [Paris], Éditions
Courtes et Longues, 2008. In-4° (225 x 278 mm.) sous
cartonnage d'éditeur, 144 p., très nombreuses illustrations
en couleurs, édition bilingue (français-anglais),
exemplaire en bon état.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris,
en 2008.
En quatrième de
couverture :
Durant
sa résidence à la Manufacture nationale de Sèvres,
de 2004 à 2007, Johan Creten a créé des œuvres
singulières où s'exprime sa personnalité
complexe. Charnelles, parfois inquiétantes, ses grandes
sculptures en grès ou en porcelaine émaillée
questionnent la sexualité, la religion, la mort ou encore
le politique. Des échanges passionnants se sont instaurés
au cours de ce dialogue ininterrompu de trois années entre
l'artiste et les ateliers de la Manufacture.
Il était nécessaire de conserver
une trace de cette résidence au travers d'un ouvrage et
une exposition. C'est ainsi que la Manufacture a proposé
au Musée de la Chasse et de la Nature de convier Johan
Creten à investir ses salles, de juin à décembre
2008.
La tradition liée à la chasse
et à la nature ne pouvait que séduire ce sculpteur
et ses pieuvres aux tentacules infinies, personnages étranges,
coquillages accrochés au mur, vulves de roses, couples
hermaphrodites... dans lesquels Chantal Pontbriand voit des « bribes
de figuration émergeant d'un magma de terre (...), on peut
dire que la forme se joint intimement à l'informe, que
l'existence de ce qui est visible tient intrinsèquement
de ce qui demeure invisible, larvaire, et en gestation. »
Nathalie Viot évoque, quant à elle, les visions
de l'artiste « dans cette matière indomptable
à l'épreuve de ses désirs. Il l'aime, elle
s'abîme, se casse, coupe, tranche... résiste aussi.
C'est une belle amante. Les marques sont cruciales, ce seront
des médailles portées au regard de ceux qui, attentifs,
verront en elles leur beauté. »
12 euros (code de commande : 02230).
DEJOLLIER
(René) — Une
pensée de Namur. Namur, Wesmael-Charlier, 1980.
In-4° (204 x 269 mm.) broché, 166 p., très
nombreuses illustrations.
Il s'agit d'un
recueil de reproductions de cartes postales du début du
XXe siècle, accompagnées d'un court commentaire
historique.
Préface :
Moyen de communication par excellence et presque
exclusif, au début de ce siècle, la carte postale
illustrée d'hier est devenue, de nos jours, authentique
document.
Il suffit, pour s'en convaincre, de flâner
le dimanche matin, un peu partout en Wallonie comme ailleurs,
sur les marchés dits « aux puces ».
Outre l'acheteur qui, feignant l'indifférence,
cache bien son intérêt pour la « chose »
parfois insolite qu'il a découverte, l'on y rencontre aussi
le fouineur nostalgique de la poésie un peu désuète
qui s'exhale d'objets dont la vraie valeur est le souvenir qu'ils
évoquent.
Parmi toutes ces « vieilleries »
et ces bouquins aux senteurs de poussière, la carte postale
ancienne occupe une place de choix : elle attire, en effet,
nombre de collectionneurs dont la passion va croissant avec la
rareté des pièces qu'ils veulent acquérir,
souvent à des prix élevés.
René Dejollier est de ceux-là.
Sa collection est vaste.
Un seul thème, pourtant, l'anime :
Namur.
C'est dire l'attachement qu'il porte à
sa ville, à ses coins charmants où nos grands-parents
ont pris le temps de vivre.
Si le poète chante Namur, si l'historien
raconte son passé et l'archéologue restaure son
patrimoine, René Dejollier, lui, fait joliment parler ses
cartes postales.
Trente ans d'histoire locale, de 1890 à
1920, au travers d'une multitude de détails surprenants,
amusants, pittoresques, relevés sur chacune des 284 pièces
qui composent son ouvrage !
Que d'enseignements pour tous ceux qui aiment
notre ville et veulent la découvrir tous les jours davantage !
Que d'aspects insoupçonnés dans
la vie de notre récent passé !
Namur est une ville si attachante, par sa Meuse
majestueuse, son fier Champeau, ses toits gris et ses rues tortueuses ;
Namur est si délicieuse par ses gens et sa douceur de vivre
qu'elle méritait bien une pensée !
Remercions René Dejollier de l'avoir,
pour nous, bellement exprimée.
10 euros (code de commande : 02202).
DE WAHA (Michel) — Du carolingien à la base aérienne, heurs et malheurs de Chièvres. Namur, Institut du Patrimoine Wallon, 2010. In-8° (160 x 240 mm.) agrafé, 63 p., illustrations en couleurs, (collection « Les Carnets du Patrimoine », n° 70), exemplaire à l'état de neuf.
En quatrième
de couverture :
Petite
ville dont le centre ancien ne couvre pas plus de 10 ha, base
aérienne de réserve dont la piste rappelle qu'au
cours de la Seconde Guerre mondiale un aérodrome militaire
y fut actif, Chièvres mérite-t-elle de se voir consacrer
un Carnet du Patrimoine ?
Chièvres apparaît dans l'histoire
à la période carolingienne au plus tard, devient
probablement le siège d'un comté au Xe siècle.
Au XIe siècle, elle est le siège d'une des seigneuries
les plus puissantes du Hainaut, connaît un remarquable développement
économique au XIIe siècle où elle est protégée
non seulement par le château seigneurial, mais aussi par
une enceinte qui entoure l'agglomération. Autour d'elle
se construisent des monuments remarquables, la chapelle des Hospitaliers,
la maladrerie. À la fin du XIIe siècle, la charte
qui enregistre droits et libertés du seigneur et des habitants
est une des premières rédigées, non plus
en latin mais en langue française. Chièvres offre
un grand intérêt historique et archéologique,
et sa modestie actuelle en fait un véritable laboratoire
potentiel de l'archéologie wallonne. Chièvres vaut
plus que le détour.
Vendu.
DUHAMEL (Georges) — Querelles de Famille. Paris, Mercure de France, 1932. In-8° (205 x 190 mm.) broché, 247 p.
Exemplaire du Service de Presse avec un envoi de l'auteur à Jean Botrot.
Jean
Botrot (1904-1977) était un journaliste français
qui se lia à la Belgique par l'intermédiaire de
sa femme Françoise, fille du critique et journaliste Louis
Dumont-Wilden. Outre ses articles pour La Nouvelle République
du Centre-Ouest, il tint la rubrique « Soirs de Paris »
dans l'hebdomadaire belge Pourquoi pas et fut lauréat
du Prix Albert-Londres en 1936.
Georges Duhamel ne revint pas indemne de son
voyage aux États-Unis d'Amérique qui lui inspira
Scènes de la vie future, publié en 1930 dans
lequel il ne se privait pas d'émettre de vives réserves
quant à l'organisation de la société de consommation.
Dans Querelles de Famille, dédié à
Roger Martin du Gard, il poursuit sa réflexion et sa critique
du piège du progrès technologique. Le phonographe
et la T.S.F. sont notamment ses cibles privilégiées,
de même que la publicité qu'il envisage de réglementer
et de contrôler afin de vérifier les assertions des
marques quant à la fiabilité de leurs produits...
Vendu.
DUPONT (Marcel) — Napoléon et la trahison des maréchaux 1814. Paris, Librairie Hachette, 1951. In-8° (135 x 203 mm.) broché, 253 p.
Introduction :
De
1804 à 1814, Napoléon créa vingt-cinq maréchaux
d'Empire. Voici leurs noms, dans l'ordre où ils furent
nommés et accompagnés des titres que leur conféra
l'Empereur :
Berthier, prince de Neuchâtel, duc de
Valengin, prince de Wagram.
Murat, grand-duc de Berg et de Clèves,
devenu roi de Naples.
Moncey, duc de Conegliano.
Jourdan.
Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling.
Augereau, duc de Castiglione.
Bernadotte, prince de Ponte-Corvo, devenu prince
royal de Suède.
Soult, duc de Dalmatie.
Brune.
Lannes, duc de Montebello.
Mortier, duc de Trévise.
Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskowa.
Davout, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl.
Bessières, duc d'Istrie.
Kellermann, duc de Valmy.
Lefebvre, duc de Dantzig.
Pérignon.
Sérurier.
Victor, duc de Bellune.
Macdonald, duc de Tarente.
Oudinot, duc de Reggio.
Marmont, duc de Raguse.
Suchet, duc d'Albuféra.
Gouvion-Saint-Cyr.
Poniatowski.
Sur ce nombre, trois sont tombés glorieusement
sur le champ de bataille : Lannes, Bessières et Poniatowski.
Le but de ce livre est de rechercher quelle
fut, vis-à-vis de Napoléon, la conduite des vingt-deux
autres lors de l'écroulement de l'Empire.
Avant de commencer cette étude, il nous
paraît utile d'indiquer quelle était la situation
de ces différents personnages au jour où le récit
débute, le 27 mars 1814.
Bernadotte et Murat, traîtres avérés,
portaient déjà les armes contre la France, l'un
en Belgique, l'autre dans la plaine du Pô.
Jourdan, Masséna, Brune, Kellermann,
Pérignon, Sérurier étaient soit en disgrâce,
soit chargés de missions militaires obscures à l'intérieur
du pays.
Victor, grièvement blessé à Craonne, se soignait
à Paris.
Moncey commandait la garde nationale parisienne.
Gouvion-Saint-Cyr était prisonnier.
Davout, bloqué dans Hambourg, y résistait
avec acharnement.
Augereau commandait l'armée dite de Lyon.
Soult, commandant l'armée de Portugal,
et Suchet, commandant l'armée de Catalogne, avaient dû
reculer devant les forces anglaises, espagnoles et portugaises,
et luttaient dans le Midi de la France.
Enfin, à la Grande Armée même,
donc sous les ordres directs de l'Empereur, se trouvaient Berthier,
Ney, Lefebvre, Macdonald, Oudinot, Mortier et Marmont.
Tous étaient de grands soldats. Étroitement
unis pour la plupart à l'histoire de Napoléon au
cours des glorieuses campagnes précédentes, ils
étaient mêlés ou assistaient aux luttes héroïques
qui se déroulaient sur le sol même de la Patrie.
Nous allons les suivre à ces heures douloureuses ;
nous allons voir comment chacun d'eux comprit son devoir vis-à-vis
du souverain qui les avait comblés d'argent, de titres,
d'honneurs.
9 euros (code de commande : 02213).
FRESÁN (Rodrigo) — La Vitesse des choses. Traduit de l'espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon. Préface d'Enrique Vila-Matas. Albi, Passage du Nord-Ouest, 2008. In-8° (139 x 190 mm.) collé, 636 p., exemplaire en parfait état.
En quatrième
de couverture :
« [...]
Balthazar Mantra a lancé la mode de faire couler le sang
des vivants dans les veines des morts afin de préserver
leurs souvenirs et leurs histoires. De leur côté,
les Moines Mantra s'obstinent à croire que Balthazar Mantra
n'a jamais été une personne, mais une chose :
ce vent secret qui souffle sur les humains chaque fois qu'ils
prennent conscience de la mort ou – c'est du pareil
au même – chaque fois que la mort prend conscience
d'eux. Ce vent qui souffle à présent sur moi...
Je suis arrivé là en poursuivant
la légende de Balthazar Mantra, auteur aussi mythique que
radical de La Vitesse des choses. La vitesse des choses
est la vitesse de la mémoire. La mémoire est tout.
L'œuvre est la mémoire. [...] Le son de la vitesse
des choses est celui que Dieu produit quand il respire si loin
de nous. On le retrouve un peu dans la seconde où les marées
changent ou dans le craquement du premier flocon de neige se détachant
des cieux.
Voici l'histoire de ma deuxième mort...
Je suis le disciple obligé d'un maître, le traqueur
d'ossements historiques, l'amateur de bibliothèques décédées,
le salaud poursuivi par le fantôme de sa petite sœur
dépourvue de bras et, à nouveau, l'écrivain
argentin qui a survécu à tous les cataclysmes. »
Pour des raisons évidentes, les précisions
que nous aimerions apporter sur cet écrivain de livres
mutants nous échappent, d'autant plus que pour cette édition
française, d'autres récits sont venus s'ajouter
à l'ouvrage. [...] Chaque fois que j'écris sur La
Vitesse des choses, je suis obligé de lire les nouveaux
récits que Fresán a adjoints à son livre
infini, qui est devenu finalement celui que j'ai le plus lu de
ma vie.
Enrique
Vila-Matas.
12 euros (code de commande : 02206).
[GADAMER (Hans-Georg)]. MICHON (Pascal) — Poétique d'une anti-anthropologie. L'Herméneutique de Gadamer. Paris, Vrin, 2000. In-8° (137 x 218 mm.) broché, 254 p., (collection « Problèmes & Controverses »), petit coup à la coiffe.
En quatrième
de couverture :
L'herméneutique universelle, exposée
dans Vérité et Méthode, se présente
comme une philosophie de la Sprache. Selon Gadamer, seule
en effet une méditation de la Sprachlichkeit du
Dasein permet de rendre compte de son historicité
essentielle. Mais que veulent dire Sprache et Sprachlichkeit ?
Doit-on traduire ces termes par langue ou par langage, condition
linguistique ou condition langagière ? Ce livre commence
ainsi par un exercice de retraduction dont l'enjeu est bien plus
qu'une rigueur philologique. Au cœur de cette réflexion
se loge la question, de bien plus grande portée, du rapport
conflictuel entre la philosophie et la théorie du langage,
au cours des XIXe et XXe siècles. Cette question posée
aujourd'hui par la poétique, la philosophie doit l'affronter
au lieu de l'esquiver ou même de la nier comme elle le fait
le plus souvent. Il lui faut comprendre ce que lui ont coûté
les « victoires » successives de Hegel sur
Humboldt, de Peirce sur Saussure, et plus près de nous,
d'Austin sur Benveniste. C'est à cette condition qu'elle
pourra se mettre en mesure de repenser les questions du langage
comme activité, de l'historicité radicale et du
sujet, c'est-à-dire en fin de compte de l'anthropologie.
Vendu.
GAGE
(Thomas) — Nouvelle relation contenant les Voyages de
Thomas Gage dans la Nouvelle Espagne. 1676. Tomes I et II (complet). Présentation
de Paul Vernière. Paris - Genève, Slatkine
Reprints, 1979. Quatre parties en deux volumes in-8° (130
x 210 mm.) collés, t. I : [10], [26], 246,
[12], 240 p., t. II : [14], 297, [13], 153, [5] p.,
(collection « Ressources »), exemplaire
en très bon état.
Réimpression
de l'édition de Gervais Clouzier, à Paris, en 1676.
Présentation :
Nous
sommes en mai 1625 à Xérès, Andalousie. Un
jeune dominicain d'origine anglaise, Thomas Gage, plus ou moins
oublié de sa famille, se laisse engager pour une mission
aux Philippines ; il n'a pas trente ans, mais depuis douze
ans il étudie en Espagne : l'aventure spirituelle,
car sa foi est évidente, mais aussi l'aventure tout court
le tente. Le 2 juillet 1625, avec vingt-sept confrères,
il fait voile sur le Saint-Antoine de Cadix à la
Guadeloupe alors peuplée de sauvages Caraïbes. Après
une courte escale à la Havane, le navire atteint la Vera
Cruz le 12 septembre. De couvent en couvent, toujours étonné
par l'extraordinaire liberté des mœurs monastiques,
il suit la route de Mexico : le 3 octobre 1625 on l'accueille
magnifiquement au couvent de Saint-Hyacinthe qui appartenait aux
Jacobins de Manille. Pendant trois mois Thomas Gage étudie
l'état présent du Mexique : les relations de
la conquête de Fernand Cortez, mais aussi la chronique quotidienne
de la capitale en proie à deux désordres. D’un
côté le clergé créole, vivement hostile
aux religieux venus d'Espagne, marque les débuts d’une
indépendance spirituelle et socio-culturelle qui précède,
comme l'a bien vu M. Lafaye dans son très beau Quezatcoatl,
l'indépendance politique. De l'autre l'opposition non moins
vive, qui vient de bouleverser la ville en 1624, entre le vice-roi,
le Comte de Gelves, et l'archevêque Don Alonso de Zerna.
Mais le spectacle quotidien de Mexico étonne et scandalise
notre dominicain : un luxe prodigieux, impensable en Europe,
s'affiche dans la rue : bijoux, vêtements de soie et
d'or, équipages, prostituées de toutes couleurs.
Les couvents eux-mêmes avec leurs viviers, leurs volières,
leurs jardins de fruits, sont des lieux de délices, pendant
que les églises ruissellent de richesses inouïes :
statues, lustres et chandeliers d'argent que trois hommes n'arrivent
pas à soulever. Notre moine, à la fois émerveillé
et scandalisé, perd quelque peu sa foi missionnaire.
Ainsi lorsque vient l'heure de rejoindre Acapulco,
sur la côte pacifique, pour embarquer sur les galions des
Philippines, Thomas Gage, vers la mi-février 1626, s'enfuit
vers le sud, malgré ses supérieurs. Son but est
le Guatemala qu’il atteint sans trop de peine, accueilli
de couvent en couvent, disant pour quelques écus la messe
au passage. Tout au long, de précieuses descriptions nous
donnent l’état des routes et des villes, des rapports
sur les Indiens, la découverte des langues, l'emprise plus
ou moins grande sur le pays des colons espagnols, les premiers
effets de la main-d'œuvre africaine. Accueilli à merveille
dans la ville de Guatemala par ses confrères jacobins,
Thomas Gage devient professeur de théologie à l'université
à la suite d’une thèse où il soutient,
sur la naissance de la Vierge, la doctrine thomiste contre les
nouveautés de Suarez. Dès lors, pendant trois ans,
c’est un notable local que le Père provincial et l'évêque
protègent et favorisent. Son témoignage sur l’état
présent de l'Amérique centrale, d’une remarquable
précision géographique, s'augmente d’une relation
missionnaire vers le Honduras où les Indiens sont encore
libres et non convertis.
Trois ans passent et la nostalgie de l'Europe
l'atteint. Ayant écrit à Rome et reçu l'autorisation
de revenir, il se heurte aux désirs des autorités
locales qui veulent utiliser ses talents. Le seul moyen de revoir
son pays est de s'enrichir dans une cure de campagne ; il
apprend la langue locale, le « poconchi ».
Il demeure cinq ans à Mexico, un an à Amatitlan
puis à Petapa, confronté aux vrais problèmes
indiens. La persécution latente des Espagnols, la survivance
des cultes idolâtres, la sorcellerie, le métissage :
extraordinaire expérience que Thomas Gage rapporte naïvement.
C’est en janvier 1637, douze ans après
son arrivée au Nouveau Monde, qu’il décide
de fuir. Ses économies, huit mille pièces de huit,
sont converties en pierres et en perles. Mais ses épreuves
commencent : au Nicaragua, un corsaire hollandais le dépouille ;
il atteint péniblement Panama, puis Porto Bello sur le
Golfe du Mexique ; chapelain sur un vaisseau de la grande
flotte, il rallie Carthagène, La Havane, et le 28 novembre
1637 atteint l'Espagne à San Lucar de Barrameda. C’est
l'heure du choix : Thomas Gage, pris par le mal du pays,
décide de retrouver sa famille anglaise. Il quitte le froc,
monte sur un vaisseau anglais, débarque à Douvres
à la fin de décembre. À Londres, toute sa
famille l'a oublié après vingt-quatre ans d'exil ;
il ne sait plus parler anglais.
En 1638, est-ce la fin de l'aventure ?
C’est alors qu'une carrière politique commence. Devenu
anglican, on le considère comme le spécialiste de
l'Amérique espagnole et son voyage est un précieux
document sur un continent interdit aux concurrents de l'Espagne.
Il en connaît les points faibles : la côte pacifique
non fortifiée, l'immensité des rivages, la multiplicité
des fidèle moins à sa vocation missionnaire qu'au
mirage américain de ses jeunes années.
En 1676, Colbert, dont les visées coloniales
aux dépens de l'Espagne s'affirmaient, faisait traduire
les Voyages de Thomas Gage par l'irlandais O’Neil.
Les deux volumes : 25 euros (code de commande : 02219).
[GENT - GAND]. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks - Deel XXIV. 1970. Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1970. In-8° (161 x 245 mm.) broché, 152 p., illustrations, exemplaireen très bon état.
Table des matières
:
- Jerusalem in Sint-Baafs te Gent. Een
bijdrage over het godsdienstig leven van Gent en het leven in
de Sint-Baafsabdij, par J. Winnepenninckx, p. 3.
- The population of fourteenth-century
Ghent, par David M. Nicholas, p. 97.
- De datering van de Duinkerke III-B
transgressie en het dijksysteem ten noorden van Brugge, par
Nicole Pannier, p. 113.
- De oprichting van het koninkrijk België
weerspiegel in « Den Vaderlander », par
A. Braekman-Devolder, p. 129.
8 euros (code de commande : 02236).
[HAINAUT
OCCIDENTAL - LE COURRIER DE L'ESCAUT]. La vie d'une
région. Le Hainaut occidental dans le miroir d'un journal
régional (1829-1979). Tournai,
Courrier de l'Escaut, 1979. In-8° (165 x 221 mm.) sous
reliure et jaquette (défraîchie, déchirures)
d'éditeur, XIII, 251, [52 (illustrations)] p.
Ouvrage publié
à l'occasion du 150e anniversaire du journal Le Courrier
de l'Escaut.
Table des matières
:
- La
révolution belge à Tournai et les débuts
turbulents d'un journal, par J. Nazet.
- La ville d'Ath dans la Révolution
de 1830, par R. Sansen.
- Familles royales et Hainaut occidental,
par A. Servais.
- L'évolution industrielle du
Hainaut occidental au XIXe siècle, illustrée par
le « Courrier de l'Escaut », par R.
Sevrin, avec la collaboration de J. Nazet.
- Le renforcement du nœud de communications
de Tournai au XIXe siècle, d'après le « Courrier
de l'Escaut », par R. Sevrin.
- Les liaisons Borinage-Flandre
par le Hainaut occidental au XIXe siècle, d'après
le « Courrier de l'Escaut », par R.
Sevrin.
- 150 ans de vie militaire à
Tournai, par A. Pirmez.
- Vie religieuse à Tournai,
par J. Dumoulin et J. Pycke.
- Les « Enfants trouvés »
à Tournai dans la première moitié du XIXe
siècle, par A. Milet.
- Le démantèlement des
fortifications de Tournai, d'après le « Courrier
de l'Escaut », et ses conséquences géographiques,
par R. Sevrin.
- Le monde rural tournaisien et « Le
Courrier de l'Escaut », par P. Mory.
- Les relations Tournai-France et Tournai-Flandres
depuis 1829, par J.-P. Delhaye.
- Le « Courrier de l'Escaut »
et 150 années de vie culturelle à Tournai, par
S. Le Bailly de Tilleghem.
- Le folklore, par E. Vormezeele-Wuillaum.
- « Le Courrier de l'Escaut ».
Cent cinquante ans d'histoire à Tournai et dans le pays,
par Th. Dubois.
- Documents et objets exposés :
- La révolution
belge de 1830 à Tournai.
- La révolution
belge de 1830 à Ath.
- Familles royales.
- Machinisme et progrès
(L'évolution industrielle - Les transports et les communications).
- La vie militaire.
- Population et aménagement
de la ville (Les enfants trouvés - Le démantèlement
des remparts).
- 150 ans de vie commune.
- La vie rurale.
- Les relations Tournai-Flandres
et Tournai-France.
- La vie culturelle.
- Le folklore.
- Le Courrier de l'Escaut.
15 euros (code de commande : 02208).
HOST (Michel) — Septante-cinq ans d'épopée culturelle en Hainaut. Avant-propos par Pierre Dupont. Charleroi, Imprimerie Provinciale, 2002. In-8° (135 x 221 mm.) broché sous couverture à rabats, 160 p., illustrations.
Avant-propos :
La
culture trouve assurément sa place parmi les secteurs dans
lesquels les provinces, et tout particulièrement le Hainaut,
ont prouvé de longue date la qualité et l'opportunité
de leur action.
En 1994, à l'occasion du 75eme anniversaire
de la création de la « Commission provinciale
des Loisirs de l'Ouvrier », Michel Host avait réalisé
une exposition retraçant l'histoire de l'institution.
Il a poursuivi sa recherche, pour nous aider
à garder traces et perspectives de cette évolution.
Son ouvrage montre, par nombre d'éléments,
combien les préoccupations provinciales ont été
et sont en prise directe avec la société hainuyère.
Cette sortie de presse s'insère dans
un triptyque, coïncidant avec la parution des actes d'une
journée de réflexion récente (« Acte(s)
culturel(s) et citoyenneté : enjeux dans l'éducation
permanente ») et l'inauguration par le Conseil provincial
de la Fabrique de théâtre établie à
La Bouverie, ce 10 février 1998.
Non sans lyrisme, Michel Host inscrit l'histoire
de ces septante-cinq ans de culture en Hainaut dans l'objectif
qui sous-tend notre action : « conserver la mémoire
et renouveler le patrimoine » – pour « voir
autrement ».
12 euros (code de commande : 02234).
[LAURENT (René)]. DE MOREAU DE GERBEHAYE (Claude) et VANRIE (André) — Marques d'authenticité et sigillographie. Recueil d'articles publiés en hommage à René Laurent. Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, 2006. In-8° (173 x 243 mm.) collé, 408 p., illustrations en noir et en couleurs, (collection « Archives et Bibliothèques de Belgique - Archief- en Bibliotheekwezen in België », Numéro spécial 79).
Extrait de l'avant-propos
:
Ce n'est pas seulement au savant sigillographe
que nous souhaitons rendre hommage mais aussi à l'humaniste
au caractère heureux, à l'archiviste dont les connaissances
bénéficiaient à tous, au collègue
informé et bienveillant. Notre association a donc décidé
d'élaborer en son honneur un volume d’articles auquel
participeraient ses pairs, ses collègues et ses amis. Le
volume se focalise sur la sigillographie et sur les thèmes
de l'authenticité (et du faux) lato sensu, de ses
signes, de sa valeur, de sa préservation et de ses représentations.
Table des matières :
- Avant-propos des éditeurs.
- Notes biographiques. Répères
chronologiques. Bibliographie, par A. Vanrie.
- Il degrado dei sigilli di cera :
approcci metodologici ed etica di restauro, par L. Becchetti.
- Controleren en waarmerken van maten
en gewichten, par J. Mertens.
- Les remplois de sceaux princiers en
Lotharingie au XIIe siècle : pragmatisme ou propagande
dynastique, par J.-F. Nieus.
- Chirographes, sceaux et notaires.
Remarques sur l'usage des formes mixtes dans les actes des XIIe
et XIIIe siècles, par J.-L. Chassel.
- Quo in testimorno imago meam apposui.
Notes sur le goût de l'Antique et le Style 1200 dans
les sceaux du Nord de la France, par M. Gil.
- Le sceau de l'abbaye de Saint-Thierry
(XIIe-XIVe siècles), ultime souvenir d'un reliquaire disparu,
par J.-L. Liez.
- Usages et tarification du sceau des
foires de Champagne (XIIIe-XIVe siècles), par J.-M.
Yante.
- La Cour des chênes à
Hornu : historiographie et réalité historique,
par D. Van Overstraeten.
- Identification de jetons médiévaux
des échevins et receveurs de Bruxelles, par C. Roelandt.
- Note sur l'utilisation du chirographe
à Bruxelles aux XIVe et XVe siècles, par C.
Dickstein-Bernard.
- Fausses lettres et faux sceaux des
ducs de Bourgogne, comtes de Flandre (1384-1477), par P.
Cockshaw.
- De zegelrechten van de Brabantse kanselarij
onder Filips de Goede (1430-1467), par E. Aerts.
- L'abbaye de Saint-Ghislain et le seigneur
de Ligne : trois sceaux typiques à propos d'Aubechies en
Hainaut (1431), par A. Scufflaire.
- Tableau des 32 quartiers de Josse
de Lalaing, chevalier de la Toison d'Or, seigneur de « Brosende »
(† 5 août 1483), par Chr. Van den Bergen-Pantens.
- Grand Chancelier vs Archichancelier,
1520-1521. Trois actes originaux de Charles Quint relatifs aux
chancelleries et à l'usage des sceaux (AG.R., Archives
de l'Audience), par M. Soenen.
- Spéciale penningen van Financiën
geslagen in de muntateliers te Antwerpen en te Brugge in de 16de
eeuw, par E. Roobaert.
- Une chancellerie princière
au début du XVIIe siècle : le Conseil et la
Chambre des comptes de Charles de Croÿ, duc d'Arschot et
prince de Chimay, par J.-M. Duvosquel.
- Maximilien-Emmanuel, souverain méconnu
des Pays-Bas, et son sceau princier (1711-1714), par C.
De Moreau de Gerbehaye.
- Abolition et résurgence de
la noblesse et des emblèmes nobiliaires dans nos régions
1795-1830, par C. Douxchamps-Lefèvre.
- Limburgse gemeentewapens onder Willem
I. Van regelgeving tôt praktijk, par L. Viaene-Awouters.
- Laurentius op de rooster gelegd. Kanttekeningen
bij het heraldisch gebruik van heiligen en hun attributen,
par L. Duerloo.
- Het gebruik van een uithangend zegel
aan adelbrieven verleend door de Belgische vorsten, par P.
De Win.
18 euros (code de commande : 02211).
LE GLAY (André) — Glossaire topographique
de l'ancien Cambrésis,
suivi d'un recueil de chartes et diplômes pour servir à
la topographie et à l'histoire de cette province, avec
annotations et remarques. Cambrai,
Deligne et Lesne, 1849. In-8° (143 x 218 mm.) demi-simili
brun, XXII, LXIV (la dernière page est erronément
numérotée LXIX), 211, [1 bl.], [1 (table)], [1 bl.]
p., deux cartes à déplier hors texte.
Ce très
rare volume constitue le tome XIX - 2e partie des Mémoires
de la Société d'Émulation de Cambrai.
Extrait de l'introduction
:
Le
Glossaire qui va suivre est le résultat de recherches longues
et patientes. Toutefois je n'ai garde de le croire complet, ni
même exempt d'inexactitudes. Dans ces sortes de matières,
peu explorées encore, il est facile de se tromper. Je serai
assez payé de mon labeur, si celte initiative fournit à
d'autres le moyen de faire mieux !
J'ai tâché de donner à chaque
article du Glossaire une concision tout-à-fait technique.
La présente introduction et les notes suppléeront
à ce laconisme et fourniront au lecteur les explications
indispensables.
Le but de l'auteur n'a pas été
de faire connaître les divisions territoriales nouvelles :
cependant, pour mieux fixer le lecteur, il a cru devoir désigner
chaque commune d'après sa situation administrative actuelle ;
et même j'ai fait entrer dans la nomenclature les communes
qui, sans avoir jamais appartenu au Cambrésis, forment
aujourd'hui partie intégrante de l'arrondissement de Cambrai,
en ayant toujours soin d'indiquer l'ancienne province dont elles
dépendaient.
On remarquera que je ne me suis pas attaché
à scruter l'étymologie des noms de lieux. Les origines
latines et tudesques s'expliquent d'elles-mêmes. Quant aux
dérivations réputées celtiques, il faut laisser
à de plus habiles le mérite de sonder et de dévoiler
les mystères d'une langue qui ne se laisse pas aborder
par tout le monde.
Le Codex diplomatique inséré à
la suite du Glossaire se compose d'une quantité d'actes
presque tous inédits et antérieurs à la publication
de la loi Godefroi. Le lecteur voudra bien les considérer
non seulement comme les pièces justificatives du Glossaire,
mais encore comme d'utiles documents pour l'histoire communale
du pays. Et afin qu'il ait en même temps sous les yeux un
tableau des principaux titres publiés avant nous sur ces
matières, je donne la table des principaux diplômes
cambrésiens depuis l'an 640 à 1926, imprimés
déjà dans divers recueils.
Le volume se termine par des annotations assez
étendues sur les litres insérés ou mentionnés.
50 euros (code de commande : 02235).
L'HOIST (André) — La guerre. 1940 (10 mai 25 juin) et le rôle de l'armée belge. XIIe édition. Bruxelles, Ignis, 1940. In-8° (117 x 185 mm.) broché, 248 p., cartes dans le texte et cartes et tableau hors texte à déplier, ex-libris manuscrit à la page de titre, exemplaire en bon état.
Introduction :
Quand,
le 16 janvier 1939 exactement, l'auteur de ces lignes achevait
d'écrire son étude sur la campagne de 1914, pour
défendre l'honneur militaire belge que prétendait
souiller M. A. Tardieu, il se doutait peu qu'en 1940 il devrait
reprendre la plume pour exposer objectivement les preuves de l'inexactitude
consciente et de l'évidente mauvaise foi de ceux qui, l'année
suivante, essayent d'excuser les échecs de leurs armes
en salissant une armée qui fit mieux que sauver l'honneur.
Choisissant parmi ces détracteurs, il
en est un auquel ses qualifications dictaient une intelligente
réserve, et qui appuya de ses titres à la confiance
du public des accusations inqualifiables. Le présent travail
eût pu être intitulé, par analogie avec le
précédent : « 1940. La Vérité
contre Maurin ».
Nous ne pouvons faire mieux, pour justifier
notre occasionnelle sévérité d'appréciation,
que transcrire l'article paru dans l'hebdomadaire français
Match, du 6 juin 1940, en page 2. Nous n'y changerons pas
un iota, quelqu'envie que nous en puissions éprouver, afin
que le lecteur puisse apprécier jusqu'où ont été
les calomnies répandues sur la Belgique et son Roi, solidaires
devant le feu, mais aussi, on le voit, devant poison.
L'erreur et la faute.
Il faut vraiment que la France soit au bord
de l'abîme pour qu'elle se ressaisisse et prenne conscience
de sa force et arrive à triompher d'ennemis qui la croyaient
vaincue parce qu'imprévoyante et surprise.
L'aide à la Belgique aura constitué
une généreuse mais bien dangereuse impulsion. Le
roi Léopold III avait brisé de ses mains l'alliance
qui l'unissait aux Alliés de son Père. Il avait
un jour proclamé : « Nous devons penser
belge. » Mais c'était l'époque où
l'Angleterre pensait « insulaire » et la
France « international ». Mais, depuis lors,
nous pouvions nous demander si sa pensée était vraiment
restée belge ; en tout cas, notre erreur a été
de venir spontanément au secours de qui ne tenait même
pas la balance égale entre nous et nos pires ennemis.
Depuis de longs mois, toute conversation d'état-major
était interrompue entre nos deux pays. Aveuglément,
nous nous sommes lancés dans une offensive presque irréfléchie,
pour payer notre dette vis-à-vis du roi Albert.
Avides de trouver enfin l'occasion de rencontrer
un front mouvant, nous n'avons pas essayé de connaître
l'état exact des fortifications auxquelles les armées
alliées devaient s'appuyer. Erreur renouvelée de
1914, mais devant un ennemi qui avait préparé son
champ d'action à la fois sur le terrain et dans le peuple.
À la vérité, nous aurions
dû avoir les yeux dessillés quand les Allemands ont
traversé les Ardennes, touristes en uniforme, sans la moindre
résistance, alors qu'on considérait la forêt
comme semée d'embûches. Ce fut la première
trahison.
Il y en eut bien d'autres que commencent à
dévoiler ceux qui reviennent : coups de feu émanant
de civils, actions criminelles sur les arrières, absence
de fortifications de campagne, cependant indiqués sur la
carte, etc., jusqu'au jour de la honteuse capitulation.
En déposant les armes sans prévenir
les généraux français et anglais, le roi
Léopold a cru peut-être penser « belge » ;
mais ce n'était pas cette langue que parlait son père.
En ce qui concerne nos troupes, elles ont durement
subi le baptême du feu ; soyez sûr que l'ennemi
en porte, lui aussi, des blessures cruelles. Si vous voulez vous
rendre compte de la façon dont notre infanterie s'est ressaisie,
songez qu'à l'heure actuelle elle abat des avions avec
ses fusils-mitrailleurs. C'est un véritable relèvement
dans toute l'acception du terme.
Louis Maurin (Général
du cadre de réserve, ancien Ministre de la Guerre.)
Pour étudier 1914, les documents
abondent ; le dossier est complet. Le recul de l'histoire
manque pour l'examen de la campagne de 1940 ; il est néanmoins
possible déjà d'établir sur pièces
et témoignages sérieux, « recoupés »,
un aperçu d'ensemble des opérations, de se former
une vision claire de la marche des événements généraux,
si même certaines précisions de détail font
encore défaut. Sans pouvoir donner des faits un tableau
fini, l'on peut toutefois en brosser une esquisse poussée,
que l'avenir seul permettra de retoucher localement.
12 euros (code de commande : 02221).
MANCINI (Hortense et Marie) — Mémoires d'Hortense et de Marie Mancini. Édition présentée et annotée par Gérard Doscot. Paris, Mercure de France, 1965. In-8° (141 x 205 mm.) broché sous couverture à rabats, 226 p., un tableau à déplier, (collection « Le Temps Retrouvé » n° 5), exemplaire du Service de Presse, en très bon état.
En quatrième
de couverture :
On ne peut rêver existences plus romanesques. Nièces
de Mazarin ; grands personnages de la Cour ; courtisées
par des rois, Louis XIV pour Marie, Charles II pour
Hortense ; mêlées aux affaires politiques, aux
grands complots et aux petits potins ; voyageuses infatigables ;
amoureuses proverbiales : Hortense et Marie Mancini, c’est
encore l’intrigue de la Fronde, c’est déjà
la passion du grand siècle – toute une époque
devenue femme. Mais elles ne se bornent pas à vivre :
elles disent ce qu’elles ont vécu, elles se défendent,
elles attaquent parfois, mais toujours dessinent, analysent, font
parler et font vivre, en un temps où l’élégance
du langage est aussi infaillible que l’orthographe est incertaine.
On saura gré à Gérard Doscot
de nous avoir rendu, par cette édition, des personnages
et des mémoires qui sont parmi les plus divertissants et
les plus révélateurs de leur époque.
Vendu.
MASSON (Georges-Armand) — Chorceaux moisis (L'Histoire farfelue) de la Genèse aux Temps modernes. Paris, Librairie Stock, 1958. In-8° (145 x 203 mm.) broché sous une couverture illustrée par Ben, 252 p.
Table des matières
:
I.
Naissance du Palpable.
II. Version d'Ève.
III. Version d'Adam.
IV. Version du Serpent.
V. L’affaire Tirésias.
VI. Le premier Championnat de Beauté
féminine.
VII. La vérité sur le Déluge.
VIII. Pension Calypso.
IX. Extrait des Mémoires de Putiphar.
X. Journal de Jonas.
XI. Le roi David.
XII. Un chapitre inédit d’Hérodote
: chez les Logophages.
XIII. Le troisième Alcibiade. (Dialogue
inédit de Platon).
XIV. Le Nez de Cléopâtre.
XV. Rome-Soir.
XVI. Du Rififi chez les Mérovingiens.
XVII. L'Opération Culotte.
XVIII. Les Rois Fainéants.
XIX. Martel en tête.
XX. La Première Pierre.
XXI. L'An Mil.
XXII. Le Droit du Seigneur.
XXIII. Le huitième Voyage de Sindbad.
XXIV. Pensées choisies de la Barbe
Bleue.
XXV. Au Rendez-vous des Siècles.
Vendu.
['PATAPHYSIQUE]. Monitoires du Cymbalum Pataphysicum. N° 17. Les Jours & les Nuits. Essai d'iconologie documentaire (& plus) pour enluminer, illuminer & scientifiquement enténébrer les clartés & les obscurités du roman d'un déserteur d'Alfred Jarry. Par une Transcommission Exceptionelle du Cymbalum Pataphysicum emmenée par l'Intermission des Ornements. Sermiers, Cymbalum Pataphysicum, 1990. In-8° (151 x 210 mm.) agrafé, 72 p., illustrations.
Avant-propos :
Aube et
lueurs.
C'est le jour et la nuit... : ainsi la
sagesse des nations oppose-t-elle les contraires. Les Jours
et les Nuits est certes le roman du discontinu où contrastent
valeurs et couleurs, noir et blanc, bleu et rouge, diurne et nocturne,
veille et rêve, « réel » et
hallucination. Tel est le point de vue du bourgeois ou du savant :
analyse.
Autre truisme, l'identité des contraires
préside aussi à ce « roman »
qui, avant les Gestes et opinions du Docteur Faustroll,
traite explicitement de Pataphysique : fusion des couleurs,
le gris et le violet (« trop de complémentaires »)
du réel et de l'imaginaire, abolition du temps (cf. les
haschischins) et de l'espace (« optique protubérante
d'anoures »), suppression de la césure entre
l'Extérieur, ou Dieu, et Soi. Et en avant les gloses :
Bouddhisme Zen, « les contraires sont identiques, etc. » :
Pataphysique selon Monsieur Prudhomme.
La synthèse supérieure (O Claude
et Emile Bernard... et nous retrouvons les couleurs), ou la « parallélirésultante »,
comme synthétise Nosocome, est, pour le vulgaire, confusion.
Pour les intelligents selon Sengle, la fusion, non le mélange,
mais la juxtaposition des couleurs pures, des images et des mots,
est nourriture, « car servir les aliments à
l'esprit broyés et brouillés épargne le travail
des oubliettes destructrices de la mémoire, et l'esprit
peut d'autant plus aisément après cette assimilation
recréer des formes et des couleurs nouvelles selon soi. »
La composition du roman, qu'on analysera, en
fin de ces études, quasi wagnérienne en ses leitmotive
et ses résonances, est orchestrée par le thème
militaire qui brasse l'ensemble : l'armerdre où le
discontinu du temps, le nombre de jours et de nuits restant à
parcourir pour la libération est tout, où les corvées
sont d'enfer, sisyphéennes et éternelles, où
le noir des brodequins s'oppose à la blancheur du treillis
comme la veste bleue au pantalon garance. De là la désertion
vers l'Extérieur ou vers Soi, hors du temps et des corvées,
hors du bicolore vers le blanc, désertion par le truchement
de Dulcinée, de la caféine, du haschisch ou de Choppy
Warburton.
Mais foin de l'Histoire de l'Art, des citations
latines et des idées générales... Comme « il
est stupide de prendre des notes écrites »,
le présent Monitoire est conçu album d'images,
« sans lien que successif », album à
feuilleter, si possible rapidement (« car le cinématographe
est préférable au stéréoscope »),
comme un enfant un recueil d'Épinal. Tant l'image est ici
plus adéquate que la parole : vers comme prose seraient
« d'officier », assenés comme des
ordres, tant es déclamations de Trimardot sont moins parlantes
que les mimes silencieux du boulevard Jovial.
« Quel beau livre que Les Jours
et les Nuits. Si beau qu'on n'a envie d'en rien dire »
écrivait le Dataire Nautil au TS Maurice Saillet. Au moins
peut-on montrer. Pour les maniaques de la chose écrite,
les légendes seront les poteaux indicateurs balisant les
« points de vue » où ralentiront
ceux qui se croient poètes. Puisse au moins leur contemplation
se faire à des lueurs moins connues que celles qui sont
familières à la foule, cette grande héméralope.
10 euros (code de commande : 02223).
PEILLARD (Léonce) — La Bataille de l'Atlantique. 1. La Kriegsmarine à son apogée. (1939-1942). Préface de l'amiral Karl Dönitz. 2. La victoire des « chasseurs ». (1942-1945). Préface de l'amiral Peter Gretton. Paris, Laffont, 1974. Deux volumes in-8° (156 x 240 mm.) brochés, 371 et 349 p., un cahier hors texte d'illustrations pour chaque volume, (collection « L'Histoire que nous Vivons »), exemplaire en bon état.
En quatrième
de couverture, tome 1 :
La
mer, les hommes, la guerre : Léonce Peillard a réuni
pour cette magistrale histoire de la bataille de l'Atlantique
tous les éléments du grand drame qui s'est joué
dans l'Océan de 1939 à 1942. De la mer il a une
connaissance personnelle. Les hommes, il les a interrogés
– et le grand-amiral Dönitz donne une préface
à l'ouvrage. La guerre, il l'a étudiée dans
des documents inédits et dans des travaux personnels qui
trouvent ici leur couronnement.
Car cette bataille, de 1939 à 1942, est
bien le centre des conflits sur mer qui ont décidé
pour une large part du sort de la guerre mondiale. Nous suivons
ici l'action méthodique et audacieuse de la Kriegsmarine.
Elle lance un défi à la Royal Navy : avec les
U-Boote, les cuirassés de poche – qui ne se souvient
du Graf Spee ? – les « raiders ».
Et de 1939 à 1942 elle gagne, mettant en pièces
les convois, isolant l'Angleterre des États-Unis.
Léonce Peillard nous donne à voir
les navires, les péripéties de la bataille, les
hommes au, combat. Vie et précision sont les qualités
maîtresses de cet ouvrage où s'annonce, alors que
s'achève l'année 1942, la revanche implacable des
marines alliées.
En quatrième de couverture, tome 2 :
C'est la revanche des marines alliées
que Léonce Peillard raconte dans ce second tome de sa magistrale
Bataille de l'Atlantique.
L'Histoire a tourné. Dès la fin
de l'année 1942, les sous-marins de Dönitz deviennent
des « loups » traqués par les « chasseurs ».
La Royal Navy a fourbi ses armes : navires plus rapides,
moyens de détection perfectionnés, surveillance
aérienne accrue de l'Atlantique. Les U-Boote sont, malgré
leur plus grand rayon d'action, tenus en échec. Et les
convois passent. La maîtrise de la mer est de nouveau aux
mains des Alliés malgré les efforts et les exploits
des marins allemands. Quant aux « readers »
allemands, ils sont écrasés sous les bombes dans
les fjords ou les ports où ils se cachent. C'est la fin
de la marine de guerre allemande.
Léonce Peillard a utilisé de nombreux
documents inédits. Il raconte, il explique. Le premier
volume était préfacé par le grand amiral
Karl Dönitz. Celui-ci est précédé d'un
texte de l'amiral britannique Sir Peter Gretton. Ainsi, symboliquement,
Léonce Peillard a-t-il voulu marquer les deux visages de
la bataille de l'Atlantique, épisode décisif de
la Deuxième Guerre mondiale.
Vendu.
POL POT — Les grandioses victoires de la révolution du Kampuchea sous la direction clairvoyante du Parti Communiste du Kampuchea. Discours du camarade Pol Pot, Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste du Kampuchea, lors du meeting commémorant le 17e anniversaire de la fondation du Parti Communiste du Kampuchea et à l'occasion de la proclamation solennelle de l'existence officielle du Parti Communiste du Kampuchea. 27 septembre 1977. [Phnom Penh], Ministère des Affaires Étrangères du Kampuchea Démocratique, 1978. In-8° (130 x 184 mm.) broché, 111 p.
Table des matières
:
-
Introduction.
Première partie. Du mouvement de lutte
du peuple du Kampuchea de la période esclavagiste à
1960.
Deuxième partie. De la révolution
nationale démocratique sous la direction du Parti Communiste
du Kampuchea de 1960 à 1975.
Troisième partie. De la nouvelle étape
de la révolution du Kampuchea : défense du
Kampuchea démocratique, continuation de la révolution
socialiste et édification du socialisme.
10 euros (code de commande : 02212).
[PREMIÈRE GUERRE MONDIALE]. 1914-1918. Un beau régiment picard. Le 272e R.I. Historique par le Commandant Balland. Récits et contes de MM. Gense et Le Merer. Avant-propos par J. Dherissart. Amiens, Le Courrier Picard, 1950. In-8° (137 x 203 mm.) broché, 182 p., quelques illustrations, tache sur la couverture sinon exemplaire en bon état.
Extrait de l'avant-propos
:
L'Amicale
des Anciens Combattants du 272e R. I. (1914-1918) a le grand plaisir
de publier cet ouvrage, grâce à la très généreuse
souscription de nombreux Anciens du régiment qui ont répondu
à son appel de toutes les régions de France, et
aussi de sympathisants et de collectivités ; les noms
de ces souscripteurs figurent in fine dans ce livre.
Il est imprimé sous la responsabilité
de quelques membres du Comité qui en ont garanti le financement.
C'est le récit – rendu possible
grâce au Carnet de Route du regretté Commandant Balland,
président-fondateur de l'Amicale – des faits
d'armes de ce splendide Régiment de réserve, qui
glana cinq citations sur le front français où il
fut engagé du premier au dernier jour de la Grande Guerre,
historique suivi d'anecdotes vécues, écrites sur
le vif par deux de nos camarades, Gense et Le Merer.
Un tel livre, le premier du genre en Picardie,
offrira, nous en sommes sûrs, un très grand intérêt,
non seulement pour les Anciens du 272e et les familles des disparus,
mais aussi pour ceux de tous les Anciens Combattants des anciens
régiments du 2e Corps d'Armée qui y retrouveront
les secteurs du front qu'ils ont également occupés.
15 euros (code de commande : 02232).
REYNAERT (Georges) — Journal de ma prison sous la Gestapo en 1944. Chimay, Chez l'auteur, 1995. In-8° (150 x 211 mm.) collé, 224 p., illustrations, envoi de l'auteur, exemplaire en bon état.
En quatrième
de couverture :
Samedi
22 avril 1944, 7 heures du matin, trois Allemands accompagnés
du garde champêtre et de son chien se présentent
chez moi, 6, rue du Château à Chimay. J’étais
occupé à scier du bois ; c’est sans méfiance
que je vais leur ouvrir la porte. Aussitôt entre un sous-officier
qui me demande si c’est bien moi Georges Reynaert, et à
mon affirmation, me demande ma carte d’identité. L’ayant
lue, il me crie : « Vous êtes arrêté
par la Sécurité allemande »...
Ce livre d'une époque, rempli d'événements,
d'anecdotes, de dessins et croquis réalisés en prison
raconte, jour après jour, l'entièreté de
cette période de ma vie.
Vendu.
RUBENS
(Pierre-Paul) — Lettres inédites de Pierre-Paul
Rubens, publiées d'après ses autographes, et précédées
d'une introduction sur la vie de ce grand peintre, et sur la politique
de son temps, par Émile Gachet, attaché à
la Commission Royale d'histoire de Belgique. Bruxelles, Hayez, 1840. [Bruxelles, / M. Hayez, Imprimeur de l'Académie
Royale, / rue de l'Orangerie, section 7, n° 16. / 1840.] In-8° (145 x 225 mm.) broché,
[1 (faux-titre)], [1 bl.], [1 (titre)], [1 bl.], LXXXII, 290 p.,
rousseurs à la couverture défraîchie, intérieur
frais.
Amical envoi
de l'auteur à Augustin Lacroix.
Extrait de l'avertissement
:
Nous
devons à M. Gachard, archiviste général du
royaume de Belgique, la plus grande partie des lettres qui forment
cette correspondance. Il les avait recueillies à Paris
et à Aix, pendant le voyage qu'il fit en France en 1838,
et c'est d'après les copies qu'il a bien voulu nous confier,
que nous avons fait notre traduction. Si la forme et le caractère
de ces documents n'excluait pas toute espèce de doute sur
leur authenticité, et si nous avions besoin d'en donner
des preuves, le témoignage d'un homme aussi compétent
que M. Gachard, suffirait pour dissiper toute crainte à
cet égard. Voici en quels termes il s'en explique dans
le rapport adressé à la commission royale d'histoire,
le 4 juillet 1838 : « Une collection dont la découverte
excitera peut-être chez nos compatriotes un plus puissant
intérêt .... est celle de quarante-trois lettres
entièrement autographes du prince des peintres flamands,
de noire immortel Rubens : de celles-là au moins l'authenticité
ne pourra être contestée. Je ne doute pas qu'on sera
impatient en Belgique de connaître cette correspondance
d'un homme dont les productions inimitables feront à jamais
la gloire de notre pays, surtout après la publication qui
eut lieu naguère de lettres attribuées à
Rubens, mais qui portaient des caractères évidemment
suspects. »
Dans un autre rapport, adressé à
la même commission, le 2 novembre 1838, M. Gachard parle
ainsi des lettres trouvées à la bibliothèque
d'Aix : « Dans sa correspondance avec Dupuy, Rubens
s'occupe principalement des affaires politiques et militaires
de son temps. Les lettres conservées à Aix offrent
un intérêt supérieur, Rubens y traite des
questions d'archéologie, qui lui étaient familières
autant que celles qui se rapportaient aux beaux-arts ; il
parle de ses ouvrages et de lui-même. »
Mais afin de mettre le public encore plus à
même de juger, voici l'indication des sources qu'il est
permis à chacun d'aller consulter.
Toutes les lettres adressées aux Dupuy
reposent en autographes à la bibliothèque du roi
à Paris. Celles qui sont à l'adresse de Valavès
ou de Peiresc se trouvent copiées dans le recueil authentique
de la correspondance de ce dernier, et sont déposées
à Aix en Provence, dans la bibliothèque de Méjanes.
Toutes les autres enfin pro­viennent de la bibliothèque
de Bourgogne à Bruxelles, où elles reposent soit
en autographes, soit en copies authentiques. Nous y avons ajouté
comme accessoire indispensable, certains fragments de la correspondance
de Gevaerts, qui servent à jeter plus de lumière
sur celle de Rubens, et qui sont également tirés
de la bibliothèque de Bourgogne. Notre table indiquera
au reste toutes les sources pour chaque lettre.
Qu'il nous soit permis d'adresser ici nos remerciements
bien sincères à M. Gachard; il ne s'est pas contenté
de nous procurer la matière indispensable de ce recueil,
la copie même des lettres, il a encore libéralement
ouvert devant nous le trésor des archives dont il a le
soin, et il a mis entre nos mains tous les documents qui pouvaient
nous être utiles. C'est aussi par son entremise bienveillante,
que M. Rouard, conservateur de la bibliothèque de Méjanes,
a eu l'obligeance de copier toutes les lettres qui nous manquaient.
Que ce dernier veuille agréer aussi pour lui-même
l'expression de notre reconnaissance.
Vendu.
SANCHEZ (Tomás) — Compendium totius tractatus de S. Matrimonii sacramento. R.P. Thomae Sanches E Soc. Iesu. ab Emanuele Laurentio Soarez Ulyssiponensi, Presbytero Theologo, Alphabeticè breviter dispositum. Cologne, Henning, 1623. [Coloniœ Agrippinœ. Sumptibus Petri Henningij, Anno M. DC. XXIII.] In-12 (83 x 130 mm.) plein veau, dos lisse, pièce de titre en parchemin, coiffe abîmée, [1 (titre)], [1 bl.], [22 (épître, approbation, index)], 455, [1 bl.] p., ex-libris de l'avocat montois Letellier.
Curieux traité
du mariage décrivant tous les raffinements de la luxure...
Tomás Sánchez (Cordoue, 1550 -
Grenade, 1610) entra à seize ans chez les Jésuites
et devint directeur du noviciat de Grenade. Son traité
du mariage « où tous les raffinements de la
luxure sont soigneusement décrits, mérite une mention
pour la place qu'il tient dans les débats du XVIIe et du
XVIIIe siècle au sujet de la morale des jésuites. »
120 euros (code de commande : 02203).
SCHWOB (Marcel) — Le livre de Monelle. Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1946. In-8° (145 x 195 mm.) broché sous une couverture rempliée ornée d'une vignette dessinée par Henri Matisse, 179 p., (collection « Le Fleuron », n° 2), exemplaire numéroté sur vélin blanc (n° 1306).
En quatrième
de couverture d'une réimpression aux éditions Allia
:
« Et Monelle dit encore : je te parlerai des moments. Regarde
toutes choses sous l’aspect du moment. Pense dans le moment.
Toute pensée qui dure est contradiction. Aime le moment.
Tout amour qui dure est haine. Sois sincère avec le moment.
Toute sincérité qui dure est mensonge. Sois juste
envers le moment. Toute justice qui dure est injustice. Agis envers
le moment. Toute action qui dure est un règne défunt.
Sois heureux avec le moment. Tout bonheur qui dure est malheur.
Vois : tout moment est un berceau et un cercueil : que toute vie
et toute mort te semblent étranges et nouvelles. »
Dans ce classique de la littérature « fin
de siècle », source d’inspiration pour
Les Nourritures terrestres de Gide, on rencontre Monelle,
jeune prostituée dissimulée dans le décor
d’une ville sans charme.
Figure christique, ses paroles sont celles d’une
sibylle candide, intemporelle, qui rejette la vérité
au profit du songe et appelle à sortir du temps, à
jouer, à mentir pour jouir du moment.
Les personnages de Schwob n’aspirent pas
à notre compassion. Enfants prostituées, femmes-enfants,
c’est dans leurs contradictions qu’elles frôlent,
l’espace d’un instant, la béatitude. L’adolescence
n’est qu’une première mort, le début d’une
longue digression, non sans noblesse, aux tréfonds de la
nuit : tout détruire, tout oublier seront les conditions
d’une vie nouvelle.
Vendu.
[STREBELLE
(Rodolphe)]. Rodolphe Strebelle 1880-1959. Bruxelles, Musée d'Ixelles, 1981. In-8°
(211 x 210 mm.) broché, [68 p.], nombreuses illustrations
en noir et en couleurs, exemplaire en bel état, peu courant.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition rétrospective présentée
au Musée d'Ixelles, du 13 février au 22 mars 1981
puis au Musée de la Boverie, à Liège, du
1er avril au 3 mai 1981 et au Musée des Beaux Arts de Tournai,
du 6 juin au 19 juillet 1981, à l'occasion du centenaire
de la naissance de l'artiste.
Article de Paul Caso dans
le journal Le Soir du 18 février 1981 :
Que de souvenirs réveille en nous, dans
les salles du musée d'Ixelles, la rétrospective
des œuvres de Rodolphe Strebelle ! Il est mort à
Uccle le 9 mai 1959. Nous l'avons connu une dizaine d'années,
dans ce petit monde du « Kamerdelle », où
l'art mûrissait encore en même temps que les blés
et les fruits des vergers.
De grands artistes vivaient là sur une
colline inspirée. Les « Strebelle »
y formaient une tribu pleine de jeunesse et d'avenir. Il y avait
le père Rodolphe, qui portait avec élégance
et discrétion son prénom romantique, « Poppy »
la mère souveraine, fière de ses trois fils Jean-Marie,
Claude, Olivier et de sa collection de coquillages. Une dynastie
d'artistes en puissance. La modestie du père était
extrême. Il ne fit de son vivant que huit expositions personnelles.
Ce Tournaisien de bonne souche apportait, au
sein du groupe « Nervia », une âme
grave et mélancolique ; très individualiste,
il n'en sera pourtant pas moins attentif à l'animation
intime et chaleureuse du fauvisme brabançon, à l'arabesque
hardie, à la touche vibrante.
Mais sa palette ne s'est point vraiment embrasée ;
il aimait trop les nuances, le vert transparent, le bleu tendre,
le gris frémissant pour ne pas se fixer en définitive
dans la propre conscience qu'il avait de son domaine privé :
sa famille, la maison, les voyages d'inclinaison – avec
au bout de l'évasion, la mer de Bretagne aimée.
Sa passion des siens l'inspirait à chaque
événement de la vie de famille comme au moindre
geste gracieux de l'enfant à la plage. Des amitiés
lui furent précieuses : celle d'Oleffe si efficace
pour toute une génération, celles de Schirren et
de Brusselmans. On voit bien aussi, dans quelques grands morceaux
de peinture, que le style épuré et expressif de
Gustave Van de Woestyne fascina Rodolphe Strebelle.
En 1959, nous écrivions dans le catalogue
du salon des Peintres de le la mer qui lui rendait, cette
année-là, hommage : « Il est de
cette race qui tient l'art pour une longue patience, une fervente
révélation de ce domaine intérieur, où
l'homme est seul à l'écoute du monde. Certes, toutes
les inquiétudes, toutes les joies qui sont réservées
à l'artiste en pleine possession de ses moyens, et guidé
par un instinct très sûr de la couleur et de la forme,
Rodolphe Strebelle les a éprouvées. »
La rétrospective du musée d'Ixelles
rassemble cent quarante toiles, pastels, aquarelles et dessins
de 1914 à 1956 – avec des œuvres majeures comme
La Femme au chapeau (1915), Les Écoliers
(1921), Portraits des enfants (1925) et Femme enceinte
(1927). Mais certains tableaux importants manquent à l'appel
comme Recueillement (1926), L'Enfant malade (1938)
et la Pietà de 1942, pour n'en citer que trois.
Les scènes de plage sont nombreuses,
mais aussi d'admirables marines à Camaret. Nous aurions
souhaité revoir aux cimaises plus de paysages d'Ardenne
d'une beauté à la fois sombre et sereine, d'une
originalité si impressionnante par la densité même
de la matière.
Quoi qu'il en soit, la vaste exposition du musée
d'Ixelles nous rend infiniment proche le génie de l'intimisme
que possédait Rodolphe Strebelle.
Bernard Berenson évoquait la fuite du
temps, la vie perpétuée par le grand art :
« En somme, écrit-il, le moment esthétique
est un moment de vision mystique. » Oui, un état
de grâce qui nous touche d'une œuvre à l'autre,
qui nous entraîne dans cet univers de ferveur où
Rodolphe Strebelle nous fait entendre les battements d'un cœur
religieux qui se délivre de la mort même par la transcendance
de l'art.
Désormais, il faudra situer ce peintre
parmi les plus grands.
15 euros (code de commande : 02233).
VALLOTTON (Henry) — Voyage au Congo et au Ruanda-Urundi. Carnet de route. Bruxelles, M. Weissenbruch, [1954]. In-8° (148 x 203 mm.) broché sous couverture à rabats, 112 p., XXXII planches photographiques hors texte, carte au verso du premier feuillet de la couverture, exemplairenon coupé.
Introduction :
Talleyrand
a écrit, un jour : « Les habitants du Congo
sent les plus barbares, les plus dégradés de l’espèce
humaine : anthropophagie, ivrognerie, obscénité
immonde, tels sont les caractères de ces races enveloppées
d’un abrutissement qui ne fait que croître avec les
siècles... »
Quelque cent ans plus tard, André Gide
disait à son tour, dans une préface : « Les
peuples dits civilisés n'ont guère porté
attention au monde noir de l'Afrique que pour l'exploiter... »
Ces jugements sévères du Diable
Boiteux et du Prix Nobel de littérature sont-ils valables
pour les Noirs et les Blancs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi
sous tutelle belge ? C’est une des questions que je
m'étais proposé d'étudier sur place. Bien
que ce fût ma première visite aux territoires administrés
par les Belges, cinq grands voyages en Afrique (notamment un périple
en automobile de Conakry au Lac Tchad, à l'époque
« héroïque » des pistes incertaines
et des cases à serpents) m'ont familiarisé avec
les Noirs et les problèmes délicats du colonialisme :
je ne suis donc pas tout à fait incompétent.
Fidèle à de vieilles habitudes,
j’ai jeté en route quelques notes sur mon bloc, notes
que j’ai rédigées à la fin de chaque
étape. Simple carnet d’un observateur impartial, sans
prétention littéraire.
Vendu.
[VIRGILE (Publius Vergilius Maro)]. MAGALLON (Xavier de) — Les Bucoliques de Virgile. Préface de Fernand Mazade. Deuxième édition. Paris, Les Éditions Nationales, 1933. In-8° (145 x 193 mm.) broché, XVII, 143 p., traduction juxtalinéaire, rousseurs.
Extrait de la préface
:
Le
propre de cette traduction (puisqu'il faut employer, faute de
mieux, le mot impropre) est, avant tout, une littéralité
méticuleuse. Pas de prose qui puisse serrer de plus près
le texte. Nul délayage, ni addition ni omission :
le nombre de vers de Virgile, pas un de plus, pas un de moins.
Souci puéril ? Halte ! Le français n’est
pas, quoi qu'on le prétende, une langue d’un tissu
plus lâche que le latin ; et si la nouvelle expression
de la même pensée n'exige pas plus de place, nous
avons la preuve qu'elle l'embrasse aussi étroitement. C’est
ce qu'a permis à Xavier de Magallon la réunion,
souvent constatée chez lui par divers critiques (Eugène
Montfort, Léon Daudet), de deux vertus en apparence opposées :
l'élan lyrique et la concision. Non seulement les termes
sont ici rendus, mais, résultat non moins important, leur
ordre est observé, le contour des phrases est suivi :
les coupes, les rejets, les arrêts, toutes les sinuosités
du flot entraînant.
8 euros (code de commande : 02215).
[WALLONIE
- SITES MINIERS]. Les sites
miniers majeurs de Wallonie, patrimoine mondial. Par Jacques
Crul, Jean-Louis Delaet, Gislaine Devillers,
Alain Forti, Bruno Guidolin, Robert Halleux,
Karima Haoudy, Pierre Paquet, Guillaume Pisella
et Maryse Willems. Namur, Institut du Patrimoine Wallon,
2012. In-8° (160 x 240 mm.) agrafé, 68 p., illustrations
en couleurs, (collection « Les Carnets du Patrimoine »,
n° 96), exemplaire à l'état de neuf.
Épuisé
au catalogue de l'éditeur.
En quatrième
de couverture :
Blegny-Mine,
le Bois du Cazier, Bois-du-Luc et le Grand-Hornu, quatre sites
miniers majeurs de Wallonie inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO lors de la 36e Session organisée à Saint-Pétersbourg
en juillet 2012.
Avec ce Carnet du Patrimoine, vous découvrirez
ces sites sous un angle différent. Des conditions de travail
à l'habitat, de la genèse de l'aventure charbonnière
aux relations de pouvoirs, des luttes sociales aux avancées
technologiques, des parcours migratoires des travailleurs aux
brassages culturels engendrés par la mine... l'approche
permet de mesurer la valeur exceptionnelle de ces quatre sites
qui forment un microcosme unique et cohérent.
Ces sites condensent tous les aspects du patrimoine
minier, technique et social. Ils se complètent réciproquement :
Blegny-Mine et le Bois du Cazier éclairent davantage la
dimension « travail et travailleurs » au
travers notamment des conditions de travail, de l’évolution
technologique et de l'immigration. Le Grand-Hornu et Bois-du-Luc
illustrent essentiellement les relations patron/ouvrier tantôt
harmonieuses tantôt ébranlées par les révoltes
ouvrières qui se lisent concrètement à travers
l'architecture et la planification spatiale de l'habitat.
Si les quatre sites sont complémentaires
les uns par rapport aux autres, ils le sont aussi à l'échelle
internationale. Les sites miniers majeurs de Wallonie viennent
enrichir le maillage des complexes, patrimoniaux et paysagers,
les plus exceptionnels de l'ère industrielle (Zollverein,
New Lanark, Blaenavon, Salines royales d'Arc-et-Senans, etc.).
Que ce Carnet du Patrimoine vous permette
de redécouvrir la valeur universelle du microcosme formé
par les quatre sites miniers.
Vendu.
aura lieu
le mardi 29 avril 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone ou sms (+32 (0) 472 51 52 63).
Ces livres peuvent être retirés à l'adresse figurant dans l'en-tête du blog.
En cas d'envoi postal, veuillez indiquer le pays vers lequel le colis devrait être expédié, cela me permettra de vous indiquer les modalités de livraison et de paiement.











.jpg)
.jpg)
















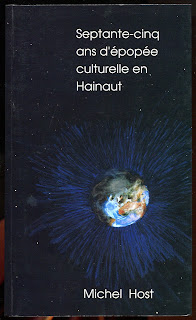


















.jpg)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire