MISE À JOUR DU 3 JUIN 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone (+32 (0) 472 51 52 63)
pour obtenir d'autres informations à propos de ces livres.
[ACADÉMIE D'ARCHÉOLOGIE DE BELGIQUE]. Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. 3e Série - Tome XL - 1re, 2e, 3e et 4e livraisons (complet). Anvers, Van Merlen, 1884. Quatre livraisons en trois volumes in-8° (155 x 233 mm.) brochés, 467 p., manque à la couverture du deuxième volume, le second feuillet de couverture du troisième volume manque.
Table des matières
:
- Études
étymologiques et linguistiques sur les noms de lieux bas-allemands
de la Belgique, seconde partie, par G. Bernaerts, p.
6.
- Daniel Seghers, de la compagnie de
Jésus, peintre de fleurs, sa vie et ses œuvres, 1590-1661,
par Fr. Kieckens, p. 355.
30 euros (code de commande : 02376).
ADAMOV (Arthur) — Paolo Paoli. Paris, Gallimard, 1957. 5e édition. In-8° (120 x 186 mm.) broché, 286 p., (collection « Le Manteau d’Arlequin »).
En quatrième
de couverture :
Le Ping-Pong annonçait un renouvellement
de la dramaturgie d'Arthur Adamov. Au lieu des archétypes
ou des figures oniriques qui peuplaient jusqu'alors son théâtre,
les personnages du Ping-Pong témoignaient tous,
à des degrés différents, d'une réalité
sociale. Avec Paolo Paoli, ce renouvellement s'accomplit.
Au Ping-Pong faisait encore défaut une société
précise. Nous la trouvons maintenant dans Paolo Paoli :
c'est la société de notre prétendue « belle
époque ».
Paolo Paoli n'est pas, bien sûr,
une de ces pièces dites historiques où l'histoire
ne sert que de prétexte à l'amusement ou au dépaysement
du spectateur complice. À travers ses personnages qui,
au départ, peuvent paraître frivoles, c'est la réalité
sociale et historique elle-même de cette époque commencée
en opérette et terminée en tragédie, par
la guerre de 1914, que l'on reconnaîtra. Le trafic des plumes
et des papillons révèle ici un autre trafic :
celui des hommes, de leur travail, de leur temps et de leur sang.
Ainsi à la comédie d'un langage
petit-bourgeois qui se donne libre cours, répond un drame
réel, daté et pourtant toujours actuel : celui
d'un monde où tout s'échange et se vend dans le
décor des beaux sentiments et des bonnes intentions.
Bibliographie :
- Lempereur (Nathalie), Arthur Adamov,
ici et maintenant, Éditions de la Sorbonne, 2020, chapitre
IV : « Le tournant de Paolo Paoli »,
pp. 107-131.
8 euros (code de commande : 02382).
[AFFAIRE
CRIMINELLE - LAROCH (François)]. Notice historique sur
la vie de François Laroch. S.l., [ca 1825].
In-12 (114 x 206 mm.) en ff., 12 p., exemplaire à
toutes marges, quelques rousseurs.
Un ouvrage très
rare.
Extrait du jugement :
Rendu
par la cour spéciale de la province de Namur, séant
à Namur, qui condamne à la peine de mort le nommé
Fr[a]nçois Laroch, âgé de 31 ans natif de
Vieu Sarre près Wavre, sans profession ni domicile, atteint
et convaincu d'avoir le 20 du mois dernier volontairement et avec
préméditation en état de vagabondage dans
un chemin public de la commune de St. Servais assassiné
à coups de bâton et de pierre Marie Thérèse
Debouge, épouse Legrain, et Victoire Martin, sa belle fille
âgée de 22 ans toutes deux de Bellegarde communes
de Flavines près Namur et d'avoir ensuite volé tous
les bijous 18 florins et effets d'habillements que portaient les
dites Legrain et Martin.
Vu par la cour spéciale de Namur, l'arrêt
de la Cour supérieure de Justice séant à
Liége, en date du 17 du mois dernier, vu l'arrêt
de la Cour de cassation en date du 5 du mois dernier qui confirme,
l'arrêt de l'envoi à lui mentionné, vû
l'acte d'accusation sui les témoins produits par Mr. le
procureur criminel, ouï Mr. le procureur criminel pour l'application,
de la peine la cour a condamné François Laroch,
à la peine de mort et aux remboursement des frais envers
l'état, que les objets volés servant de conviction
seront restitués aux propriétaires, que l'exécution
en sera faite sur la grende place à Namur, fait et prononcé
en séance publique de la cour spéciale de Namur,
le 28 du mois dernier.
Signé Plunus procureur
criminel.
Il a été exécuté
le 24 du mois dernier à midi 1/4.
Bibliographie :
- Registre des executés et la maniere
de donner des extraits mortuaires, p. 29, document disponible
sur le site numeriques.be de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
40 euros (code de commande : 02385).
NOUVEAUTÉ
ANSIEAU
(Cécile) et WATERLOT (Bernard) — Tous les chemins
mènent au Vodgoriacum. La représentation de la
Gaule et des chaussées romaines au travers des cartes
anciennes. Mons, Éditions
Musea Nostra, 2025. In-8° (200 x 271 mm.) collé,
48 p., illustrations en couleurs, 15 cartes à déplier.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
par l'A.S.B.L. Statio Romana, au Musée Gallo-Romain de
Waudrez, du 8 avril au 2 novembre 2025.
En quatrième de
couverture :
Malgré
son grand âge, la chaussée qui mène de Bavay
à Cologne, vestige archéologique antique, reste
bien inscrite dans le paysage de la Wallonie depuis plus de 2000
ans. De nombreuses fois remaniée, elle a été
utilisée au fil des siècles et continue à
l’être de nos jours sur de nombreux tronçons.
Le vicus de Vodgoriacum attesté
sur les itinéraires romains, aujourd’hui Waudrez
près de Binche, constitue la première station située
à une trentaine de kilomètres de la capitale des
Nerviens, Bavay.
Le Centre d’interprétation de la
Chaussée Romaine qui est installé au cœur
même du Vodgoriacum nous semblait l’endroit idéal
pour montrer au public comment cette importante voie de communication
et les agglomérations qui la jalonnent étaient
représentées dans la cartographie des XVIIe et
XVIIIe siècles.
L’exposition qui a donné lieu à
cette modeste publication suscitera, nous l’espérons,
le développement d’un travail plus important afin
d’approfondir un sujet inédit et riche d’enseignement
historique...
25 euros (code de commande : 02198).
ARÉTIN (Pierre l') — Les Ragionamenti. Illustrations de Paul-Émile Bécat. Préface de Christian Dotremont. Premier et second livres (complet). Paris, Éditions de la Nef d'Argent, 1944. Deux volumes in-8° (183 x 250 mm.) brochés sous couvertures rempliées, 145 et 211 p., illustrations en noir dans le texte, bien complet des 32 planches hors texte en couleurs, exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon (n° 363), en très bon état.
Extrait de la préface
:
L'Arétin
étale [...] dans ces Ragionamenti, toute sa connaissance
méticuleuse de l'époque, cependant qu'il y montre
une psychologie sans détours, une science raffinée
du style, et particulièrement du dialogue, une verve solide.
Mais les Ragionamenti s'élèvent
bien au-dessus d’un siècle, bien au-dessus d’un
pays. Loin de les avoir écrits pour se décharger
de ce qu’il savait, comme fait un journaliste, l'Arétin
semble y avoir utilisé les mœurs de son époque
pour peindre les mœurs de l’humanité, comme fait
un Shakespeare. Quoi qu’il en soit de l'intention de l'Arétin,
les Ragionamenti passent du particulier au général,
de l'Italie du seizième siècle a l’humanité.
Aussi bien est-il prudent de se garder d’un
jugement hâtif sur l'Arétin et sur son maître
livre. Si l'Arétin a dépensé son génie
à infiniment de libelles, c’est qu’il était
de son temps, et qu’il n'avait point de rentes. Et c’est
également parce qu’il était de son temps, que
les Ragionamenti ont une telle valeur humaine. L’écrivain
qui bâille dans sa tour d'ivoire peut avoir la plus forte
imagination du monde, il n’est pas capable de parler des
hommes, ni de l’homme. Il y a plus : l’Arétin
vivait son temps. « On ne raille bien que les travers
qu'on partage » est un adage qui s'applique aux Ragionamenti
mieux qu’à toute œuvre.
L'on pourrait dire de ces dialogues qu'ils sont
à l'amour ce que le Prince est à la politique.
Ce n’est pas un mince éloge. L’Arétin
est le Machiavel du vice, et le vice n’est souvent que le
nom de l'amour qui avoue. Dans une époque ou il n’est
guère possible de se passer de machiavélisme, et
ou l'amour est la proie de la plus vaine des littératures,
les Ragionamenti ont une force singulière. Ils démentent
que l'amour soit « beaucoup plus que l'amour »
mais nous livrent les secrets de ce que l'on a nommé la
« parthénomachie »...
Les deux volumes : 75 euros (code de commande : 02379).
AYMÉ (Marcel) — Lucienne et le
boucher. Paris, Club Français
du Livre, 1959. In-8° (142 x 215 mm.) sous reliure d'éditeur
et composé d'après les maquettes de Jacques Daniel,
331 p., (collection « Théâtre »,
n° 17), exemplaire numéroté (n° 2379)
en bon état.
L'illustration
de la couverture est la Nature morte à la tête
de veau par Bernard Buffet.
Extrait de l'article de
Colette Godard dans le journal Le Monde :
Sur
fond de petite ville provinciale – qui tente, après
la guerre, de revenir sans changement à sa calme vie d'autrefois, –
Lucienne (Danièle Darrieux), la femme du bijoutier (Alain
Mottet), rêve aux bras puissante du boucher (Georges Geret).
Elle fait plus qu'y rêver, elle s'en entoure. Grâce
à son ardeur, à sa supériorité de
bourgeoise en bas de soie, elle « vampe »
ce brave homme patient et modeste, elle transpose sur lui tout,
une mythologie de virilité brutale, née dans les
lectures clandestines de faits divers ou de littérature
de gare osée. Elle est entraînée par un mouvement
qu'elle ne contrôle pas vers le plaisir, croit-elle, en
réalité vers une délivrance qui passe par
une série de transgressions.
L'adultère, d'abord, ces parenthèses
pendant lesquelles, obscurément, elle se sent vivre son
existence propre. Le meurtre, ensuite, car cette réalité
interdite – la réalité de son existence
propre, et non celle du plaisir – lui rend insupportable
l'hypocrisie sociale dans laquelle elle est embourbée et
celui qui la symbolise : son mari. Elle le tue et tente de faire
endosser le crime à son amant. Elle y parvient par le seul
jeu de sa « supériorité culturelle » ;
il accepte de s'accuser. Le commissaire, un ami du bijoutier et
qui en avait reçu des confidences de bistrot, démonte
le mensonge avec le dédain tranquille de ceux qui détiennent
le pouvoir légal. Alors, transgression finale, étape
essentielle, Lucienne prend en charge ses actes, l'adultère
et le crime, elle se libère enfin.
Trente ans après sa création,
cette fable méchante, cette farce aigre prend une dimension
que son auteur n'avait pas prévue. Marcel Aymé ne
se préoccupait pas de la condition féminine, il
en aurait sûrement détesté les militantes.
Mais il savait regarder, comprendre et recréer, par le
biais d'un langage très écrit, très loin
du naturalisme, dépassant largement la satire anecdotique,
des, caractères simples, riches, sans vulgarité.
Bibliographie :
- Godard (Colette), « Lucienne et
le boucher, de Marcel Aymé », dans Le Monde,
1er octobre 1976.
10 euros (code de commande : 02378).
[BELGIQUE - ÉLECTIONS COMMUNALES DE 1868]. Élections communales. Exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juin 1867 (n° 163 du Moniteur). Mons, Monjot, s.d. [Mons - De l'Imprimerie de Monjot, rue du Hautbois, 54.] Affiche au format 430 x 542 mm., un pli horizontal et un pli vertical, exemplaire en bon état.
Extrait :
Article 26.
Le président du collége ou de
la section a seul la police de l'assemblée, les électeurs
du collége y sont seuls admis sur l'exhibition de leurs
lettres de convocation, ou d'un billet d'entrée délivré
par le président du collége ou de la section ;
en cas de réclamation, le bureau décide : ils
ne peuvent s'y présenter en armes.
Vendu.
BOLLE
DE BAL (Marcel), DEJEAN (Christian), FÉAUX (Valmy) et KLARIC
(Danilo) — Suppléments de rémunération
et participation ouvrière à la vie de l'entreprise.
Enquête sociologique effectuée à la demande
de l'Office Belge pour l'Accroissement de la Productivité.
Bruxelles, Université
Libre de Bruxelles - Institut de Sociologie - Centre de Sociologie
du Travail, 1964. In-4° (213 x 275 mm.) collé,
III, 298 p., impression anapistographique.
Une publication
fort rare qui, en 1967, fut l'objet d'une édition, sous
le seul nom de Marcel Bol de Bal !
Compte-rendu de l'édition
de 1967 par Y. Émonet :
Une partie relativement importante de ce livre est consacrée
à la définition des problèmes d'ordre déontologique,
terminologique et méthodologique, que pose une recherche
dont les promoteurs sont des praticiens ; en effet des représentants
des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs
ont défini ensemble le projet de cette étude.
Comment faire pour accroître la participation
ouvrière à la vie de l'entreprise ? Une politique
d'intéressement telle que celle des suppléments
de rémunération est-elle efficace ?
Employeurs et syndicalistes s'entendent sur
le niveau de participation choisi : il s'agit exclusivement
du niveau psycho-sociologique. Mais il faudra tenir compte de
leurs préoccupations particulières. Pour les premiers
les suppléments de rémunération ont-ils bien
pour effet d'accroître la participation, et, par-là,
l'effort de production ? Pour les seconds, cette même
participation, qu'ils souhaitent, ne risque-t-elle pas de provoquer
une désaffection des travailleurs vis-à-vis des
organisations syndicales ?
Ces préoccupations vont entraîner
certaines contraintes : le choix d'une méthode micro-sociologique,
centrée sur les variables propres à l'entreprise,
et une définition de la participation limitée à
son niveau psycho-social.
Plus que dans les résultats partiels
apportés, l'intérêt de cette étude
« exploratoire » réside dans la remise
en question de la façon dont a été posé
et délimité le problème et dans une démystification
des idées préconçues sous-jacentes à
cette délimitation.
Même si les suppléments de rémunération
favorisent certains aspects de la participation, notamment la
« fixation » des travailleurs à l'entreprise
et leur satisfaction, il n'en découle pas qu'elles entraînent
une participation active à l'acte même de la production :
celle-ci exige beaucoup plus, et en particulier des facteurs plus
personnels tels que le dynamisme et un haut niveau d'aspiration.
Autre idée préconçue :
les travailleurs aspirent à la participation. Est-ce sûr ?
et de quel type de participation s'agit-il ? Il faudrait
s'assurer que les niveaux de participation souhaités et
encouragés coïncident, sinon malentendus et conflits
seront inévitables.
Quant aux suppléments de rémunération,
s'ils n'ont pas le rôle qu'on leur attribuait, ils remplissent
d'autres fonctions ; citons, pour les employeurs, celle de
sauvegarder leur autonomie, de prévenir l'insatisfaction.
Pour les syndicats ils remplissent une fonction plus « positive »,
en permettant un premier pas vers le contrôle de la gestion
et du pouvoir patronal.
Ainsi par deux voies convergentes, celle des
« projets individuels et collectifs » et
celle des « fonctions latentes » des suppléments
de rémunération, M. Bolle de Bal parvient à
cette conclusion : « Il est vain de vouloir étudier
la participation ouvrière à la vie de l'entreprise
en négligeant les problèmes des conflits et du pouvoir ».
Et les praticiens ne peuvent entreprendre une action efficace
qu'en prenant conscience, et en tenant compte de ces problèmes.
Les perspectives ne paraîtront sans doute
plus très neuves au sociologue, mais elles gardent leur
valeur pour les praticiens auxquels M. Bolle de Bal, tout au long
de son étude, a démontré que s'il est légitime
de circonscrire un aspect de la réalité, celle-ci
ne s'en impose pas moins dans toute sa complexité.
Bibliographie :
- Émonet (Y.), « Marcel
Bolle de Bal, La vie de l'entreprise. Suppléments de rémunération
et participation ouvrière. Editions de l'Institut de Sociologie,
1967 », dans Sociologie du travail, 10e année
n°3, Juillet-septembre 1968. Les cadres dans l'entreprise
et dans le mouvement syndical, sous la direction de Jacques
Lautman et Marc Maurice. p. 331.
25 euros (code de commande : 02371).
BONDAS (Joseph) — Histoire de la Centrale des Métallurgistes. 1887-1947. S.l.n.d. In-4° (210 x 270 mm.) collé, 142 p., illustrations, exemplaire en très bon état.
Table des matières
:
- Préface.
- Avant-propos.
- Avertissement au lecteur.
Chapitre I.
a) Pourquoi les travailleurs
ont-ils tardé à s'organiser ?
b) Le maître est cru
sur son affirmation.
c) Le délit de coalition.
d) L'odieux article 310.
Chapitre II.
a) Le terrain de combat.
b) La puissance de l'industrie
métallurgique.
c) Bas salaires.
Chapitre III.
a) Les pionniers.
b) La révolte des esprits.
c) Tentatives d'organisation.
d) Les plus hardis poursuivent
l'effort.
Chapitre IV.
- La Fédération
Nationale.
Chapitre V.
a) La centralisation.
b) La composition et les organes
de la Centrale.
c) Le Comité national.
d) Le Comité exécutif.
e) La Commission de Contrôle.
f) Le Secrétariat.
g) Le caractère socialiste
de la Centrale.
Chapitre VI.
- La Centrale dans les
grands conflits sociaux.
Chapitre VII.
- La Centrale pendant
les deux guerres mondiales.
a) 1914-1918.
b) 1940- 1944.
c) Des victimes du nazisme.
Chapitre VIII.
- Réalisations.
Chapitre IX.
- La Centrale et les
commissions paritaires.
Chapitre X.
- Efforts d'éducation.
Chapitre XI.
- Le 50e anniversaire.
Chapitre XII.
- L'évolution
des effectifs.
Chapitre XIII.
- La Centrale et l'action
internationale.
Chapitre XIV.
- Georges Keuwet.
Chapitre XV.
- Conclusions.
10 euros (code de commande : 02384).
[BORINAGE - LITTÉRATURE PATOISANTE]. DELAUNOY (Josiane, pseudonyme de Lisa Dujardin) — El' rastindeu de l'rue Claqu'dint. Dessins de l'auteur. [Tournai], Claquedent, 1998. In-8° (162 x 240 mm.) broché, 128 p., illustrations, un feuillet volant d'errata, exemplaire à l'état de neuf.
C'est
le brigand Moneuse qui est mis en scène ici pour une réhabilitation...car
victime de son époque...
L'auteur se décrit comme telle :
« Boraine d'origine, Africaine de
cœur,
Tournaisienne d'adoption,
Picarde par conviction : Josiane Delaunoy, auteur
picarde déjà récompensé par de nombreux
prix...
Née à Wasmes, dans le Borinage,
village du dragon, de Vincent Van Gogh, des Carbeniers, elle y
demeure le temps de son enfance et de son adolescence. Après
une agrégation en Arts plastiques, elle séjourne
plusieurs années au Burundi. Elle s'installe ensuite à
Tournai. Travail d'écriture tant française que picarde. »
15 euros (code de commande : 02395).
CHALON
(Renier) — Numismatique montoise. Louise de Stolberg,
reine d'Angleterre. [Bruxelles],
[Société Royale de Numismatique], [1852]. In-8°
(160 x 240 mm.) broché sous une couverture muette,
3, [1 bl.] p., ex-libris manuscrit de l'avocat montois Letellier,
exemplaire en parfait état.
Extrait du tome II,
2e série, de la Revue de la numismatique belge,
pp. 200-202.
Extrait :
La
médaille gravée en tête de cet article a été
faite à l'occasion du mariage de Charles Édouard
avec Louise de Stolberg Nous la croyons rare, et le seul exemplaire
que nous connaissions se trouve à Bruxelles dans le riche
cabinet de M Th De Jonghe. Elle a pour nous un intérêt
particulier, car elle peut se classer dans la série des
médailles montoises. Elle est encore curieuse à
un autre titre ; elle a conservé les traits de la
reine Louise dont il n'existe, que nous sachions, aucun autre
portrait gravé.
L'auteur de cette médaille ne nous est
pas connu. On pourrait peut-être retrouver son monogramme
dans les boucles des cheveux du prétendant qui semblent
former un E et un M.
Vendu.
[CHARLEROI]. Documents & rapports de la Société Royale Paléontologique & Archéologique de l'Arrondissement judiciaire de Charleroi. Tome XLVII. 1948-1949. Thuin, Huaux, [1949]. In-8° (170 x 250 mm.) broché, VII, 168 p., quelques planches hors texte.
Table des matières
:
- Rapport sur l'activité de la Société
en 1946.
- Rapport sur l'activité de la Société
en 1947.
- Antiquité préhelléniques
du Musée archéologique de Charleroi, par Charles
Delvoye.
- « Funderlo »
et « Marcinas ». Villæ royales carolingiennes,
par Louis Berteaux.
- Actes inédits de Nicolas II
de Barbençon, par Émile Brouette.
- Les sorciers de l'Entre-Sambre et
Meuse, par Émile Brouette.
- Le culte celtique du foyer dans la
cité des Nerviens, par G. Faider-Feytmans.
- Coup-d'œil sur Morlanwelz au
milieu du XVIe siècle, par Ed. Roland.
- Jean Caton et le carnaval de Gozée,
par J. Vandereuse.
20 euros (code de commande : 02394).
[CRIEL
(Gaston)]. HACHE (Janine, dir.) — Gaston Criel. Lille, Société de littérature
du Nord, 1994. In-8° (160 x 240 mm.) collé, 124 p.,
exemplaire en parfait état.
Il s'agit du
n° 24 - Décembre 1994 de la revue Nord' - Revue
critique et de création littéraires du Nord/Pas-de-Calais.
Sommaire :
- Dossier
: Gaston Criel.
- Biographie de Gaston
Criel. 1913-1990, par Janine Hache.
- L'arsenal d'un guérillero
de l'écriture, par Jean-Marie Sourgens.
- Gaston Criel ou
« l'étranger apres l'absurde »,
par Pierre Descamps.
- Gaston Criel, un
poête qui dérange, par Gerard Delomez.
- Criel démasqué,
par Guy Ferdinande.
- La grande foutaise,
le grand fatras, par Paul Renard.
- Phantasma :
un roman insolent, par Janine Hache.
- Les nouvelles désespérantes
/ désespérées de Gaston Criel, par Georges
Dottin.
- Criel, le jazz en
tête..., par Xavier Prevost.
- Chroniques en jazz,
par Jean-Marie Paris.
- Danielle Sarréra :
une voix sybilline, par Janine Hache.
- J'ai peur de l'ombre,
un inédit de Gaston Criel.
- Chronique bernanosienne.
- Deux livres recommandés
par Bernans en 1946 : un retour au maurrassisme ?,
par Paul Renard.
- Chronique médiévale.
- La fausse mort du
Vilain de Bailleul (Jean Boedl), par Élisabeth Gaucher.
- Création.
- L'information dans
le jardin, par Claude Daubercies.
- Critique littéraire.
- Échos.
- Reçus.
10 euros (code de commande : 02367).
DARQUENNE (Roger) — Souvenirs de 1939-1945. Chapelle-lez-Herlaimont, Administration Communale et Centre Culturel de Chapelle-lez-Herlaimont, 1996. In-8° (200 x 240 mm.) collé, 127 p., quelques illustrations, exemplaire en très bon état.
Avant-propos :
Rédigées
à l'hiver 1993-94 et à l'intention de mes fils et
petits-enfants, ces pages peuvent prêter à critique :
elles ne sont qu'une vision personnelle, tardive et limitée
dans l'espace. Certes le temps a sans doute généré
des lacunes, des oublis voire peut-être des erreurs dont
la nature même des événements était
déjà porteuse surtout en ce qui concerne les faits
de résistance et de clandestinité. Cependant par
souci d'objectivité cette narration a sans cesse été
passée au crible des documents officiels communaux et privés
en ma possession ou conservés entre autres par Gustave
Dewilde, le secrétaire communal de l'époque. En
outre les lectures et surtout les témoignages croisés
des nombreuses personnes interrogées ont permis de mieux
cerner la vérité, de traquer les omissions ou les
exagérations guidées par les passions toujours vives,
que seule la mort des protagonistes effacera. Afin d'éviter
le rebondissement de polémiques sans cesse prêtes
à resurgir, la personnalisation des faits s'est limitée
à ceux relatés par la presse ou présents
aux archives. Nous effaçons ainsi du récit bien
des noms de collaborateurs, de cotisants en 1941 au parti Rex.
De nombreux résistants n'y figurent pas non plus. Par dignité
certains ont d'ailleurs toujours refusé la publicité
de leurs actes. Néanmoins il m'a paru indispensable de
rappeler par de courtes notices biographiques le souvenir de ceux
qui ont laissé la vie dans ces sombres années tués
ou blessés, civils ou militaires, dans la campagne des
dix-huit jours ; résistants fusillés ou morts
en déportation. Nous y avons ajouté les travailleurs
volontaires décédés en Allemagne et même
un mort dans le camp adverse. En revanche, par manque d'informations,
nous n'avons pas retenu les noms des collaborateurs abattus par
la résistance à la libération ou disparus
sans laisser de traces : si nos souvenirs sont exacts, il
y en eut quatre.
En excluant les morts par diphtérie,
tuberculose ou autres maladies infectieuses issues indirectement
de la guerre, Chapelle a perdu au moins 46 habitants (pour environ
7.700 âmes en 1940) du fait de la dernière (?) guerre.
13 euros (code de commande : 02377).
[DEFUISSEAUX (Alfred)]. DELATTRE (Achille) — Alfred Defuisseaux, un homme, une période. Préface de Léo Collard. [Charleroi], Institut Émile Vandervelde, 1959. In-8° (143 x 186 mm.) broché, 191 p., illustrations hors texte.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- Les étapes du Suffrage Universel
en Belgique.
- Alfred Defuisseaux, sa famille.
- La situation sociale en 1870.
- Le peuple est conciliant mais sans résultat.
- Le Procès d'Hornu et Wasmes.
- La vengeance frappe aussitôt.
- Alfred Defuisseaux se lance dans la bataille.
- Les lieutenants d'Alfred Defuisseaux.
- Le Catéchisme de Defuisseaux.
- L'auteur du Catéchisme du Peuple
est sévèrement condamné. Il passe à
l'étranger.
- La manifestation doit remporter la victoire
Alfred Defuisseaux en exil.
- La Chambre censitaire jette du lest.
- Les agents provocateurs entrent en lice.
- L'action, qui va se développant
sans cesse, fait de plus en plus impression.
- Victoire ! Mais le sang a de nouveau
coulé.
- Alfred Defuisseaux rentre et est incarcéré.
Les élections du 14 octobre 1894.
- Le Grand Complot d'un seul homme.
- La Grande Voix du Peuple se fait entendre
au Parlement.
- Apothéose.
Vendu.
DELATTRE (Achille) — Mes souvenirs. Cuesmes, Impricoop, 1957. In-8° (137 x 210 mm.) collé, 384 p., illustrations, annotations à la page de garde.
Extrait de la préface
:
[...] Un mot maintenant d'explication sur la
composition de mon travail.
Il m'a été impossible de suivre
les événements dans leur ordre absolument chronologique.
Je n'ai pas pu davantage séparer mes activités syndicales
de mon action parlementaire et politique, ma vie militante ayant
dû être menée sur plusieurs fronts qui selon
les circonstances, prenaient tour à tour la première
place mais qui ne furent jamais séparées.
J'ajoute que je ne me suis pas toujours contenté
d'exposer les faits mais que, conformément à la
pratique, je les ai aussi parfois analysés et commentés.
À l'occasion je me suis même placé
dans une situation qui paraîtra peut-être plus ou
moins en marge de mon sujet pour émettre une opinion, un
jugement ou une critique.
Je l'ai fait, après réflexion,
et toujours avec le désir et l'intention de servir la vérité,
et de dégager, de certains événements, les
enseignements qu'ils peuvent déterminer.
Vendu.
DEROUBAIX (Jean) — Le dictionnaire du Hainaut. Préface de Michel Tromont. Mouscron, Imprim'tout, 1989. In-8° (160 x 226 mm.) sous reliure d'éditeur, XVI, 782 p., illustrations, exemplaire en très bon état.
Préface :
En
exergue de la préface de son Dictionnaire géographique,
historique, archéologique, biographique et bibliographique
du Hainaut publié en 1879 chez Manceaux, à Mons,
Théodore Bernier écrivait « pour aimer
son pays, il faut bien le connaître. »
Jean Deroubaix le connaît bien. Il l'aime
bien. Il l'a parcouru dans tous les sens, du levant au couchant,
du septentrion au midi. Il a beaucoup visité les villages,
villes et communes de notre belle province ; il a lu et compulsé
les nombreux écrits historiques locaux. Il donne, sur chaque
localité du Hainaut, un aperçu géographique,
historique, touristique, folklorique, biographique de ses citoyens
les plus célèbres, soit plus de treize cents biographies,
notamment 59 pour la région de Charleroi, 240 pour Mons
et environs, 209 pour le Tournaisis, ... il recense les armoiries
et dresse l'inventaire des monuments et des sites classés.
Le panorama général de la province
de Hainaut ainsi tracé fourmille de précieux renseignements
biographiques relatifs aux comtes de Hainaut, aux préfets
et gouverneurs de Hainaut (période française, hollandaise,
belge), aux évêques du diocèse de Tournai,
aux conseillers provinciaux et aux députés permanents
du Conseil Provincial, aux bourgmestres et échevins, aux
hommes politiques, aux artistes, écrivains et savants,..
L'auteur y a ajouté, pour répondre
aux sensibilités de tout un chacun, des notices sur les
canaux et rivières, les abbayes et des parties du territoire
provincial qui présente aujourd'hui un caractère
particulier : l'ex-Flandre wallonne, le Tournaisis, la Thudinie,
la Campine hennuyère.
L'histoire du diocèse de Tournai et celle
de l'Église protestante en Hainaut fortement présente
dans l'ancien sillon industriel du Hainaut n'ont pas été
négligées.
L'évolution démographique des
arrondissements depuis la proclamation de l'Indépendance
nationale en 1830 y figure aussi de même qu'une liste de
tous les journaux hainuyers édités depuis deux siècles.
Le but de toutes ces investigations, de toutes
ces recherches était de pouvoir concentrer en un seul volume,
un tableau concis, complet mais surtout aussi exact que possible
des richesses que chacun peut découvrir dans les localités
du Hainaut, décrites à partir de la géographie
administrative précédant la loi du 30 décembre
1975, dite des fusions de communes.
L'utilité d'un travail de ce genre paraît
indiscutable puisqu'il a pour finalité de mieux faire connaître
les annales de notre province et vient à son heure, plus
d'un siècle après celui de Théodore Bernier.
De plus, impartial et objectif, il possède
à la fois le caractère d'un instrument de travail
et celui d'un manuel d'éducation civique. Le lecteur va
y trouver les faits saillants d'un passé duquel il est
issu et qui conditionnent son avenir.
Cet ouvrage, élaboré au cours
des douze dernières années, n'a évidemment
pas la prétention d'être exhaustif. Je crois cependant
qu'il est nécessaire sinon indispensable à tout
qui s'intéresse au Hainaut, notre belle province.
Vendu.
[DOUR]. CAMBIER (Charles) — 1830-1980. Les grandes familles douroises 1re Série et l'Indépendance de la Belgique. Dour, Édition Les Amis de Cocars à Dour, 1981. Livre tête-bêche contenant également : Du 19 au 29 septembre 1980, le 5 octobre 1980. Dour en fête 1830-1980. Annales de Cocars n° 1. In-8° (158 x 229 mm.) collé, 48 et 88 p., illustrations.
Table des Grandes
familles :
- Les
De Royer.
- Charles Wolff.
- Les Thon, de Dour.
- Note sur la famille des Cambier.
- Les XXV - Un chef - Antoine Prévôt.
Table de Dour en fête :
- 1830-1930. Comité de haut
patronage du 150e anniversaire.
- Comité exécutif du 150e
anniversaire.
- 150e anniversaire. Dour en fête
- Pourquoi ?
- Un hommage aux volontaires de l'indépendance
nationale de 1830.
- Louis-Joseph Cambier, commandant des
volontaires.
- 1830... Les volontaires de Dour.
- Élouges retrouve des combats de
boxe.
- Reims-Dour. Les cyclotouristes en vedette.
- Le coin des commerçants de Dour.
- Le sigle du 150e anniversaire dessiné
par un artiste local à Dour.
- Dour en fièvre, Dour en fête.
- Description des festivités.
Vendu.
FRÉRON (Élie Catherine) — Les confessions de Fréron (1719-1776). Sa vie, souvenirs intimes et anecdotiques, ses pensées. Recueillis et annotés par Charles Barthélemy. Paris, Charpentier, 1876. [G. Charpentier, Éditeur / 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 / 1876 / Tous droits réservés] In-8° (120 x 187 mm.) broché, XVI, 375, [1 bl.], 4 (catalogue de l'éditeur) p., un portrait en frontispice, rousseurs.
Extrait de la préface
:
Le
dix-huitième siècle est peut-être l'époque
la plus curieuse, la plus intéressante, la plus utile,
et – j'ose le dire, – la plus indispensable
à connaître ; et, cependant, c'est assurément
celle dont nous savons le moins l'histoire.
Quoique l'objet de nombreuses et même
minutieuses recherches, le dix-huitième siècle est
encore, à l'heure qu'il est, peu et mal connu ; les
investigations auxquelles il a jusqu'ici donné lieu n'ont
guère été commencées qu'avec notre
siècle, à la suite d'une terrible révolution,
par des hommes qui y avaient joué un rôle, et qui,
voulant s'excuser ou se disculper, ont fait de 1789 et de 1793
une conséquence nécessaire, fatale même, du
règne de Louis XV.
La Révolution française ayant
absorbé toute l'attention des écrivains, – soit
historiens, soit publicistes, – cette attention s'est
concentrée sur les faits et la philosophie, et on a oublié
de demander à la littérature, qui est la véritable
expression d'une société et d'une époque,
le mot et l'explication vraie de ce qui est encore une énigme
à l'heure qu'il est, et cesse pourtant de l'être
quand on a lu Fréron et quelques autres hommes qui, plongeant
pour ainsi dire dans la postérité, ont voulu l'éclairer
par le compte rendu, l'inventaire, le pourquoi des écrits
publiés de leur temps, pour et contre la vérité
religieuse, morale, historique, politique et littéraire.
Un siècle tel que celui qui produisit
Voltaire et Rousseau n'est certes pas une époque ordinaire ;
mais, en regard et pour rétablir l'équilibre, il
faut mettre Fréron, Guénée, Bergier, les
apologistes catholiques, et aussi les martyrs de la vérité
et du droit éternel et imprescriptible. Ce parallèle
fait du siècle dernier une époque du monde,
– pour nous servir de la parole si caractéristique
du grand Joseph de Maistre.
Ce qui explique la passion d'études sur
le dix-huitième siècle qui anime les libres penseurs
du dix-neuvième, c'est le besoin qu'ils éprouvent
de continuer la tradition de l'erreur, du mensonge et du sophisme,
qui leur est si chère ; mais les catholiques, eux,
ne connaissent rien de ce passé, qu'ils ont jusqu'ici trop
négligé d'étudier ; et cependant nous
sommes les fils du dix-huitième siècle autant que
ceux du Moyen Âge.
Or, nous ne possédons si bien le sens
intime du Moyen Âge, que parce que, – non contents
d'étudier son histoire, – nous avons pénétré
dans les secrets et jusqu'aux entrailles mêmes de ses institutions,
de son art, de sa littérature et de sa science.
Il y aurait à faire, – sur
la manière dont on doit étudier le dix-huitième
siècle, – ce qu'un érudit de notre temps
a pratiqué avec tant de sagacité pour le Moyen Âge.
À défaut d'hommes comme les Guérard, les
Paulin Paris et tant d'autres investigateurs de nos antiquités,
nous avons, pour le siècle dernier, mieux encore, les contemporains
mêmes, Fréron en tête, – pour ne
parler que des critiques. Au lieu de procéder, comme pour
les époques lointaines, par voie d'induction, il nous est
ici donné de marcher de certitude en certitude, d'affirmation
en affirmation.
Cependant, malgré tant de moyens et de
sources d'informations, nous ne connaissons pas la littérature
du dix-huitième siècle ; à peine quelques
noms, et de ces quelques noms peu d'œuvres sont du domaine
des études modernes des catholiques. En somme, on a plus
lu les Lettres persanes que l'Esprit des lois, les
tragédies de Voltaire que sa correspondance, etc., etc.,
etc.
Dans cette époque si remplie, Fréron
est un cicerone instruit ; il en sait à fond l'histoire,
et il en parle à merveille la langue, dont aucun secret
ne lui est étranger : il ne dit que ce qu'il a vu ;
ses modèles, il les a pratiqués et connus, en quelque
sorte, en déshabillé.
Du dix-huitième siècle, Voltaire
n'a fait que la caricature, que l'on prend cependant pour le portrait ;
or, la caricature peut, tout au plus, servir de moyen de contrôle
et encore avec combien de prudence !
Fréron, lui, a peint le portrait ;
s'il exagère quelquefois, ce n'est que pour mieux accentuer
la physionomie et lui donner un relief qui la mette en pleine
lumière.
C'est dans cette galerie de types que nous voulons
introduire les gens de goût et de sens.
Il est aussi injuste de ne voir que Voltaire,
Rousseau, les encyclopédistes, et même Crébillon
fils en tête du siècle dernier, sans tenir compte
des Fréron, des Guénée, des Bergier, etc.,
que de s'obstiner à placer uniquement au seuil de ce temps-ci
Parny et Pigault-Lebrun, en ayant l'air d'oublier Joseph de Maistre,
de Bonald et Chateaubriand.
15 euros (code de commande : 02373).
GODENNE (Léopold) — Les processions, cortèges, cavalcades de Malines. L'Ommegang et l'histoire de Op Signorke. Bruxelles, Willy Godenne, 1938. In-8° (136 x 215 mm.) agrafé, 46 p., illustrations, exemplaire en bon état.
Extrait :
Dès
les premières années de l'institution de la procession,
dite de la paix (Peys-processie), en souvenir de la victoire
remportée par les Malinois sur l'ennemi, en 1302, il y
avait dans le cortège, des ménestrels chargés
de chanter les louanges de saint Rumold, en s'accompagnant d'instruments
à cordes. Une cinquantaine d'années après,
on introduisit d'autres groupes, dont la variété
et le nombre allèrent toujours croissant.
Les comptes de la Ville, de 1375 à 1387,
mentionnent les dépenses faites annuellement pour la représentation
des Apôtres et des Prophètes. Plus
tard, on figura d'autres personnages de l'histoire biblique, et
en 1401 apparaissent les premiers chars sur lesquels on représentait
différents épisodes de l'histoire sacrée.
Le nommé Jean de Visscher et son compagnon Jean van Battele
reçoivent, en 1406, quatre escalins de gros pour avoir
bien représenté la Passion, et ils sont engagés
pour les années suivantes, à la condition d'améliorer
toujours leur représentation, autant que faire se pourrait.
Vendu.
GOOVAERTS (S.) — Un village inconnu. Waudrez l'ancien Vodgoriacum des Romains. Bruille. Sa seigneurie, ses seigneurs. Binche, Librairie de la Bibliothèque Choisie, 1933. In-8° (144 x 223 mm.) broché, 342 p., illustrations hors texte, une carte à déplier, exemplaire non coupé.
Table des matières
:
Avant-propos.
Première partie : Histoire du village
de Waudrez.
Chapitre préliminaire.
Topographie -
Cours d'eau - Superficie - Population - Noms, etc.
Chapitre I : Waudrez avant
et pendant la période romaine (57 avant J.-C. - 406 après
J.-C.).
Origine
- Préhistoire - Première mention - La Carte de Peutinger
- L'Itinéraire d'Antonin - Étymologie du nom - Situation
- Importance - Les chaussées romaines - La grande chaussée
de Bavai à Cologne - Le camp de Cicéron était-il
à Vodgoriacum ? - Bavai, principal point de concentration
des légions romaines - Vodgoriacum, à 12 milles
de Bavai - Vodgoriacum, village romain - Description d'une villa
- Vestiges de villae belgo-romaines dans les environs - Antiquités
trouvées à Waudrez - Une industrie locale : la céramique
? - Vodgoriacum était un gros bourg - Fut-il fortifié
? - Fin de la domination romaine - Destruction de Bavai et de
Vodgoriacum.
Chapitre II : Waudrez pendant
la période franque (406 - 873).
La Forêt
Charbonnière - C'est le Hainaut - Son étendue -
Waudrez est un village de la Charbonnière - D'où
vient ce nom ? Population de la Charbonnière - Repeuplement
de la Nervie par les empereurs romains - Les habitants de Vodgoriacum
à l'époque franque - Sa situation sur le chemin
des invasions l'expose aux dévastations des envahisseurs
- 388, Les Francs de la Germanie - 406, Les Vandales, Alains,
Suives, etc. - 432, Clodion et les Francs - Destruction de Vodgoriacum
- Qui étaient les Francs ? - Fondation du royaume des Francs
en Belgique - 455, Attila et les Goths - Nouvelle dévastation
- Deux siècles de paix -Vodgoriacum prospère - VIIe
siècle, Walderiego appartient à l'Austrasie sous
le gouvernement de Pépin de Landen - 698, Pépin
de Herstal - 715, Rainfroid. Dévastation - 717, Charles-Martel
- Charlemagne - Passe par Walderiego en 771 - Confirme la donation
de Pépin ; l'église de Walderiego appartient à
Chèvremont - Novum-Castellum - Les revenus de Walderiego
servent à l'entretien des 12 prêtres desservant l'église
Sainte-Marie de Chèvremont - Détails historiques
sur cette localité - 844, Confirmation par Louis le Pieux
et Lothaire - Walderiego dans le domaine de Charles le Chauve
- Charles à Leptines - Chasses des rois francs dans la
Charbonnière - Audriaca villa.
Chapitre III : Waudrez
sous les ducs de Lotharingie, les premiers comtes de Hainaut et
les empereurs d'Allemagne (873 - 1120).
Divisions
territoriales - Pagis vicairies, décuries, manses - La
vicairie de Waudrez ou de Lobbes - Les villages qui la composent
- Position - Les comtes qui la gouvernèrent - Saint Hidulphe
- Sigehard - Amulric - Richer - Garnier et Renaud - Godefroid
et Arnould - Herman de Verdun - Waudrez devient possession de
l'abbaye de Lobbes - Le polyptyque de Lobbes - Waldreia - Quelques
héritages à Waudrez ont-ils appartenu à Lobbes
dès la fondation ? - Les diplômes de Pépin
de Herstal, 691 et 697 - 885, Lobbes et tous ses biens sont donnés
à l'évêque de Liège - Situation favorable
des habitants de Waudrez aux IXe, Xe et XIe siècles - 880,
Dévastations des Normands - 905, Le manse Hamor - 955,
Invasion des Hongrois - 957, Misère, famine, rareté
de l'argent - 973, Othon II confirme à Notger la possession
de Lobbes et de ses biens à Waudrez - 980, Autre diplôme
du même - 1006, Diplôme de l'empereur Henri II - 1101,
Diplôme de l'empereur Henri III - Graves difficultés
financières de l'abbaye de Lobbes - Elle se dessaisit de
Waudrez.
Chapitre IV : Waudrez sous
les comtes de Hainaut (XIIe au XVe siècle).
Organisation
féodale ; alleu, fief, hérédité des
fiefs, relief, hommes de fiefs - Bauduin IV bâtit la forteresse
de Binche - Binche et Ëpinois, dépendances de Waudrez
- L'alleu de Waudrez - Physionomie du village à la fin
du XIIe siècle au point de vue féodal - Bruille,
centre de l'alleu de Binche - Charte de l'alleu de Binche du XIIe
siècle - Confirmation de cette charte par Charles-Quint
- Le châtelain Obert de Waudrez - Droits du comte de Hainaut
dans l'alleu - Le maïeur et la mairie de Bruille - Les échevins
de l'alleu - Les sergents et les forestiers - Droits et privilèges
des habitants - Amendes et répression des délits
- La prison de Waudrez - Le tourier ou geôlier de Waudrez
- La seigneurie foncière de Bonne-Espérance à
Bruille - Autres fiefs et rentes à Waudrez et Bruille.
Chapitre V : Waudrez pendant
les guerres du Moyen Âge, les troubles du XVIe siècle
et les Temps Modernes.
Guerres,
pillages, dévastations, réquisitions, contributions
de guerre, etc.
Chapitre VI : Waudrez ecclésiastique.
Religion
des Nerviens - Premières semences du christianisme - Superior,
évêque des Nerviens - Disparition du christianisme
- Le paganisme des Francs - Persistance jusqu'au VIIIe siècle
des pratiques païennes - 743, Concile de Leptines - Walderiego,
au point de vue religieux, au VIIIe siècle - La première
église de Waudrez - L'ecclesia, l'altare, la dîme
- Double juridiction à Waudrez - Bancroix - Le Chapitre
de Sainte-Waudru et celui de Cambrai, patrons de l'église
- Organisation du diocèse de Cambrai - Waudrez, siège
du décanat - Le curé de Waudrez et la dîme
de Battignies - Charte de Burchard, évêque de Cambrai
en 1120 - Autre charte du même en 1124 - Le décanat
de Binche - Deux bulles papales confirment la possession de l'autel
de Waudrez au Chapitre de Cambrai - Dîme du Chapitre de
Cambrai à Waudrez - Dîme du Chapitre de Sainte-Waudru
- Revenus de la cure.
Chapitre VII.
L'Église
de Waudrez - La Chapelle de Saint-Nicolas à Bruille - La
Chapelle de l'abbaye de Bonne-Espérance à Bruille
- La Chapelle de Notre-Dame de Walcourt à Waudrez - La
Chapelle de Notre-Dame de Haï à Waudrez - Les Curés
de Waudrez.
Deuxième partie : Bruille, sa seigneurie,
ses seigneurs.
Chapitre VIII : La seigneurie
de Bruille.
Étymologie
- Le hameau de Bruille - Autres « Bruille » - Liste
des seigneurs - La seigneurie - Le château et autres bâtiments
- Étendue du domaine ou Enclos de Bruille - Les étangs
- Étendue de la seigneurie. Droits du seigneur de Bruille
- Noms de la seigneurie. Érection en comté - Valeur
du fief de Bruille.
Les seigneurs de Bruille.
Chapitre IX.
Les «
de Bruille » - Les « de Beauffort.
Chapitre X.
Les «
de Sars ».
Chapitre XI.
Les «
de Wignacourt » - Les « de Wasservas » - Les
« de Roly » - Les « de Massiet ».
Chapitre XII.
Les «
de Croix de Drumez, comtes de Clerfayt ».
Chapitre XIII.
Les propriétaires
du domaine de Bruille après la Révolution française
- Les « de Spangen » - Les « de Coppens »
- Les « de Robiano » - Le baron de Senzeille - Le
marquis de Beauffort - Le comte de Looz-Corswarem (locataire)
- Les Pères des Sacrés-Cœurs.
Pièces justificatives - Glossaire des
mots de l'ancien français employés dans l'ouvrage
- Bibliographie.
Exemplaire sur papier
blanc : 30 euros (code de commande : 02389a).
Exemplaire sur papier fort (sujet aux rousseurs) : 25 euros (code
de commande : 02389b).
GUBBELS (Robert) — La grève, phénomène de civilisation. Études d'économie sociale. Bruxelles, Université Libre de Bruxelles - Institut de Sociologie, 1962. In-8° (154 x 239 mm.) broché, 334 p., planches à déplier.
En quatrième
de couverture :
La grève est un acte par lequel un groupe social manifeste
à la fois sa solidarité interne et sa désolidarisation
par rapport au reste de la société ; cette manifestation
se traduit généralement, mais pas nécessairement,
par un arrêt concerté du travail ; le groupe social
y recourt afin d'exprimer une volonté, un mécontentement
ou une opinion, dans le cas où il ne trouve plus d'autre
moyen pour influencer les décisions à prendre en
cette matière ».
Telle est la définition de la grève
à laquelle aboutit l'auteur au terme d'une étude
qui est sans doute la plus complète qui ait été
effectuée en Belgique à propos de cette question.
On notera tout spécialement l'étude
statistique, basée sur des sources absolument originales
et qui fait apparaître le problème sous un jour tout
nouveau.
Les aspects juridiques sont traités également
au cours d'un chapitre où sont abordés successivement
les mécanismes de conciliation et d'arbitrage, la législation
d'intérêt public, le maintien de l'ordre et les conséquences
de la grève sur le contrat de travail, les prestations
du régime de sécurité sociale, etc.
L'ouvrage expose également les résultats
d'une enquête sociologique qui a comporté quelque
trois cents interviews de leaders patronaux et ouvriers.
13 euros (code de commande : 02365).
HAID (Johann Jakob) — Rhetorica
- Die Redekunst.
Manière
noire de Johann Jakob Haid (1704-1767) d'après une œuvre
du peintre allemand Johann Rottenhammer (Munich 1564-1625).
Dimensions :
- Image : 282 x 407 mm.
- Feuille : 352 x 478 mm.
150 euros (code de commande : 02393).
[HISTOIRE - REVUE]. Annales. Économies - Sociétés - Civilisations. 27e année - N° 6 - Novembre-Décembre 1972. Paris, Armand Colin, 1972. In-8° (180 x 240 mm.) broché, [290 (pp. 1235-1525)], XLIV p., illustrations in et hors texte, exemplaire en bon état.
Sommaire :
- Inter-sciences
- Le Potosi et la
physique nucléaire, par Adon et Jeanne Gordus,
Emmanuel Le Roy Ladurie et Denis Richet, p. 1235.
- Outillage.
- La Typologie des
sources du Moyen Âge occidental, par Léopold
Genicot, p. 1257.
- Frontières nouvelles.
- Les origines des
règles de l'art : Une première enquête,
par Gilbert Ouy et Krystyna Ouy-Parczewska, p. 1264.
- Débats et combats.
- Une épistémologie
de transition : Paul Veyne, par Michel de Certeau,
p. 1317.
- Famille et société.
- Le célibat
à la fin du Moyen Âge : les religieuses de Florence,
par Richard C. Trexler, p.1329.
- Mariage tardif et
vie sexuelle : discussions et hypothèses de recherche,
par Jean-Louis Flandrin, p. 1351.
- La position puritaine
à l’égard de l’adultère, par
Robert V. Schnucker, p. 1379.
- Notes critiques.
- Démographie et
mentalités : la mort en Anjou (XVIIe-XVIIIe siècles),
par Jean Delumeau, p. 1389.
- Variations dans
le marxisme, par Pierre Souyri, p. 1400.
- Marxismes et marxistes
(comptes rendus, par Robert Paris et Pierre Souyri),
p. 1423.
- Les domaines de l'Histoire.
- La « bonne
» ville : origine et sens de l'expression, par Gérard
Mauduech, p. 1441.
- Économie
et société rurale en Angleterre au XVe siècle
d'après les comptes de l'Hôpital d’Ewelme,
par Jean-Philippe Genet, p. 1449.
- Archéologie
de la fabrique : la diffusion des moulins à soie «
alla bolognese » dans les États vénitiens,
du XVe au XVIIIe siècle, par Carlo Poni, p.
1475.
- Commerce et décolonisation.
L’expérience franco-haïtienne au XIXe siècle,
par Benoît Joachim, p. 1497.
- Livres reçus, p. I.
- Index des publications recensées,
p. IX.
- Table des matières de l'année
1972, p. XVII.
- Publicités, p. XXII.
12 euros (code de commande : 02361).
[KUPKA
(Frantisek)]. Frantisek Kupka. La collection du Centre Georges
Pompidou, Musée national d'art moderne. Paris, Éditions du Centre Pompidou,
2003. In-4° (220 x 280 mm.) broché sous couverture
à rabats, 235 p., très nombreuses illustrations
en noir et en couleurs, exemplaire en bon état.
Ouvrage publié
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée
au Kunstmuseum Liechtenstein, à Vaduz, du 28 mars au 9
juin 2003 ; à la Fondation de l'Hermitage, à
Lausanne, du 26 juin au 12 octobre 2003 ; au Musée
d'art moderne et contemporain, à Strasbourg, du 7 novembre
2003 au 8 février 2004 ; au Musée Fabre, à
Montpellier, du 1er mars au 30 mai 2004 et au Westfälisches
Landsmuseum, à Münster, durant l'été
2004.
En quatrième de
couverture :
Cet
ouvrage constitue le premier catalogue complet et analytique des
œuvres de Frantisek Kupka conservées dans la collection
du Centre Georges Pompidou. Riche de cent soixante-six œuvres
– soixante et onze peintures, quinze pastels et quatre-vingts
dessins, gouaches et gravures –, largement issu de la
donation faite en 1963 par la veuve de l'artiste, Eugénie
Kupka, cet ensemble est le seul au monde à offrir, par
son ampleur et sa diversité, une vision exhaustive de la
production changeante et complexe de Kupka. Pour la période
abstraite, qui a fait la renommée de l'artiste tchèque,
son intérêt est même exceptionnel, car il compte
les séries capitales des Plans par couleurs (1909-1911),
des Ordonnance sur verticales (1911-1913) et des Plans
verticaux (1912-1913), considérés par Alfred
H. Barr comme « les premières abstractions géométriques
pures de l'art moderne ». L'autre orientation majeure
de la peinture abstraite de Kupka, fondée sur les « formes
circulaires », entreprises parallèlement dès
1912, est somptueusement représentée par l'un des
chefs-d'œuvre de la collection, le monumental panneau Autour
d'un point, dont la réalisation, poursuivie pendant
dix ans (1920-1930), témoigne d'un processus spécifique
de reprises régulières du canevas original, révélateur
d'un travail issu à la fois d'un profond mûrissement
intellectuel et d'une inquiétude spirituelle qui font l'originalité
et la grandeur de l'œuvre de Kupka.
Avec une biographie illustrée de documents
parfois inédits et des textes de spécialistes confrontant
l'œuvre picturale aux écrits de Kupka, le catalogue
fait le point sur les derniers apports de la recherche. Ils éclairent
d'un jour nouveau la création et la personnalité
d'un artiste hanté par « le trouble moderne »,
qui constituait pour André Breton la marque de notre temps.
Table des matières :
- Avant-propos, par Bruno Racine.
- Préface, par Alfred Pacquement.
- Kupka, « le rebelle, l'en
dehors », par Brigitte Leal.
- « Endossons donc le maillot
des couleurs vives ». L'art de la couleur chez Frantisek
Kupka, par Pierre Brullé.
- Sur la réception de l'œuvre
de Frantisek Kupka, par Friedemann Malsch.
- Les écrits de Kupka, manifestation
d'une pensée conceptuelle des formes et des destins de
l'art, par Pierre Brullé.
- Catalogue des œuvres.
- Biographie.
- Bibliographie.
- Liste des expositions.
- Liste des documents exposés.
20 euros (code de commande : 02396).
[LASSUS (Roland de)]. DELMOTTE (Henri-Florent) — Notice biographique sur Roland Delattre, connu sous le nom d'Orland de Lassus, par H. Delmotte, membre correspondant de l'Académie de Bruxelles, etc. [Valenciennes], Prignet, [1836]. [Imprimerie de A. Prignet.] In-8° (160 x 248 mm.) broché, [1 (faux-titre], [1 bl.], [1 (titre-frontispice dessiné par A. Wacquez)], [1 bl.], 176 p., un portrait en frontispice, une planche hors texte (tombeau de Roland de Lassus) et un double tableau généalogique à déplier, rousseurs parfois importantes.
L'érudit
montois Henri Delmotte (fondateur de la Société
des Bibliophiles belges séant à Mons) mourut le
7 mars 1836, l'année de la publication de l'ouvrage présenté
ici et qui comporte plusieurs parties :
- Un avertissement dans lequel Delmotte
met en évidence la médiocrité des éditeurs
et des autorités culturelles belges et justifie la publication
de son ouvrage chez un éditeur valenciennois (pp. 1-8).
- Notice sur Roland Delattre (pp. 9-80).
- Bibliographie de Roland de Lassus (pp.
81-158).
- Pièces justificatives (pp. 159-168).
- Notice biographique sur Henri-Florent
Delmotte (pp. 169-174).
- Bibliographie de Henri Delmotte (pp.
175-176).
Vendu.
LEUVEN (Adolphe de), FORGES (Philippe-Auguste Pittaud de) et DUMANOIR (Philippe) — Sophie Arnould. Comédie en trois actes mêlée de couplets, par MM. Ad De Leuven, De Forges et Ph. Dumanoir ; représentée, pour la première fois, sur le théâtre du Palais-comédienne et cantatrice Sophie Arnould (Paris, 1740Royal, le 11 avril 1833. Bruxelles, Lelong, 1833. [A Bruxelles. / J.-A. Lelong, Libraire-Éditeur, / rue des Pierres, n° 43. / 1833.] In-12 (93 x 140 mm.) broché, 71, [1 bl.] p., (collection « Nouveau Répertoire Dramatique de la Scène Française », 4e série - 1re livraison), bon exemplaire malgré un petit manque au dos et une déchirure, sans perte, au second feuillet de couverture.
La contrefaçon du théâtre
français en Belgique fut une entreprise particulièrement
prospère et François Godefroid indique qu'elle « connaîtra
son apogée avec la publication du Nouveau Répertoire
dramatique de la Scène française publié
par J.-A. Lelong, de 1832 à 1854, sans le consentement
des auteurs. »
La cantatrice et comédienne Sophie Arnould
(Paris, 1757-1802) connut une carrière remplie de succès
et son esprit acéré – qui inspira les
frères Goncourt – lui valut une grande notoriété.
Sa vie privée fut particulièrement bien remplie
et elle inspira plusieurs œuvres dont celle présentée
ici, un opéra-comique et un personnage dans la pièce
de Sacha Guitry, Chagrin d'amour.
Bibliographie :
- Godfroid (François), Aspects
inconnus et méconnus de la contrefaçon en Belgique,
pp. 31-54.
- Marchand (Sophie), « Mademoiselle
Clairon et Sophie Arnould vues par les Goncourt ou le théâtre
intime des actrices du XVIIIe siècle », dans
Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 2006, 13, pp. 23-35.
15 euros (code de commande : 03281).
MASSON (Georges-Armand) — Soliveau ou le parfait parlementaire. Suivi d'un Essai sur le style parlementaire et d'une Anthologie à l'usage de Soliveau. Sixième édition. Paris, Éditions du Siècle, 1923. In-8° (121 x 187 mm.) broché, 121 p., (collection « Manuels pour Adultes », n° 1), couverture fragile.
En quatrième
de couverture, à propos de la collection :
Instruire
en amusant, railler en les caricaturant les défauts et
les ridicules de ce temps, c'est en somme ce qu'ont souhaité
les Éditions du Siècle en créant cette collection
dont la série complète constituera un véritable
tableau des mœurs actuelles. Les œuvres qui la composent
sont dues à des écrivains dont le talent est reconnu
d'un chacun. On y voudra voir un gage de la haute tenue littéraire
de nos « Manuels », en même temps
qu'une justification de leur ton. La hardiesse dans la critique,
la vivacité dans la raillerie, de vrais écrivains
se le peuvent per­mettre quand ils pratiquent ce genre que
le XVIIe siècle appelait la satire.
Nous avons l'assurance que, élégamment
présentées, et à bon marché, spirituelles,
courageuses et documentées, ces études de mœurs
ou de caractères feront la joie et l'édification
du grand public à qui elles s'adressent.
Les masques de la couverture sont dessinés
par Robert Lemercier.
Les ouvrages de cette collection paraîtront
à raison d'un par mois et au prix de 3 francs le volume.
On peut souscrire dès maintenant pour six volumes, à
partir du n° 2, au prix de faveur de 15 francs (franco). Les
souscripteurs recevront l'édition originale.
Table des matières :
- Avant-propos.
I. Introduction à la vie parlementaire.
II. Physique des élections.
III. Les premiers pas.
IV. Quelques notions de parlementologie.
V. Quelques précisions sur l'idiosyncrasie
de Soliveau.
VI. Ascension de Soliveau.
VII. L'art d'être ministre.
VIII. M. Soliveau à l'œuvre.
IX. M. Soliveau, président de la République.
X. Essai sur le style politique.
XI. Petite anthologie à l'usage de M.
Soliveau.
6 euros (code de commande : 02374).
MERCIER
(Louis-Sébastien) — Les Tombeaux de Vérone.
Drame en cinq actes. Par
M. Mercier. Neuchâtel,
Société Typographique, 1782. [A Neuchatel, / De l'Imprimerie de la Société
Typographique. / 1782.] In-8°
(143 x 215 mm.) sous son brochage d'attente de l'époque,
[4 (titre, catalogue de l'éditeur, avertissement, personnages)],
140 p.
Exemplaire à
toutes marges de cette rare édition originale.
Avertissement :
Ce
sujet touchant a été traité plusieurs fois ;
mais il semble appartenir spécialement à l'auteur,
parce qu'il porte, plus qu'aucun autre, le vrai caractère
du drame ; genre auquel il s'est livré de préférence.
Il vouloit d'abord mettre sur la scene le Roméo &
Juliette, de Shakespeare ; mais bientôt il s'est
apperçu qu'il falloit laisser à ce grand poëte
ses dimensions & son originalité ; que vouloir
le corriger, c'étoit l'anéantir.
M. Ducis, de l'académie françoise,
en a fait une tragédie, dans laquelle il a plutôt
peint la vengeance de Montaigu que les amours de Roméo
& Juliette. D'ailleurs, sa pièce imprime à ses
personnages une physionomie étrangere. L'auteur de ce drame
s'est attaché, au contraire, à tout ce que Roméo
& Juliette lui offroient d'intéressant. Il a choisi
des couleurs plus douces, & a donné à Benvoglio
un caractere jusqu'ici inconnu sur la scene. D'après son
plan, un nouveau dénouement devenoit nécessaire :
il croit en avoir imaginé un du plus grand effet, &
qui doit offrir au spectateur un tableau neuf, frappant &
vraiment théatral.
À propos de l'imitation de Roméo et Juliette
par Louis-Sébastien Mercier, Bernard Franco écrit
:
La seule imitation vraiment importante,
dans le domaine français, est la pièce de Mercier
Les Tombeaux de Vérone, publiée en 1782,
qui reprend largement celle de Weiße. Mercier, qui avait
été également inspiré par un Roméo
et Juliette anonyme, publié en 1771, et qui se réclame
lui-même de la pièce de Weiße, retient de cette
dernière non seulement le ton, celui d’un drame bourgeois
– et, chez lui, philosophique –, mais aussi
la réinterprétation du personnage du frère
Laurent, transformé en un médecin naturaliste appelé
Benvoglio. Mercier lui accorde même la place principale,
achevant l’acte II sur un long dialogue entre Benvoglio et
Juliette, faisant terminer le suivant par la visite du médecin.
Le dénouement est le fait du sage, qui triomphe à
la fois de la mort de Roméo et de Juliette et de la haine
des deux familles, se substituant sur ce dernier point au Prince
lui-même. Mercier fait de son personnage le porte-parole
d’idées rousseauistes et d’une célébration
des valeurs de la franc-maçonnerie, par exemple lorsque
son personnage, à l’acte III, scène 6, demande
aux amants de le rejoindre « dans les bras de la liberté,
de l’amitié, de l’amour ».
Bibliographie :
- Gury (Jacques), « Les tombeaux de Vérone de L.-S. Mercier
ou Roméo et Juliette aux Lumières de l'Orient, », dans Dix-Huitième
Siècle, n° 7 - 1975, pp. 289-300.
- Franco (Bernard), « Roméo
et Juliette : traductions, adaptations, réceptions au tournant
du XVIIIe au XIXe siècle », dans Shakespeare
vu d'Allemagne et de France des Lumières au romantisme,
n° 5, 2007 de la Revue germanique internationale, pp.
203-221.
- Conlon (Pierre M.), Le siècle
des Lumières : Bibliographie chronologique, Volume
20, p. 171, 82 : 1480.
90 euros (code de commande : 02386).
[MONS - LUMEÇON]. LEFEBVRE
(Gabriel) — Sérigraphie
tirée à 200 exemplaires numérotés
et signés par l'artiste ; elle a été
imprimée par Yves Amateis, elle a nécessité
9 passages de couleurs.
Dimensions :
- Dessin : 595 x 395 mm.
- Feuille : 800 x 600 mm.
N'hésitez pas à demander la personnalisation de votre exemplaire avec une dédicace de Gabriel Lefebvre.
150 euros (code de commande : 02388).
[PATOIS DE LA RÉGION DU CENTRE - REVUE]. El Mouchon d'aunia qui chufèle in coûp par mwas. Revue mensuelle. 69e année - 1981. La Louvière, Lès Scriveûs du Cente, 1981. Année complète en douze numéros in-8° (156 x 240 mm.) agrafés, 240 p. (pagination continue pour les douze numéros), en très bon état.
Notice du site Revues.be
:
Créé
en 1912, Le Mouchon d'Aunia est publié depuis 1946 par
le cercle littéraire Lès Scriveûs du Cente.
Le mouchon d'aunia est un tarin des aulnes.
Dans l'acte de naissance de la revue, il est précisé
que c'est un petit oiseau venu de France et qui symbolise notre
sympathie envers la grande sœur. Depuis Waterloo, la francophilie
est restée intense chez nous, mais nous noterons la nuance
: la France est considérée comme une grande sœur,
pas comme une mère. Dans l'esprit des fondateurs, l'identité
wallonne ne saurait, en aucun cas, être inféodée
à un sentiment rattachiste.
Un mouchon représente la liberté,
l'envol de l'imagination vers les contrées les plus diverses
de l'inspiration et nous oserons aujourd'hui le chauvinisme d'affirmer
que, un peu mieux pistonné, notre Mouchon aurait pu, à
la place du coq, devenir l'emblème de la Wallonie.
Au départ et durant plusieurs décennies,
les auteurs du Mouchon d'Aunia s'inspirent de la nature, de la
vie du terroir qu'ils traitent, tantôt avec humour et fantaisie
quand il s'agit des avatars du quotidien, tantôt avec gravité
lorsqu'il est question du labeur des ouvriers mais surtout des
mineurs, des malheurs familiaux qui en découlent, quitte,
trop souvent à nos yeux, à verser dans le mélo,
mais c'est un genre très prisé jusqu'avant la guerre
1940-45. Les distractions étant rares, les auteurs se montrent
éclectiques. Ils sont nombreux à écrire à
la fois poésie, prose, chansons, blagues, mais aussi à
se produire comme comédiens, metteurs en scène ou
chansonniers. Si l'esprit est espiègle et frondeur, la
politique est cependant rigoureusement exclue de la production
littéraire et un avertissement le précise dans la
revue : Nos n' fèsons pont d' politique. De même,
les sujets grivois ne seront qu'esquissés car, rappelons-le,
l'objectif est de se montrer crédible. L'audace est interdite,
il faut respecter les bonnes manières. Cette attitude complexée,
à de rares exceptions près, a disparu de nos jours
et les auteurs actuels, adaptant à leur époque les
idéaux de Flori, n'hésitent plus à affronter
l'actualité dans le blanc des yeux, bannissant toujours
la vulgarité tout en osant la hardiesse que réprouvaient
leurs aînés.
Bibliographie :
- « Èl mouchon d'aunia »,
dans Revues.be.
Revues littéraires et artistiques en langues française
et endogène.
Vendu.
[PLISNIER (Charles)]. Écriture et engagement, actualité de Charles Plisnier. Actes du colloque organisé à Mons les 24 et 25 janvier 1997. Mons, Centre Interdisciplinaire d'Études Philosophiques de l'Université de Mons-Hainaut, 1998. In-8° (160 x 225 mm.) broché, 260 p., (collection « Cahiers Internationaux de Symbolisme », n° 89-90-91), exemplaire en parfait état.
Table des matières
:
- Allocutions
d'ouverture du colloque, par Albert Landercy, Henry
Ingberg et Christophe Taquin.
- Introduction, par Charles Bertin.
- Les paradoxes de l'engagement,
par Paul Aron.
- Éthique et engagement dans
Faux Passeports, par Marcel Voisin.
- Un démographe historien à
la rencontre de Charles Plisnier, par Jean-Paul Bougard.
- La foudre en ce labyrinthe, par
Jean-Louis Lippert.
- Albert Camus, journaliste professionnel
et franc-tireur, par Paul-F. Smets.
- « La France, rien que cela et
tout cela ». Charles Plisnier, collaborateur « français
» des Nouvelles Littéraires, par Paul Dirkx.
- Un regard culturel et théâtral
sur la question nationale belge, par Jean Louvet.
- « Il m'agace, ce type »,
par Geert van Istendael.
- Les premiers pas de la citoyenneté
poétique, par Claire Lejeune.
- Un poème, c’est toujours
quelqu'un, par Paul Chamberland.
- « Le poète dans la Cité
», par Jacques De Decker.
- Charles Plisnier et la tentation du
surréalisme, par Carl Norac.
- Le poétique et le politique
chez Benjamin Péret, par Léonor L. de Abreu.
- Les poètes contre l’Histoire,
par Michel Gheude.
- Dégager l'engagement, par
Eric Clemens.
- Engagez-vous, qu'ils disaient !,
par Gérard Adam.
- Un témoignage poétique.
- En guise de postface, par Marcel
Voisin.
- La pensée d'Unamuno : du lyrisme
au tragique, par Véronique Dortu.
- Imagination et Imaginaire. Hommage
à Cornélius Castoriadis, par Jérôme
Jamin.
- Ont collaboré à ce volume.
- À propos de...
12 euros (code de commande : 02359).
POPELIER (Jean-Pierre) — Belges et Français du Nord. Une histoire partagée. Lille, La Voix du Nord Éditions, 2009. In-8° (151 x 210 mm.), 51 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, (collection « Les Patrimoines »), exemplaire en parfait état.
En quatrième
de couverture :
Jusqu'au
recensement de 1901, les Belges étaient les étrangers
les plus nombreux en France et dans le Nord. Ils furent même
majoritaires dans certaines agglomérations. Roubaix, où
ils représentaient plus de la moitié de la population,
fut, pendant vingt ans, la quatrième ville belge du monde !
Ils furent à l'origine du prodigieux
développement de l'agriculture et des industries textiles,
minières et métallurgiques du Nord et du Pas-de-Calais.
La frontière artificielle entre Nord, Flandre et Wallonie
n'a jamais constitué un obstacle aux migrations de proximité
entre ces régions cousines. C'est une histoire de famille,
mal connue même de ses membres, que nous nous proposons
de raconter dans cet ouvrage.
Sommaire :
- Préface.
- Introduction.
- Deux pays voisins aux histoires mêlées.
- L'indépendance
belge.
- La Belgique au XIXe siècle.
- Communications.
- Belges et Nordistes.
- Les fraudeurs.
- Les œuvres religieuses.
- Les incidents de Lens.
- Des souffrances partagées.
- Réfugiés
belges et nordistes.
- Une immigration oubliée.
- Un avenir européen.
- Carte, bibliographie.
Vendu.
[QUENEAU (Raymond)]. CATONNÉ (Jean-Marie) — Queneau. Paris, Pierre Belfond, 1992. In-8° (155 x 239 mm.) collé, 295 p., (collection « Les Dossiers Belfond »), épuisé au catalogue de l'éditeur.
En quatrième
de couverture :
Du Chiendent aux Fleurs bleues,
des Exercices de style à Si tu t'imagines,
Raymond Queneau construit une œuvre qui échappe à
toutes les modes et n'appartient à aucune chapelle. Poète,
romancier, encyclopédiste, mathématicien, pataphysicien,
oulipien, cet ex-surréaliste, de tempérament philosophe
et timide de nature, a fini par exercer un véritable magistère
sur la littérature française. Admirateur des classiques,
ennemi de toute gratuité, cherchant dans les contraintes
formelles les conditions d'une écriture libérée,
ce forgeur de mots et balayeur de syntaxe est – au-delà
de l'incertaine querelle du néo-français –
un des rénovateurs de notre langue. Les mots furent ses
vrais voyages, sa grande aventure. Son langage, son génie
comique et l'universalité de sa culture en font notre Rabelais.
La critique savante, après l'avoir longtemps
traité avec condescendance, ou réduit au pur formalisme
mathématique ou verbal, en fait aujourd'hui un auteur d'inspiration
gnostique, au risque de négliger le rationalisme indéniable
de ce familier de la pensée de Hegel. Cet ouvrage, en forme
de synthèse, se propose de faire le point sur les multiples
interprétations, gloses et déchiffrements érudits.
Il se veut également, par-delà le malentendu du
succès de Zazie dans le métro, une réhabilitation
de l'auteur de Pierrot mon ami, de Loin de Rueil
et de L'Instant fatal.
10 euros (code de commande : 02364).
[SOCIALISME]. De Quaregnon à la nouvelle Internationale Socialiste. Bruxelles, Éditions du Peuple, [ca 1951]. In-8° (132 x 209 mm.) collé, 63 p.
Table des matières
:
- Avant-propos.
- Déclaration de principes.
- Rapport sur la politique internationale
(Congrès du 11-6-1945).
- Résolution du P. S. B. sur la
politique internationale (3-12-1950).
- La nouvelle Internationale.
- Déclaration fondamentale de l'Internationale
Socialiste.
- Statuts de l'Internationale Socialiste.
- Liste des partis affiliés.
- La Reconstitution de l'Internationale,
rapport de Victor Larock.
- L'Action Socialiste dans le monde et
la lutte pour la paix, rapport de Morgan Phillips.
15 euros (code de commande : 02357).
STOYE (Johannes) — Spanien im Umbruch. Leistungen und Ziele der Franco-Regierung. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 4 Kartenkizzen und 4 Bildtafeln. Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1940. In-8° (155 x 230 mm.) broché, 104 p., illustrations hors texte, couverture salie.
Inhaltsverzeichnis :
I. Ausgangspunkte.
1. Spanische Eigenständigkeit.
2. Der spanische Raum.
3. Das spanische Volk.
4. Spanische Haltung.
II. Spanisches Staatsdenken.
1. Lösungsversuche und
Fehlschläge bis 1936.
- Fremde
Ideen aus Frankreich.
- Restauration.
- Direktorium
Primos de Rivera.
- Die
zweite Republik.
2. Einbruch neuer Ideen.
3. Bürgerkrieg und Neuordnung.
- Politische
Neugestaltung.
- Nationalsyndikalismus.
- Fuero
del Trabajo.
- Spanische
Autarkie.
10 euros (code de commande : 02358).
STREBELLE (Marin) — Mon papa, le petit pharaon et moi Marin Strebelle. Avec 9 illustrations de l'artiste pour une histoire de Ben Durant. Bruxelles, Quadri, 2000. In-8° (147 x 195 mm.) broché sous couverture à rabats, [32] p., illustrations, (collection « 99 »), tirage limité à 99 exemplaires numérotés et signés par les auteurs (n° 7), avec un dessin original signé par Marin Strebelle et accompagné de la signature de Ben Durant en guise de dédicace pour Alain Debaisieux à la page de faux-titre, on joint le carton d'invitation à la sortie de presse à la Galerie Quadri.
Article de La Libre
Belgique :
Bref,
élégant, raffiné, proche de la nouvelle,
Mon papa, le petit pharaon et moi est paru depuis quelque
temps, mais mérite sûrement quelques lignes. Marin
Strebelle trouve en Quadri un écrin digne de ses dessins.
Gai, libre, peut-être plus clair que d'habitude, l'illustrateur
laisse percer une pointe d'inquiétude dans les sourires
croisière-cocktail d'une Égypte pleine de richesses
et de faussaires.
Venant épouser le texte vif et pertinent
de Ben Durant, les illustrations de Marin Strebelle invitent sans
couleur, sans naïveté et surtout sans concession les
jeunes à la lecture de Mon papa, le petit pharaon et
moi, délicieux polar qui nous emmène sur les
bords du Nil et de la faillite d'un major bête et malhonnête
pour une demi-heure d'évasion luxueusement livresque.
Bibliographie :
- « Digne d'un petit pharaon »,
dans La Libre Belgique, 27 mars 2001.
35 euros (code de commande : 02363).
STREBELLE (Marin) — Mon papa, le petit pharaon et moi Marin Strebelle. Avec 9 illustrations de l'artiste pour une histoire de Ben Durant. Bruxelles, Quadri, 2000. In-8° (147 x 195 mm.) broché sous couverture à rabats, [32] p., illustrations, (collection « 99 »), tirage limité à 99 exemplaires numérotés et signés par les auteurs (n° 8), avec un dessin original signé par Marin Strebelle et accompagné de la signature de Ben Durant en guise de dédicace pour Alain Debaisieux à la page de faux-titre, on joint le carton d'invitation à la sortie de presse à la Galerie Quadri.
Article de La Libre
Belgique :
Bref,
élégant, raffiné, proche de la nouvelle,
Mon papa, le petit pharaon et moi est paru depuis quelque
temps, mais mérite sûrement quelques lignes. Marin
Strebelle trouve en Quadri un écrin digne de ses dessins.
Gai, libre, peut-être plus clair que d'habitude, l'illustrateur
laisse percer une pointe d'inquiétude dans les sourires
croisière-cocktail d'une Égypte pleine de richesses
et de faussaires.
Venant épouser le texte vif et pertinent
de Ben Durant, les illustrations de Marin Strebelle invitent sans
couleur, sans naïveté et surtout sans concession les
jeunes à la lecture de Mon papa, le petit pharaon et
moi, délicieux polar qui nous emmène sur les
bords du Nil et de la faillite d'un major bête et malhonnête
pour une demi-heure d'évasion luxueusement livresque.
Bibliographie :
- « Digne d'un petit pharaon »,
dans La Libre Belgique, 27 mars 2001.
35 euros (code de commande : 02362).
[TRADUCTION]. BLAMPAIN (Daniel), THOIRON (Philippe) et VAN CAMPENHOUDT (Marc, dir.) — Mots, termes et contextes. Actes des septièmes Journées scientifiques du réseau de chercheurs Lexicologie, Terminologie, Traduction. Bruxelles, Belgique - 8, 9 et 10 septembre 2005. Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2006. In-8° (170 x 239 mm.) 741 p., (collection « Actualité Scientifique »), exemplaire en très bon état.
Table des matières
:
- Comité
scientifique, p. 5.
- Comité d'organisation, p. 5.
- Membres du comité de réseau
LTT, p. 6.
- Appel à communications. Document
de présentation (extraits), p. 7.
- Liste des auteurs, p. 13.
- Séance d'ouverture, p. 19.
- Allocution de Michèle Gendreau-Massaloux,
p. 21.
- Allocution de Philippe Thoiron,
p. 25.
- Allocution de Daniel Blampain,
p. 29.
- Phénomènes de sous-spécification
sémantique : représentation des unités lexicales
et prise en compte du contexte, par J.L. Arnaud Pierre,
p. 33.
- Inférences et le rôle
du micro-contexte et du macro-contexte, par Anna Anastassiadis-Syméonidis
et Olympia Tsaknaki, p. 45.
- Les contextes : à la source
du terme ?, par Maria-Cristina Alexandru et François
Gaudin, p. 59.
- Le trou lexical entre langue et discours
: pour un statut discursif du silence, par Mamadou Diakité,
p. 69.
- Texte, terme et contexte, par
Rute Costa, p. 79.
- Terme et micro-contexte. Les prédications
spécialisées, par Pierre Lerat, p. 89.
- Le travail terminologique pour la
traduction de l'histoire, par Ana Escartin Arilla,
p. 99.
- Entre prototypisation et mise en discours
: les enjeux du sens, par Abdou Elimam Abdeljlil, p. 109.
- Le contexte : filtre ou membrane ?,
par Christine Durieux, p. 121.
- XML/XSL(T) pour un traitement unifié
des corpus multilingues et des règles de traduction correspondantes,
par Pascaline Merten, p. 129.
- Interprétariat à distance,
collecte et diffusion collaboratives de corpus oraux bilingues,
en situation ouverte, finalisée ou contextualisée,
par Georges Fafiotte, p. 145.
- Indexation humaine et indexation automatisée
: la place du terme et de son environnement, par Widad
Mustafa El Hadi, p. 157.
- Marqueur, un logiciel de marquage
semi-automatique de textes, par Abdelkrim Mokhtari,
p. 167.
- Topographie bitextuelle et approches
quantitatives de l’extraction de ressources traductionnelles
à partir de corpus parallèles, par Maria
Zimina-Poirot, p. 175.
- Élaborer des corpus XML en
langues partenaires : quelles technologies appropriées
? Le cas de la Mauritanie et du Sénégal, par
Marc Van Campenhoudt, Cissé Thierno et Paul
Muraille, p. 187.
- Une composition de solutions génériques
pour créer le dictionnaire FEV et importer le vietnamien
dans Papillon, par Khánh Phan Huy, Hung Vo
Trung et Christian Boitet, p. 199.
- Les contextes de l’enquête
: le cas de l’Atlas Linguistique de Tunisie, par Sondos
Ben Hariz, p. 213.
- Mots et contextes en FPI et en Nouchi,
par Kouassi Ayewa Noël, p. 221.
- Variabilité et variation en
terminologie et langues spécialisées : discours,
textes et contextes, par Isabel Desmet, p. 235.
- Les adverbes composés dans
le domaine du travail, par Dolors Catala et Jorge
Baptista, p. 249.
- Des termes au concept : de cas du
vocabulaire architectural, par Jean-Yves Blaise et
Iwona Dudek, p. 265.
- Contexte d'utilisation, contexte de
communication : la double identité du dictionnaire d'entreprise,
par Patrick Leroyer et Henrik K. Simonsen, p. 283.
- L’emploi de termes réduits
comme révélateur de la centralité dans le
domaine, par Marie-Paule Jacques, p. 299.
- La traduction technique : le texte
sous l’empire de l’extratextuel, par Mathilde
Fontanet, p. 309.
- La terminologie d'entreprise et ses
contextes d'usage, par Franco Bertaccini et Alessandra
Matteuci, p. 317.
- Construction collaborative d'un lexique
français-anglais technique dans IToldU : contribuer pour
apprendre, par Valérie Bellynck, Christian
Boitet et John Kenwright, p. 327.
- Le champ sémantique du mot
marabout en français du Sénégal, par
Modou Ndiaye, p. 337.
- Interroger un corpus par le sens :
une approche linguistique, par Bernard Jacquemin, p. 347.
- Quels corpus et quels approches pour
une description contrastive de l’eurolecte ?, par Roger
Goffin, p. 361.
- Les spécificités en
contexte : comment étudier la polysémie dans un
corpus technique ?, par Ann Bertels, p. 371.
- Un aspect de l’apport des corpus à
la terminologie linguistique : l’alignement, par Franck
Neveu, p. 381.
- Les noms de divinités : web,
contextes et classes d’objets, par Michel Mathieu-Colas,
p. 391.
- Les particularités lexicales
dans les romans, entre discours et fiction, par Omer Massoumou,
p. 409.
- Morphologie de spécialité
: regard(s) sur le(s) contexte(s), par Raquel Silva,
p. 421.
- La termontographie en contexte(s),
par Rita Temmerman, Koen Kerremans et Veerle
Vandervoort, p. 429.
- La traduction de la métalangue
: la problématique terme/mot en contexte, par Béchir
Ouerhani, p. 441.
- Termes et textes : la construction
du sens dans la terminologie médicale, par Madalena
Contente, p. 453.
- Approche contrastive du corpus bilingue
français - roumain du domaine vétérinaire,
par Georgeta Barna Corina, p. 467.
- Le langage de la médecine :
les mots pour le dire, par Christian Balliu, p. 475.
- L’incidence du contexte sur la
traduction médicale, par Renate Trurnit Verbic,
p. 483.
- L'expression de la subjectivité
à travers les verbes de perception visuelle dans des textes
français relevant des examens cliniques et paracliniques,
par Aneta Tosheva, p. 497.
- Contextes et néologie terminologique
dans le domaine médical, par Teresa Lino, p. 509.
- La créativité lexicale du
français en République Démocratique du Congo
: un cas d'analyse lexicologique en contexte, par Willy
Ilunga Ntumba, p. 515.
- La presse vue à travers Néoscope
: quand les contextes médiatiques sont mis au service de
la néologie, par Lina Sader Feghali, p. 525.
- Moderniser sa langue pour mieux apprendre
les langues étrangères, par Élisabeth
Ravaoarimalala, p. 535.
- La reconnaissance automatique des
néologismes de sens, par Salah Mejri, p. 545.
- Critiquez vos dictionnaires bilingues…
à bon escient, par André Dussart, p.
559.
- Du contexte à la citation :
les récents développements de la dictionnairique,
par Jean-Nicolas Desurmont, p. 567.
- Analyse sémantico-discursive
des collocations lexicales en corpus spécialisé
: la base connaissance-s, par Estelle Dubreil et Béatrice
Daille, p. 579.
- Le nom propre en contexte – une
approche lexicologique, par Jean-Louis Vaxelaire, p. 591.
- Mots et contexte : essai d’analyse
lexico-sémantique du vocabulaire politique au Cameroun
de 1990 à 1992, par Ladislas Nzessé,
p. 599.
- Le dictionnaire des collocations en
ligne, par Antonio González Rodríguez,
p. 609.
- Traduire les termes de couleur : la
chromonymie en botanique à la Renaissance, par Philippe
Selosse, p. 619.
- La recherche terminologique dans un
dialecte ouvert : le cas du dioula, par Lamine Sanogo Mamadou,
p. 631.
- Le terme « bien commun »
et la construction du sens. Mais dans quel contexte ?, par
Dorota Sliwa, p. 641.
- Le stéréotype, du mot
au concept : saisies à travers les contextes, par Mosbah
Said, p. 651.
- L'exemplification bilingue des Mots
de la grammaire en contexte créolophone, par Frédéric
Torterat, p. 661.
- L’unité phraséologique
en didactique des langues étrangères de spécialité
: le cas du discours économique d’entreprise en espagnol,
par Lieve Vangehuchten, p. 673.
- Les rôles de la situation et
du contexte dans les technolectes bilingues français -
arabe, par Leila Messaoudi, p. 687.
- La terminologie des sciences de gestion
en contexte : terme ou mot ?, par Soumaya Mejri, p.
699.
- Prépondérance du contexte
extralinguistique dans la construction du sens : l’exemple
des communications de travail dans la navigation aérienne,
par Pascale Vergely, p. 709.
- Le rôle du contexte dans les
lexiques techniques : le cas de la métallurgie de récupération
en Afrique de l’Ouest, par Anneleen Van der Veken,
p. 719.
- Clôture, p. 731.
- Allocution de Philippe Thoiron,
p. 733.
20 euros (code de commande : 02383).
[VALENTIN ET ORSON]. Histoire de Valentin et Orson, Très-hardis, très-nobles et très-vaillans chevaliers, fils de l'empereur de Grèce, et neveux du très-vaillant et très-chrétien Pépin, roi de France. Contenant diverses matières, comme vous pouvez voir ci-après. Lille, Fourray, [1811]. [A Lille, / Chez J. Fourray, (Successeur de feu Pillot), Impri- / meur-Libraire, rue des Prêtres, près la place du Théâtre.] In-8° (135 x 212 mm.) broché sous une couverture de papier marbré, 136 p., un bois gravé à la page de titre.
Imprimé
pour la première fois à Lyon en 1489, ce roman de
chevalerie qu'on peut rattacher au cycle arthurien jouit d'une
très grande popularité er fut l'un des plus régulièrement
réédités, notamment, dans la célèbre
Bibliothèque bleue.
Fernand Danchin se fonde très probablement
sur la notice du Journal général de l'imprimerie
et de la librairie pour indiquer que cette édition
fut imprimée en 1811.
Jean-Louis-Joseph Fourray (ca 1776 - 1813) fut
le second mari de la veuve de l'imprimeur lillois Antoine Joseph
Pillot. « L'établissement, par son épouse,
"date, comme imprimeur, du mois de janvier 1804" (lettre
du 18 mars 1810, par laquelle J. Fourray demande l'attribution
du brevet). »
Bibliographie :
- Journal général de l'imprimerie
et de la librairie, Première année - N° 14
- 5 mars 1811, n° 813.
- Danchin (Fernand), Les Imprimés
lillois, répertoire bibliographique de 1594 à 1815,
n° 3502.
- Laharie (Patrick), Libraires et imprimeurs.
59. Lille (Nord). 1813-1881, p. 38.
Vendu.
VAN YPERZEELE (Achille) — Des maisons de charité aux centres hospitaliers. Préface par André Dagant. Haine-Saint-Pierre, Cercle d'Histoire et de Folklore Henri Guillemin, 2004. In-8° (200 x 240 mm.) broché, 334 p., nombreuses illustrations en noir, (collection « Publications du Cercle d'Histoire et de Folklore Henri Guillemin », volume XXXIX), exemplaire en parfait état.
Table des matières
:
- Préface.
- La léproserie d'Estinnes-au-Val.
- L'hôpital de Collarmont à
Carnières.
- La léproserie de Binche.
- L'hôpital Saint-Julien à
Boussoit.
- L'Institut Notre-Dame de la Compassion
à Haine-Saint-Paul.
- Les homes des orphelins.
- Le home de Baume.
- Le home de La Hestre.
- Le home de Houdeng-Aimeries.
- Les soupes scolaires et populaires.
- La dynastie Warocqué.
- L'hospice et l'hôpital
Louise.
- La crèche Mary.
- La maternité
Elisabeth.
- L'orphelinat.
- La clinique Elisabeth à Maurage.
- La clinique du docteur Cambier à
Saint-Vaast.
- L'asile du Sacré-Cœur à
Carnières.
- La clinique du docteur Herman à
Haine-Saint-Paul.
- La clinique Mercier-Lequime à
Houdeng-Gœgnies.
- L'Institut Saint-Bernard à Manage.
- L'hospice Plunkett de Rathmore à
Houdeng-Aimeries.
- L'hospice Saints Pierre et Paul, la maternité
et l'orphelinat à Binche.
- La clinique de La Hestre.
- L'hôpital civil de La Louvière.
- Le Fonds des Maladies Professionnelles
Achille Delattre à Morlanwelz.
- Les Petites Sœurs de L'Assomption,
à Fayt, Morlanwelz et Manage.
10 euros (code de commande : 02372).
aura lieu
le mardi 17 juin 2025
par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone ou sms (+32 (0) 472 51 52 63).
Ces livres peuvent être retirés à l'adresse figurant dans l'en-tête du blog.
En cas d'envoi postal, veuillez indiquer le pays vers lequel le colis devrait être expédié, cela me permettra de vous indiquer les modalités de livraison et de paiement.






























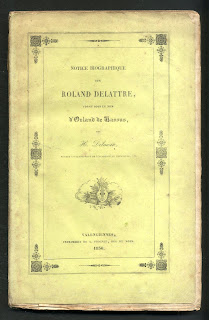





















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire